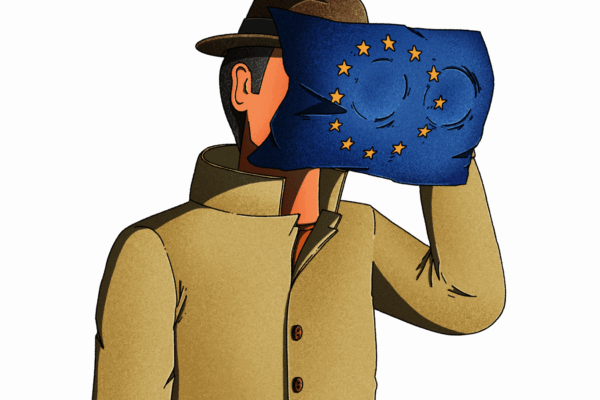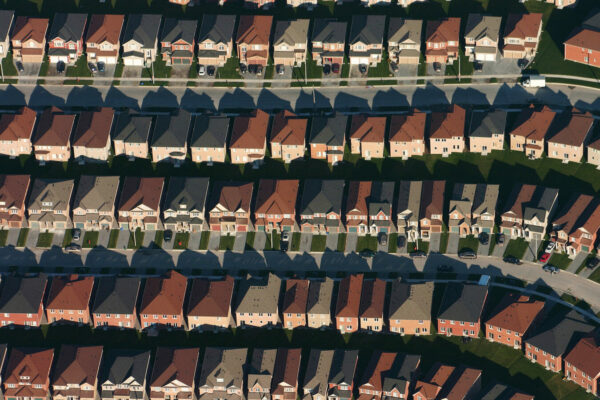D’un geste discret, Aïcha (nom d’emprunt) entreprend de sécher une larme qui coule le long de sa joue. Voilà plusieurs minutes que cette femme originaire de Djibouti détaille son parcours migratoire qui l’a vue fuir son pays avec ses quatre enfants avant d’atterrir en Belgique. Mais ici, on ne parle pas de guerre, de famine, de pauvreté ou encore d’autres facteurs «classiques» pouvant expliquer le départ. Aïcha avait une vie confortable de classe moyenne à Djibouti, elle travaillait, partait en vacances dans les montagnes en Éthiopie lorsque le climat djiboutien se faisait trop suffocant.
Ce qui l’a poussée à partir est un danger plus insidieux, moins connu: l’excision, du nom de cette pratique visant à pratiquer une ablation du clitoris chez l’enfant ou la jeune femme. Pratique «culturelle» dans bon nombre de pays d’Afrique et quelques pays d’Asie et du Moyen-Orient, l’excision entend selon la tradition rendre les jeunes filles moins «volages», plus «dignes». Dans les faits, il s’agit d’une mutilation génitale cruelle qui a ensuite un impact désastreux sur la vie des femmes à qui elle a été imposée.
Si Aïcha est en Belgique, c’est qu’elle a voulu protéger une de ses filles que la communauté entière menaçait d’exciser. Un jour qu’Aïcha était au travail, cela a d’ailleurs bien failli arriver: tantes et grand-mère ont emmené la fillette pour l’exciser. Celle-ci n’a dû son salut qu’au fait de s’enfuir, renversant au passage de l’eau bouillante sur elle… Quelques jours plus tard, Aïcha s’envolait vers le plat pays avec ses enfants, bien décidée à ce que l’épisode ne se répète pas.
D’après le Groupe pour l’abolition des mutilations sexuelles (GAMS), l’association luttant contre l’excision en Belgique, 23.000 femmes et jeunes filles excisées vivent en Belgique. Les pays d’origine où la prévalence était la plus importante, on recensait la Guinée, la Somalie, l’Égypte, l’Éthiopie, la Côte d’Ivoire.
Pratique «culturelle» dans bon nombre de pays d’Afrique et quelques pays d’Asie et du Moyen-Orient, l’excision entend selon la tradition rendre les jeunes filles moins «volages», plus «dignes». Dans les faits, il s’agit d’une mutilation génitale cruelle qui a ensuite un impact désastreux sur la vie des femmes à qui elle a été imposée.
Détail important: la grande majorité de ces personnes sont arrivées en Belgique déjà excisées. Est-ce à dire que des enfants nés ou vivant Belgique ne pourraient tout de même pas être concernés par ce phénomène, notamment lors d’un retour au pays? En 2020, le GAMS estimait leur nombre à 12.000. Bountou Kouyaté, travailleuse interculturelle au GAMS, elle-même excisée et originaire de Guinée, en est convaincue. «On entend parler de cas comme ça», explique-t-elle. L’asbl a d’ailleurs eu à gérer 15 situations à risque – enfant ou jeune fille en risque d’être excisée lors d’un retour au pays – en 2020, pour 75 en 2023 et 62 en 2025.
Pourtant, à ce jour, «il n’y a pas eu d’examen chez des enfants nés en Belgique qui seraient remontés jusqu’à la justice», explique Fabienne Richard, directrice du GAMS. Martin Caillet, chef au Cemavie (Centre médical d’aide aux victimes de l’excision) du CHU Saint-Pierre, confirme et précise: «Et c’est tant mieux, parce que c’est notre grande angoisse. On a déjà vécu des situations tendues, mais jamais au point de dénoncer une famille. Les conséquences sont terribles: des parents en prison, des enfants placés. Il faut vraiment être sûr de ne pas se planter. Jusqu’ici ça ne s’est jamais présenté. Il n’y a jamais eu d’éléments assez concrets.»
C’est qu’en Belgique, une loi contre l’excision existe. L’article 409 du Code pénal sanctionne la pratique, la facilitation ou le fait de favoriser toute forme de mutilation des organes génitaux féminins, sous peine d’emprisonnement, même si l’acte a été commis à l’étranger. Mais faute de cas, cette loi n’a donc jamais été appliquée. Ce qui ne veut pas dire que certains parquets n’ont jamais mis les mains dans le cambouis. Ainsi, à Liège, le parquet fait état d’interventions – rares – en «protection». On parle ici de cas rapportés par des travailleurs sociaux craignant un retour au pays et une excision sur place. Des cas qui ont poussé la magistrate de référence à ordonner la saisie des billets d’avion, des passeports ou alors un contrôle par un médecin au retour. Contrôles qui ont toujours donné un résultat négatif. À Bruxelles, la juge Michèle Meganck mentionne un dossier ayant donné lieu à un placement des enfants en urgence pour empêcher le départ au pays.
La loi aurait-elle donc un effet de prévention? Djenaba, Guinéenne, détaille le cas de sa sœur, mère d’une fille de 5 ans. «On est retournées en Guinée, et son mari, avant de partir, a téléphoné à sa famille pour leur dire: ‘Si vous touchez à ma fille, je vous tue. Parce que de toute façon, quand je retournerai en Belgique, je devrai aller en prison. Donc autant y aller pour une bonne raison’.»
D’après le Groupe pour l’abolition des mutilations sexuelles (GAMS), l’association luttant contre l’excision, 35 459 personnes étaient concernées par ce phénomène en Belgique en 2020. Et 23 395 femmes et jeunes filles étaient excisées. Quant aux pays d’origine où la prévalence était la plus importante, on recensait la Guinée, la Somalie, l’Égypte, l’Éthiopie, la Côte d’Ivoire.
Parmi le reste de l’arsenal législatif, il y a aussi le fameux «Certificat de non-excision», demandé par le CGRA lorsqu’une procédure de demande d’asile est introduite sur la base d’un risque d’excision au pays. À noter que «la Belgique est très bien placée en matière de reconnaissance des mutilations génitales féminines (MGF) dans le cadre des demandes d’asile, contrairement à d’autres pays européens notamment du sud», souligne Fabienne Richard. Au Cemavie, «la majorité de nos patientes viennent pour obtenir des certificats médicaux, dans le cadre de demandes d’asile destinées au CGRA; elles nous sont adressées par des associations ou des centres pour réfugiés, soit Fedasil, soit la Croix-Rouge, soit Caritas…», indique Martin Caillet. Ce certificat est assorti d’un contrôle médical des jeunes filles tous les trois ans – jusqu’à il y a peu, ce contrôle était annuel. Sa protection peut aussi être plus informelle: Eva Edel, sage-femme et PEP’S (Partenaire Enfants-Parents) à l’ONE à Liège, note qu’il est parfois utilisé lors de leur accompagnement de certaines familles afin de les aider à résister à la pression une fois de retour au pays pour les vacances. «Ce document, c’est une vraie protection, insiste-t-elle. On leur explique, avec des mots simples qu’elles pourront dire à leurs proches: ‘En Belgique, ils ont constaté qu’elle était intacte, si je rentre avec une fille excisée, je risque la prison.’»
Prendre soin, agir… ou improviser
Mais parfois, dans l’urgence, il faut aussi savoir improviser pour protéger des familles à risque. C’est ce qui est arrivé à Ingrid Godeau, médecin scolaire à Anderlecht. Pendant l’année scolaire 2011-2012, elle reçoit un signalement du GAMS: une mère somalienne projette de faire exciser ses filles durant les vacances.
À l’époque, aucun protocole n’existait. Avec le GAMS et une autre association, Intact, qui soutient juridiquement les personnes victimes de MGF, Ingrid Godeau décide d’agir, et vite. Elle contacte l’école, puis la famille, aidée d’un interprète. Sous couvert d’une visite médicale, elle ouvre le dialogue lors d’une rencontre à domicile. «Je voulais aborder la question naturellement, explique-t-elle. Nous avons commencé à parler de leur adaptation en Belgique, de leur vie ici…»
Peu à peu, la mère confie qu’en Somalie, l’excision est la norme. «La mère m’a expliqué qu’elle-même avait subi l’excision, et qu’elle comptait la perpétuer avec ses filles.» Un moment très délicat pour la médecin, qui a dû trouver les mots justes pour ne pas braquer la femme, tout en faisant passer un message clair.
La médecin lui expose alors la loi belge, les risques, la notion de maltraitance. «Il fallait agir comme dans tout cas de danger, sans accuser.» Après plusieurs rencontres, la mère signe une attestation écrite s’engageant à ne pas faire exciser ses filles.
Avant le départ au pays, Ingrid Godeau prévient la mère: «Ramenez-moi vos filles en bonne santé.» L’été se passe dans l’inquiétude: «Nous craignions qu’un membre de la famille ne prenne l’initiative pendant le voyage.» À la rentrée, soulagement: la famille revient, les enfants vont bien, le certificat est restitué. Cette expérience marquera un tournant: «À partir de là, je me suis engagée dans la prévention et la sensibilisation aux mutilations sexuelles féminines.»

(c) ANA YAEL
Un tabou tenace chez les professionnels
À l’instar d’Ingrid Godeau, l’engagement dans la prévention des MGF s’avère le plus souvent le fruit d’un hasard de parcours, quand il ne découle pas d’une conviction personnelle déjà ancrée. Faute de formation ou par manque d’expérience, la plupart des professionnels passent à côté de situations ou se taisent par peur de se tromper. Et le tabou – de l’excision, mais aussi de la sexualité féminine en général – n’arrange rien. «Les erreurs dans la prise en charge clinique sont fréquentes, et les équipes du centre sont souvent sollicitées pour corriger des diagnostics erronés, souligne Martin Caillet. À l’ULB, il existe un cours sur les mutilations sexuelles, mais il reste marginal. La formation n’est pas systémique.»
Pourtant, le GAMS effectue un important travail de formation de l’ensemble des structures pouvant être en contact avec les populations à risque: Fedasil, ONE, écoles, médecine scolaire. L’association a notamment développé un outil appelé «détectomètre», qui vise à aider les professionnels à détecter les situations à risque et identifier les actions à entreprendre pour protéger les jeunes filles. Un travail utile, mais souvent non obligatoire si l’on en croit Fabienne Richard. «On forme un maximum de monde, mais le problème réside dans le fait que ce n’est pas systématisé, à l’exception de Fedasil, avec qui nous avons une convention d’expertise pour tout le réseau des centres d’accueil. Mais à l’ONE, il n’y a pas d’obligation de suivre nos formations. Pareil pour les services de promotion de santé à l’école», explique-t-elle.
L’ONE nous a d’ailleurs fourni les chiffres des PEP’S ayant suivi une formation autour des MGF, que ce soit pour découvrir cette problématique, aborder le sujet avec les familles ou gérer les situations à risque. Concrètement, le nombre de participants a fluctué ces dernières années, passant de 86 en 2022, à 57 en 2023, 44 en 2024 et 36 en 2025 sur les 900 PEP’S que compte l’Office.
L’engagement dans la prévention des MGF s’avère le plus souvent le fruit d’un hasard de parcours, quand il ne découle pas d’une conviction personnelle déjà ancrée. Faute de formation ou par manque d’expérience, la plupart des professionnels passent à côté de situations ou se taisent par peur de se tromper. Et le tabou – de l’excision, mais aussi de la sexualité féminine en général – n’arrange rien.
Avant de s’être formée, Isabelle Lupant, médecin dans un planning familial de Namur délivrant ces certificats, admet avoir probablement reçu des femmes excisées sans s’en rendre compte. «Plus qu’un tabou, c’est un manque de connaissance, estime-t-elle. Nombre de médecins ne pensent pas spontanément qu’une femme venue d’un pays concerné puisse être excisée.» Même constat auprès d’Ingrid Godeau, la prise de conscience est souvent tardive: «Je ne me suis formée qu’après avoir été confrontée à un cas concret.»
Quant à savoir si, aujourd’hui, tous les services de promotion de la santé à l’école (PSE) se sentent concernés par les mutilations génitales féminines… Pour la médecin, la réponse est simple: «Honnêtement, non. Pas autant que je le souhaiterais, en tout cas. Cela dépend beaucoup de la personnalité des agents – qu’ils soient médecins ou infirmiers.»
Ingrid Godeau participe elle-même à l’atelier pratique du GAMS destiné aux équipes PSE, «mais là encore, il y a trop peu de participants. Et ceux qui s’y inscrivent sont presque toujours des professionnels déjà sensibilisés ou déjà confrontés à des cas concrets».
Le tabou est tel que, face à une situation d’excision avérée, le secret professionnel ou une «compréhension culturelle» prennent parfois le dessus, certains médecins estimant que la dangerosité n’existe plus si la cicatrisation est achevée. «C’est un problème: cette pratique reste minimisée, vue comme culturelle, moins grave que d’autres violences», déplore Fabienne Richard.
Dans les communautés migrantes, la peur du jugement alimente souvent le silence. «Parler de l’excision est tabou, même chez nous», confie Ismatou Bah, travailleuse interculturelle d’origine guinéenne, engagée au sein du GAMS depuis 2017. Maimouna, arrivée en Belgique après une excision, décrit «un silence qui s’ajoute à la douleur». «Quand tu arrives en Belgique, tu portes souvent en toi une douleur dont tu n’as jamais parlé. Ce vécu devient alors tabou, presque indicible. Et c’est encore plus douloureux, parce qu’on te retire la possibilité d’exprimer quelque chose qui t’a profondément marquée.»
Des erreurs fréquentes
Le manque de formation en matière d’excision entraîne erreurs de diagnostic, certificats erronés et sous-détection chronique. «Parfois, on nous amène un cas, on doute, on ne voit pas bien ce qui s’est passé», raconte Martin Caillet. Il se souvient du cas d’une jeune fille originaire du Moyen-Orient. «Elle avait 11 ans, amenée justement en se demandant ce qu’elle avait, ce que ses parents lui avaient fait… Et en consultant son dossier, on voit qu’elle est suivie pour son lichen scléreux – une altération de la peau de la vulve – depuis des années… La conséquence, c’est que la vulve se referme complètement, mais jamais personne ne l’avait coupée.»
Sans formation adéquate, la méprise est possible, rappelle le médecin du Cémavie qui, avec ses collègues, estime avoir examiné entre 4.000 à 5.000 personnes. «On récupère ainsi pas mal d’erreurs de certificats.»
Une erreur de certificat, c’est l’expérience qu’a connue Agnès Vermeiren, tutrice d’une jeune Érythréenne décrite comme excisée «niveau 1» sur un certificat réalisé dans un centre Fedasil. En cherchant sur internet, la tutrice trouve l’adresse du Cemavie. Un examen spécialisé révélera qu’elle était pourtant intacte. Les douleurs qu’elle exprimait venaient en réalité de violences sexuelles subies durant son parcours migratoire. «Le médecin de Cemavie m’a expliqué qu’il faut une réelle expertise, car tous les sexes ne se ressemblent pas et qu’il faut savoir observer les différences», explique Agnès Vermeiren pour qui l’absence de suivi adapté pour ces adolescentes, parfois livrées à elles-mêmes après des parcours traumatiques, peut devenir une nouvelle violence.
Pourtant, quand on voit les conséquences de l’excision sur le corps d’une femme, il y a urgence. Douleur durant les règles ou les rapports, accouchements très problématiques, trauma: on parle bien de violences graves dont les femmes victimes ne prennent parfois conscience qu’en arrivant en Belgique, tant la pratique est ancrée culturellement. Arrivée en Belgique il y a 20 ans, Awa Nikiéma, originaire du Burkina Faso a subi une excision à quatre reprises. Et ce n’est qu’enceinte qu’elle a compris les raisons de ses maux, avant d’être orientée vers le GAMS, puis Cemavie. «Ce cheminement m’a aidée à mieux comprendre les dimensions psychologiques du traumatisme», explique-t-elle.
L’angle mort du regroupement familial
Pour beaucoup de familles, le danger ne se situe pas en Belgique, mais lors des retours au pays. «Dans certains pays, les familles appellent chaque semaine pour demander: ‘Alors, tu l’as fait?’», raconte Martin Caillet.
Certaines mères renoncent à voyager pour protéger leurs filles. «Elles se sentent démunies face aux pressions familiales, relève Sylvie Anzalone pour l’ONE. Notre rôle est d’’armer’ ces parents sur le long terme, en leur donnant des outils de prévention et des arguments pour résister à ces injonctions.»
Malgré le soutien des associations, la tradition et le sentiment d’appartenance restent des obstacles puissants. Un constat largement partagé sur le terrain, comme le confirme Eva Edel, en évoquant l’histoire d’une mère déchirée entre son histoire, ses traditions et la Belgique: «Pour elle, dire non, ce n’était pas seulement refuser: c’était aussi renoncer à une part de soi, à tout un héritage.»
Sur place, lors du retour au pays, la pression se poursuit. «Il faut surveiller en permanence les filles de peur qu’elles soient excisées à l’insu des parents, même par des proches», explique Aissatou, victime d’excision originaire de Guinée-Conakry. Maimouna, quant à elle, a réussi à sensibiliser une partie de sa famille. «Pour autant, je ne prendrai jamais le risque d’emmener ma fille de 3 ans en Guinée. Même moi, je ne saurais pas me défendre là-bas.»
La pression du pays d’origine pèse d’autant plus lourdement sur les femmes et jeunes filles arrivées en Belgique par regroupement familial. Car contrairement aux réfugiées, qui ne peuvent retourner dans leur pays d’origine (rendant de facto la question du risque d’excision quasi inexistante), celles-ci restent libres de voyager. Et c’est là que se loge une faille majeure en matière de prévention des MGF. A fortiori parce que ces mêmes femmes et jeunes filles échappent totalement aux radars des associations spécialisées. «Toutes celles qui passent par Fedasil ont un contact avec nous. Celles qui arrivent par regroupement familial, elles passent complètement entre les mailles du filet, alerte Fabienne Richard. Or, c’est elles qui sont le plus à risque d’excision, avec leurs allers-retours fréquents au pays, mais aussi à risque de violences intrafamiliales, car elles sont souvent beaucoup moins informées sur leurs droits.» Eva Edel dresse le même constat sur le terrain: «Quand on parle du GAMS aux femmes demandeuses d’asile, elles répondent immédiatement: ‘Ah oui, je connais, j’y suis déjà allée.’ Mais pour celles arrivées via regroupement familial, c’est différent. Il faut vraiment les encourager à y aller.» Elle évoque aussi la «surprise» de ces femmes lorsqu’elles découvrent l’interdiction, en Belgique, de certaines pratiques comme l’excision. «Il faut dire que, souvent, leur mari ne les laisse quasiment pas sortir, ou qu’elles n’osent pas parce qu’elles ne connaissent ni le quartier ni les codes. L’ONE, par contre, elles y vont déjà pour leurs enfants. Ça facilite le contact.»
La pression du pays d’origine pèse d’autant plus lourdement sur les femmes et jeunes filles arrivées en Belgique par regroupement familial. Car contrairement aux réfugiées, qui ne peuvent retourner dans leur pays d’origine (rendant de facto la question du risque d’excision quasi inexistante), celles-ci restent libres de voyager. Et c’est là que se loge une faille majeure en matière de prévention des MGF. A fortiori parce que ces mêmes femmes et jeunes filles échappent totalement aux radars des associations spécialisées.
Ismatou Bah, travailleuse interculturelle au GAMS, insiste elle aussi sur les obstacles que pose le regroupement familial en matière de prévention: «Ces femmes sont souvent sous surveillance, voire sous la tutelle de leur mari. Elles ignorent leurs droits, craignent les représailles.» Pour parvenir à les toucher, Ismatou multiplie les actions informelles, dans des lieux symboliques et conviviaux. «Je me souviens d’une séance à Mons où, après un débat engagé, plusieurs femmes ont exprimé leur surprise et leur intérêt face à ces questions jusque-là taboues.»
C’est la même «surprise» qui saisit Djenaba, arrivée en Belgique via regroupement familial, lorsqu’elle prend conscience, dix ans après son excision, de la violence de la mutilation subie dix ans plus tôt – une violence jusque-là complètement internalisée. En quatrième secondaire, le professeur de religion diffuse en classe La Fleur du désert, un film sur le parcours de Waris Dirie, mannequin et actrice infibulée à l’âge de 5 ans. «Tout m’est revenu d’un coup, raconte Djenaba, stoïque. J’ai quitté la classe en pleurs. Ma meilleure amie m’a suivie et je lui ai expliqué que j’avais subi la même chose. Après toutes ces années, c’était la première fois que j’en parlais.»
De cette prise de conscience tardive survient un besoin de s’engager. Djenaba entame des études d’assistance sociale, s’intéresse au milieu de l’asile et réalise ses premiers stages à la Croix-Rouge, à Liège; là, elle découvre l’existence du GAMS, qui intervient auprès des femmes en demande de protection internationale. «Mais je me suis alors demandé: comment se fait-il que moi, arrivée par le regroupement familial, je n’aie jamais entendu parler du GAMS?» Cet «angle mort» du regroupement familial est une des clés qui permettrait d’expliquer l’écart entre les estimations (de risque) d’excision en Belgique et les cas réellement détectés. Et il est aujourd’hui l’une des priorités du GAMS.
Une première réunion a eu lieu début octobre, réunissant le GAMS, l’Office des étrangers et les communes de Verviers et Schaerbeek – chacune comptant respectivement un nombre important de familles somaliennes et guinéennes. Objectif de la collaboration: renforcer la prévention, diffuser les informations essentielles (loi, risques encourus, outils du GAMS…) et établir une trajectoire de protection. «La première étape de cette trajectoire, pour le GAMS, ce serait un examen médical systématique pour les filles arrivées via regroupement familial», insiste Fabienne Richard.
«Rien n’est structuré»
Mais comment systématiser sans risquer de stigmatiser ou de heurter? Cette question se retrouve au cœur de la prévention des MGF en Belgique, tous publics confondus. Aux tabous liés à la culture d’une part et à la sexualité de l’autre, s’ajoute une formation des professionnels insuffisante et inégale. Résultat: le phénomène est sans doute largement sous-détecté. Pour preuve, le nombre de cas relayés au GAMS entre 2022 et 2023 par l’ONE ou les PSE (des chiffres obtenus via le cabinet de la ministre en charge de l’Enfance, de la Jeunesse et de l’Aide à la jeunesse, Valérie Lescrenier [Les Engagés]): deux via les PEP’s et huit via les PSE au sein des écoles, alors que, pour rappel, le GAMS estime le nombre de jeunes filles en risque d’excision à 12.000 dans notre pays.
«Là où ça bloque complètement, c’est l’absence de dépistage systématique dans les écoles, déplore Fabienne Richard. Il ne s’agit pas forcément de pratiquer un examen physique, mais d’être attentif. Quand une élève de 12 ans part en Guinée pendant les vacances, qui se demandera après ce qu’il s’est passé là-bas? Il n’existe aucun décret obligeant les professionnels à utiliser le détectomètre en cas de voyage. Tant que nos outils, salués par l’ONE, ne seront pas diffusés systématiquement, on ne pourra pas progresser.» Eva Edel note, depuis le terrain, les difficultés liées au secret professionnel et au secret médical: «Jusqu’où peut-on aller dans le partage d’informations entre services? C’est aujourd’hui, je pense, l’un des plus gros freins à une réelle collaboration. À l’ONE, nous faisons tout dans la transparence avec les familles, mais malgré cela, contacter une école ou un autre service reste compliqué. La notion de secret médical crée des barrières, même quand nous travaillons tous pour la même cause: protéger les enfants.»
Aux tabous liés à la culture d’une part et à la sexualité de l’autre, s’ajoute une formation des professionnels insuffisante et inégale. Résultat: le phénomène est sans doute largement sous-détecté. Pour preuve, le nombre de cas relayés au GAMS entre 2022 et 2023 par l’ONE ou les PSE : deux via les PEP’s et huit via les PSE au sein des écoles, alors que, pour rappel, le GAMS estime le nombre de jeunes filles en risque d’excision à 12.000 dans notre pays.
S’ajoute à cela une fragmentation institutionnelle caractéristique de la Belgique, qui entrave la communication entre services. Sylvie Anzalone, porte-parole de l’ONE, résume ce constat: «De l’avis des acteurs de terrain, tous les acteurs de la petite enfance devraient être sensibilisés. Le problème, c’est que rien n’est structuré. Tout dépend du réseau local. Dans certaines communes, la coopération avec les CPAS, l’aide à la jeunesse ou SOS Enfants est fluide, ailleurs c’est beaucoup plus limité. Ce manque de systématisation crée des inégalités et des zones d’ombre.»
Un cas illustre à lui seul les conséquences parfois kafkaïennes de ce constat: alerté par une école sur le cas d’une jeune fille risquant l’excision et un mariage forcé lors d’un retour en Somalie, le GAMS en Flandre avait fait appel à un magistrat référent «genre» au parquet. Lequel, raconte Fabienne Richard avec une pointe d’ironie, «a ensuite appelé le centre Cemavie (où la directrice du GAMS consulte également en tant que sage-femme, NDLR) en nous disant: ‘Je suis bien embêté, à votre avis, que faut-il faire?’».
Imparfaite, la prévention contre les MGF génère toutefois des avancées. Il y a ces parents qui ont pu être convaincus de protéger leur fille, ces mobilisations de professionnels parvenus à empêcher un retour au pays, l’évolution lente des mentalités au sein de la jeune génération, qui s’affranchit du poids de la tradition… «Les graines semées par les acteurs associatifs et médicaux commencent à porter leurs fruits, y compris au sein des communautés, observe, optimiste, le gynécologue Martin Caillet. Des femmes issues de ces communautés osent désormais parler sur TikTok, ce qui était inimaginable il y a dix ans… Il y a une évolution certaine sur la sexualité féminine, le consentement et le respect. Les jeunes générations sont beaucoup plus au courant et concernées, ce qui est encourageant. Rien n’est gagné, mais en Belgique, le train est en marche. Et cela, c’est déjà énorme.»
• En Belgique, environ 30 000 personnes sont concernées par l’excision, dont 12 000 filles à risque, surtout lors de retours au pays d’origine.
• La loi belge interdit l’excision (article 409 du Code pénal), et des actions préventives comme le contrôle des voyages et la délivrance de certificats médicaux sont mises en œuvre sans encore de condamnations.
• La prévention est entravée par un tabou fort, un manque de formation des professionnels et une détection insuffisante, même si des associations comme le GAMS agissent pour sensibiliser et protéger.
Cet article a été réalisé avec l’aide du Fonds pour le journalisme en Fédération Wallonie-Bruxelles