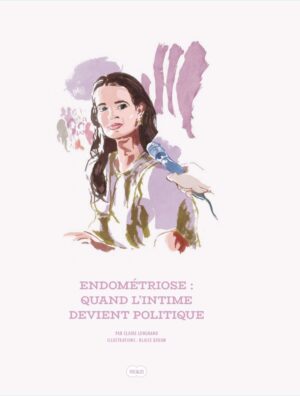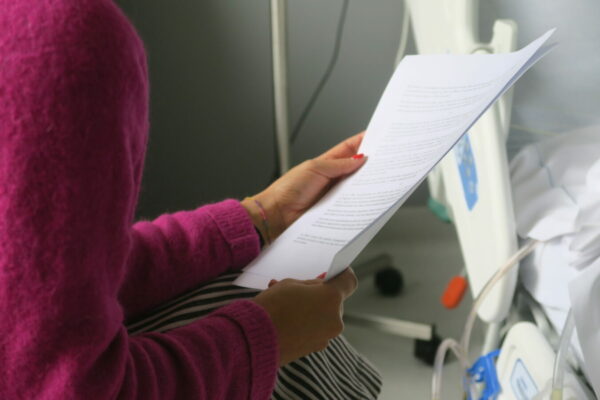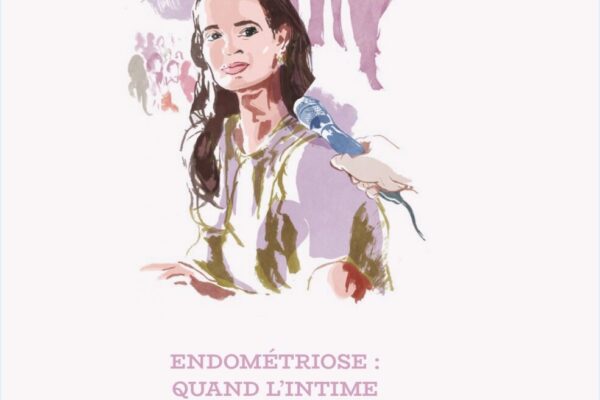AÉ: Quels sont, selon vos recherches, les principaux freins à l’insertion socioprofessionnelle des jeunes, les causes du chômage et des emplois précaires chez les jeunes?
CB: Il est particulièrement difficile de répondre à cette question tant le chômage des jeunes est multifactoriel. Il faut aussi garder à l’esprit que la jeunesse n’est pas un groupe social homogène, mais une période clé durant laquelle s’opère un processus de socialisation et d’apprentissage des rôles d’adultes. Un argument qui revient souvent est l’inexpérience professionnelle des jeunes, ce qui justifierait qu’on leur demande d’occuper des emplois précaires, voire des formes de travail gratuit, pour acquérir cette expérience qui fait défaut et décrocher l’emploi tant désiré. Or, on peut penser que tous ces stages, actions bénévoles, services civiques ou emplois subsidiés, profitent parfois davantage aux employeurs qu’au jeunes eux-mêmes. Les facteurs explicatifs du chômage des jeunes sont aussi à chercher dans les mutations de l’emploi plutôt que dans le profil des jeunes eux-mêmes. L’augmentation massive du chômage, depuis les années 80, a, en fait, généré de nouvelles formes de sélectivité de la part des employeurs.
AÉ: Présenter l’inexpérience des jeunes comme la cause de leur précarité contribue, selon vous, à faire peser sur eux la responsabilité de leur non-employabilité…
CB: Le terme d’«employabilité» exprime bien cette sur-responsabilisation des personnes qui ne parviennent pas à trouver un emploi. Elles sont renvoyées au fait qu’elles ne sont pas suffisamment «désirables» aux yeux des employeurs, comme si le problème du chômage se résumait à ce constat. On se soucie beaucoup des lacunes des jeunes qu’il faut combler, de leur inadaptation au marché du travail qu’il faut corriger, mais qui interroge encore les capacités du marché du travail à employer les jeunes, les chômeurs de longue durée, les personnes peu diplômées, dans de bonnes conditions, tout en répondant aux nouveaux enjeux sociétaux? À mon sens, pas grand monde. Depuis les années 80 et la montée du néolibéralisme, la priorité n’est plus donnée à la protection des chômeurs, mais à leur responsabilisation. Les politiques de l’emploi mettent désormais la pression sur ceux qui cherchent un emploi plutôt que sur les conditions du marché du travail lui-même. De plus, en ciblant les jeunes, ces politiques publiques contribuent parfois à alimenter une forme de stigmatisation de ce groupe d’âge.
Depuis les années 80 et la montée du néolibéralisme, la priorité n’est plus donnée à la protection des chômeurs, mais à leur responsabilisation. Les politiques de l’emploi mettent désormais la pression sur ceux qui cherchent un emploi plutôt que sur les conditions du marché du travail lui-même.
AÉ: Dans un contexte de difficultés accrues à trouver un emploi et de précarité croissante, les attentes des jeunes envers le travail ont-elles diminué?
CB: Les discours publics dépeignent parfois une jeunesse paresseuse, peu autonome et réticente à accepter des conditions de travail jugées «formatrices», une jeunesse qu’il faudrait en quelque sorte «activer» pour la pousser vers l’emploi. Ces représentations imprègnent les politiques publiques, même si elles ne sont étayées par aucun travail empirique. Dans la plupart des pays de l’Union européenne, les aides sociales sont limitées à un seuil d’âge pour ne pas freiner la formation, comme si elles poussaient les jeunes à l’oisiveté! Les jeunes ont de grandes attentes vis-à-vis du travail, sans pour autant vouloir qu’il occupe tout leur quotidien. Ils cherchent une cohérence entre travail, famille et valeurs, sur le plan tant organisationnel que personnel. Dans leur ouvrage Réinventer le travail, Dominique Méda et Patricia Vendramin parlent d’une conception «polycentrique» du travail. Les jeunes recherchent un épanouissement et une stabilité professionnelle, laissant également la place à tout le reste. Il est donc difficile pour eux de se contenter d’emplois par défaut, simplement pour assurer une stabilité financière.
AÉ: Cette stabilité financière, qui devient de plus en plus difficile à atteindre, n’impacte-t-elle pas également la capacité des jeunes à accéder à leur indépendance?
CB: Lorsque les jeunes souhaitent accéder enfin à leur indépendance et sortir du giron familial, beaucoup d’entre eux sont confrontés au fait qu’ils ne peuvent prétendre qu’à des contrats précaires. La difficulté à quitter le foyer familial s’explique en partie par la familialisation des aides économiques, versées à la famille plutôt qu’aux jeunes. Donc, très logiquement, plus la familialisation des aides est poussée, plus l’accès des jeunes aux prestations sociales est limité, freinant leur autonomisation. En Belgique, il existe des aides accessibles aux jeunes, comme l’allocation d’insertion ou le revenu d’intégration sociale, mais les conditions d’octroi se durcissent. Globalement, la jeunesse se caractérise par un accès difficile à la citoyenneté et à la protection sociale, une dépendance familiale et des emplois au statut incertain, entre salariat et travail gratuit.
En Belgique, il existe des aides accessibles aux jeunes, comme l’allocation d’insertion ou le revenu d’intégration sociale, mais les conditions d’octroi se durcissent. Globalement, la jeunesse se caractérise par un accès difficile à la citoyenneté et à la protection sociale, une dépendance familiale et des emplois au statut incertain, entre salariat et travail gratuit.
AÉ: Enfin, êtes-vous optimiste quant à l’évolution de la situation dans les années à venir?
CB: Tant que l’on renoncera à envisager des changements structurels en matière d’accès à l’emploi et de contenu du travail, j’aurai du mal à me montrer vraiment optimiste. Au niveau politique, les tendances actuelles ne sont pas réjouissantes. En Belgique, le gouvernement Arizona engage le pays dans l’austérité avec toute une série de mesures antisociales et de fragilisation du monde du travail; au niveau mondial, l’extrême droite gagne du terrain, les conflits armés se multiplient, l’élection de Trump creuse un fossé entre les États-Unis et l’Europe. En parallèle, nous pouvons espérer que ces situations de crise deviennent le terreau de nouvelles impulsions. Beaucoup d’idées sont d’ailleurs déjà là et n’attendent qu’à être explorées: démocratisation et démarchandisation du travail, garantie emploi, salaire à vie, etc. Il n’est pas juste de confier aux jeunes la responsabilité des changements à venir. Il ne faut pas oublier qu’ils seront les premiers à en vivre les conséquences, en espérant qu’ils ne les subiront pas…