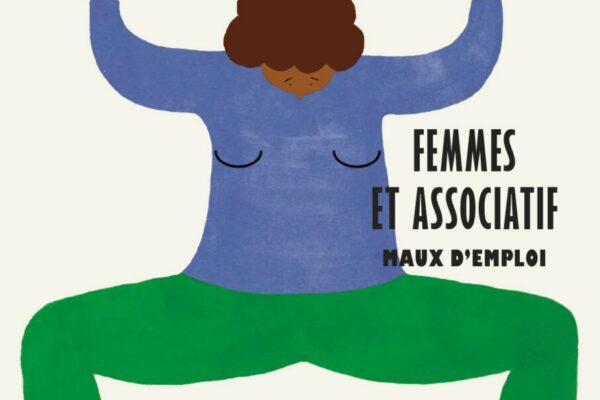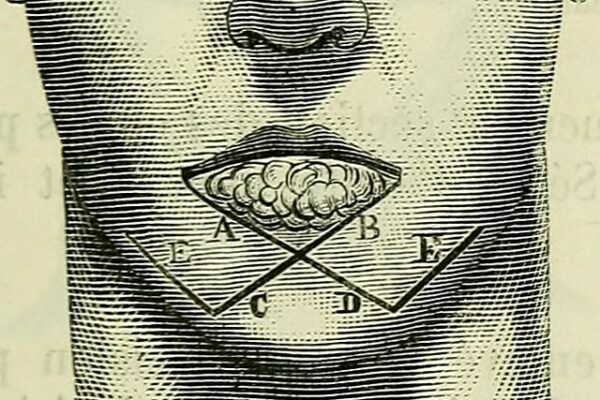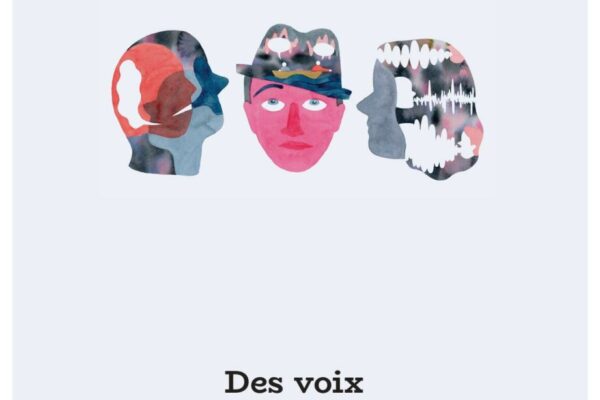Cabossés par la vie, internés par la justice, accablés par cette souffrance intérieure: en Belgique, ils sont des milliers à perdre pied. Et puisqu’ils n’ont plus toute leur tête, les voilà enfermés. Récit en immersion du parcours du combattant de ces malades qui n’ont rien d’imaginaire au cœur de l’hôpital psychiatrique bruxellois Jean Titeca.
Découvrez l’enquête complète de Pierre Vangrootloon « Derrière les murs de la folie » en long-format web.
«Prêt pour l’immersion, j’espère? On a connu quelques moments chauds avec un patient qui a fugué. Mais tout est rentré dans l’ordre, c’est calme en ce moment.» Les mots du chef infirmier Mohamed Stitou réveillent ma tachycardie en cette journée ensoleillée. Après avoir franchi la double porte verrouillée et escaladé un étage, je pénètre dans la section HEGOA (Unité psychiatrique médico-légale) qui se résume à un couloir étroit aux couleurs ternes, héritage d’un passé architectural plutôt austère. C’est là que résident une vingtaine de patients hospitalisés «sous contrainte» et soumis à la loi sur l’internement. À la suite d’une décision rendue par le juge et appuyée par une expertise psychiatrique, le patient est envoyé au sein de l’annexe psychiatrique d’une prison lorsque le nombre de places le permet. Là, il peut y rester jusqu’à deux ans, et parfois même plus, avant d’être transféré dans une unité de soins d’un hôpital psychiatrique. Pour cela, la candidature du patient doit être approuvée par le Centre hospitalier. L’hôpital accueille principalement des psychotiques dont certains ont en plus un handicap mental.
Ici, «contrairement au département des admissions, ça pète rarement», rassure une infirmière expérimentée. Avec ces patients stabilisés et l’atmosphère apaisée qui règne dans l’unité, «il y a la possibilité de construire un vrai projet thérapeutique», poursuit-elle. C’est ainsi qu’un travail au long cours subtil et ardu se dispense en s’appuyant sur une équipe multidisciplinaire (médecins, infirmiers, psychologues, criminos, kinés, ergos…). «On donne du lien social, pas seulement des médocs», souligne Martine, qui prône l’humour au quotidien pour déminer les tensions. Mais la psychiatrie se dessine autour d’une base médicamenteuse. «Ne rien donner, ce serait irresponsable, tonne un membre du nursing (l’ensemble des soins prodigués à des personnes dépendantes). Le but n’est pas de les assommer mais d’atténuer leur souffrance. Et laisser le patient dans une telle détresse, c’est inimaginable.»
D’ailleurs à 17 h 10 ce jour-là, c’est la file pour la distribution des traitements. Baptiste (tous les prénoms ont été modifiés, NDLR), un quadragénaire au crâne rasé, me souffle à l’oreille: «C’est comme Vol au-dessus d’un nid de coucous, tout le monde a besoin de sa dose.» Il souffre de troubles de l’humeur. En phase «haute» comme le décrit le personnel, c’est-à-dire en crise maniaque, son agitation exacerbée et conjuguée à une euphorie et une assurance excessives peuvent désarçonner. Il parle vite, embraye d’un sujet à l’autre. «Allez, viens, on va prendre l’air», m’exhorte-t-il.
Du shit et des frites pour combler l’ennui
Dans le jardin, les relents de cannabis chatouillent rapidement les narines. Serrés à quatre sur un banc, les fumeurs jettent çà et là un coup d’œil furtif aux agents de gardiennage ou aux éducateurs qui encadrent ce périmètre. Baptiste est répertorié comme «consommateur» par les infirmiers. «Ils m’ont déjà chopé mais j’ai juste écopé d’un ‘stop sorties’ de quelques jours. C’est bien plus sévère ailleurs. Dans un autre hosto, pour un joint, c’est retour immédiat en taule», me raconte-t-il en roulant son pétard. «Punir ces comportements de manière radicale, ça n’a pas de sens», souligne un infirmier. Mais il ne s’agit pas là d’indulgence ou de laisser-aller. «Pour bon nombre de patients, cela s’assimile à de l’automédication, cette consommation de stupéfiants leur permet d’atténuer les effets de la maladie.» Pendant ce temps-là, on fait tourner, sans avoir grand-chose à se raconter. «À Titeca, c’est plus facile de trouver du shit que des pommes de terre», lâche Rachid. Les autres n’ont même pas souri. Comme si rien ne pouvait rompre l’ennui.
Baptiste me reprend par la manche, direction la salle de jeux. Une télévision, quelques chaises en plastique sur lesquelles s’enfoncent deux patients au regard absent. Difficile de deviner si c’est le téléfilm allemand diffusé sur La Une qui les met dans cet état. «J’ai fugué il y a quelques jours, me confie-t-il. J’avais envie d’aller loin. Dans le sud de la France ou en Italie. Il fallait que je récupère mon chien chez ma mère mais elle n’était pas là. Le manque de médocs a commencé à se faire sentir aussi. J’ai fini par me rendre à la police, je voulais retourner à l’annexe psychiatrique de la prison de Namur1.» «Ici, la bouffe est vraiment dégueulasse. Là-bas, leurs boulettes-frites sont succulentes», répond-il à mon regard ahuri.
«Contrairement à la prison, ici on ne sait jamais quand on va sortir…»
Cela peut interloquer, mais de nombreux patients vantent le régime carcéral, qu’ils privilégient à cet internement médicalisé. «En prison, on fait ce qu’on veut», rugit Bryan, un jeune bien-portant au regard pénétrant. «Ici, on est totalement infantilisé du matin au soir. Tout est régenté, l’heure à laquelle on se lève, on mange, les activités, etc.», renchérit Hugues, une cigarette roulée au bec, dans un fumoir improvisé au milieu d’une cage d’escalier condamnée, lassé de cette routine quotidienne.
«Le pire, c’est qu’on ne nous donne pas de date de sortie. Contrairement à la prison, ici on sait quand on entre mais jamais quand on va pouvoir sortir définitivement», appuie Mustapha, le doigt en l’air et les sourcils froncés. Le processus judiciaire se révèle lourd et distille des lenteurs parfois insupportables pour les patients, une majorité d’entre eux ne retrouvent d’ailleurs jamais une autonomie complète2.
«Ces malades ont développé une forteresse entre eux et le réel, qu’ils ressentent comme hostile. Notre boulot, c’est d’ouvrir une porte, de tenter de faire cohabiter ces deux ‘’univers’’», image Mohamed Stitou. Et tenter de les faire entrer dans le moule de la société requiert énormément de patience et un encadrement minutieux. «Par leurs comportements, certains se mettent hors la loi parce que leur perception du monde est altérée. Ils ne s’en rendent pas compte, c’est un mécanisme de défense.»
L’eau à la bouche
Le lendemain, je débarque dans le couloir principal où Jean me lance un sourire triste. Potomane, il se balade toujours une bouteille d’eau à la main et en ingurgite plusieurs litres par jour. Sans doute pour noyer ce mal intérieur qui le ronge. «Parfois, il n’ose carrément pas sortir de l’institution. Il dit que le Diable menace de le tuer à l’extérieur. Rien que d’en parler, ça le met en état de panique», m’explique une psychologue.
Émile et Benjamin, eux, se frottent les mains à l’idée de fuir cet univers cloisonné. Inséparables, les Quick et Flupke de l’unité, âgés d’une vingtaine d’années, ne manquent jamais une occasion pour se faire remarquer. Ce matin-là, c’est parti pour l’atelier cuisine, l’occasion de se plaindre du dosage de leur cocktail médicamenteux. «Avec leur truc, je sais plus bouger, c’est trop fort», clame le premier. «Moi, je bavais pendant trois jours», se plaint l’autre.
Face à ces désarrois, «il n’y a pas de formule toute faite, répond le chef infirmier. Avant tout, on veut accompagner le patient à parvenir à vivre avec ce trouble sévère. Mais cela requiert de l’investissement et du temps». Le temps, ils le prennent chaque vendredi lors d’un grand débriefing rassemblant toute l’équipe et organisé afin d’améliorer les protocoles délivrés et de répondre aux revendications. «Il faut trouver des compromis entre ce qu’il nous apparaît nécessaire et les réactions et exigences du patient.»
Au menu du jour: un tajine suivi d’un moelleux au chocolat. De quoi mettre l’eau à la bouche. Marie-Paule, l’infirmière qui dirige l’activité, emmène la bande de six volontaires. Après avoir fait les courses avec un budget serré, ils s’attaquent aux fourneaux dans un appartement aménagé en face de l’hôpital. Les blagues fusent, l’ambiance rappelle une curieuse colonie de vacances. La maladie ne surgit que par petites étincelles. Comme lorsque Jérôme s’étonne: «Elles sont coupées bizarrement, les carottes. Ça me rappelle des choses…»
Passements de jambes
Pour ceux qui ne se sentent pas l’âme d’un «Top Chef», direction le stade Chazal avec les kinés. Histoire de se prendre pour Eden Hazard le temps d’un extérieur du pied en lucarne. Jérôme y démontre des qualités impressionnantes. «J’ai passé des tests dans plusieurs grands clubs de la capitale il y a quelques années. J’aurais rêvé de pouvoir percer mais tout ça c’était avant.» Youss, tout juste débarqué à Titeca, manque, lui, totalement son passement de jambes et se montre apathique sur ce terrain schaerbeekois. «Il est encore un peu stone», me souffle un de ses coéquipiers.
Dans le suivi de certains patients, l’équipe me fait part d’un aveu d’impuissance et d’échec. «Hassan souffre énormément, il souhaiterait l’euthanasie ou au moins retourner en prison. Notre cadre le rend encore plus fou.» Par de petites et multiples attentions, le personnel veille au quotidien à soulager ces paniques et maux intérieurs. Et ce, au fil des années via des méthodes qui s’adoucissent. C’est qu’il y a 25 ans, se rappelle Martine, le protocole était plus rude. «Il y avait beaucoup de violence. Régulièrement, on usait de l’isolement avec contention et, à cause de la mauvaise organisation des horaires des gardes, chaque matin, les patients vivaient un calvaire: on les levait à 6 h et ils se retrouvaient allongés par terre dans le couloir sans café ni nourriture, le temps au personnel de nettoyer leur chambre.»
Désormais, les méthodes du corps hospitalier font preuve de beaucoup plus d’humanité. Et se montrent aussi parfois assez singulières comme l’illustre, ce qu’on appelle en interne, le «budget culturel», réservé à certains patients qui en font la demande. Il s’agit d’une somme de 50 € prélevée de l’argent de poche du malade, et destinée à couvrir les frais de quelques amours vénales, généralement du côté de la rue d’Aerschot près de la gare du Nord.
«C’est vrai que cette initiative peut choquer, souligne une infirmière. Mais il faut savoir qu’une partie de ces individus vivent parfois dans une telle misère affective et sentimentale que cette alternative apparaît comme leur seul moyen d’avoir des relations intimes.» Une pratique tolérée, mais pas encouragée et qui, à l’instar du domaine carcéral ou du secteur handicap2, reste un sujet sensible chez Titeca.
«Chut, plus de bruit, c’est la ronde de nuit!»
C’est mon dernier jour. Ou plutôt ma première nuit chez Titeca où chacun a regagné sa chambre. L’animation habituelle du hall d’entrée s’est évanouie avec les rayons du soleil, quoique… Dans l’unité HEGOA, deux infirmières s’attellent à la préparation des médicaments du lendemain en échangeant quelques boutades. «C’est un autre rythme, un autre rapport aux patients, un fonctionnement totalement différent durant la nuit. Et puis, il y a une grande solidarité entre nous, me souffle la plus âgée des deux. Ce à quoi il faut veiller en priorité? Les suicides!» Pour se prémunir de telles tragédies, chaque heure, elles effectuent une ronde, lampe de poche à la main. Mais au-delà de ces aspects sécuritaires, leur travail consiste aussi et surtout à offrir une disponibilité et une présence rassurante. Des soins éminemment relationnels. Afin de mettre des mots sur les maux…
Pendant qu’Émile s’empiffre de chips aux pickles, Youssef disparaît sous la douche alors que Denis fume une cigarette à la fenêtre. «C’est l’école maternelle aujourd’hui, s’emporte la soignante, ils sont quatre par chambre, le manque d’intimité, ce n’est pas toujours évident à gérer.» Vers 2 h 30, le silence s’est enfin emparé de l’unité. Le cliquetis des serrures, un dernier geste de la main vers ces blouses blanches dans la nuit noire avant un ultime regard vers les murs de l’hôpital balayés par une pluie fine. Je pars. Je quitte ce lieu interlope peuplé d’âmes perdues et de héros ordinaires. Et j’ai un mal de tête de… zinzin.
 Souffrance psychosociale, troubles psychologiques ou psychiatriques… Les travailleurs sociaux des CPAS font état d’une augmentation des problématiques de santé mentale chez leurs bénéficiaires. Face à ces personnes en détresse, ils se sentent dépourvus. Mais on observe aussi sur le terrain que les procédures, compliquées et lourdes à porter, aggravent encore la vulnérabilité des usagers (lire «Souffrances psychiques: l’activation des CPAS montrée du doigt»). Le constat est le même pour les demandeurs d’asile frappés également par un double traumatisme: le parcours d’exil suivi de la violence des procédures. Et, là aussi, les services d’accompagnement peinent à suivre (lire «La procédure d’asile est en soi traumatisante»).Parmi les exclus de la santé mentale, on compte aussi les enfants et les jeunes en détresse psychologique, public fragile s’il en est. L’aide à la jeunesse a décidé de suspendre la couverture des frais alors même que leur placement à l’hôpital a été décidé par… l’aide à la jeunesse (lire «Frais hospitaliers: ces enfants victimes de batailles administratives»). De quoi faire tourner la tête…Un dossier illustré par Philippe Debongnie.
Souffrance psychosociale, troubles psychologiques ou psychiatriques… Les travailleurs sociaux des CPAS font état d’une augmentation des problématiques de santé mentale chez leurs bénéficiaires. Face à ces personnes en détresse, ils se sentent dépourvus. Mais on observe aussi sur le terrain que les procédures, compliquées et lourdes à porter, aggravent encore la vulnérabilité des usagers (lire «Souffrances psychiques: l’activation des CPAS montrée du doigt»). Le constat est le même pour les demandeurs d’asile frappés également par un double traumatisme: le parcours d’exil suivi de la violence des procédures. Et, là aussi, les services d’accompagnement peinent à suivre (lire «La procédure d’asile est en soi traumatisante»).Parmi les exclus de la santé mentale, on compte aussi les enfants et les jeunes en détresse psychologique, public fragile s’il en est. L’aide à la jeunesse a décidé de suspendre la couverture des frais alors même que leur placement à l’hôpital a été décidé par… l’aide à la jeunesse (lire «Frais hospitaliers: ces enfants victimes de batailles administratives»). De quoi faire tourner la tête…Un dossier illustré par Philippe Debongnie.
- En Belgique, plus de 500 personnes auteures d’un crime, mais ayant été reconnues non coupables en raison de leur santé mentale, sont internées en prison. Notre pays a été plusieurs fois condamné par la Cour européenne des droits de l’homme pour traitements inappropriés dans certaines annexes.
- Concernant les individus étrangers en séjour irrégulier, ceux-ci devront rester en institution. Une mesure qui apparaît contradictoire par rapport au trajet de soins défendu par la loi selon de nombreux professionnels du secteur. Lire: «Les internés sans papiers: un no man’s land juridique», Alter Échos n°467, octobre 2018, par Alix Dehin.
- «Assistance sexuelle: les ébats mettent en émoi», Alter Échos n°469, décembre 2018, Manon Legrand.