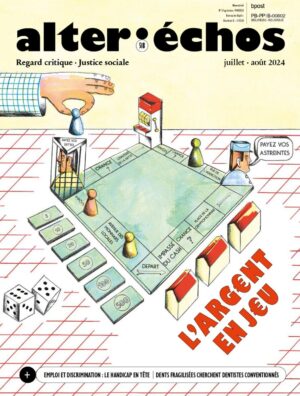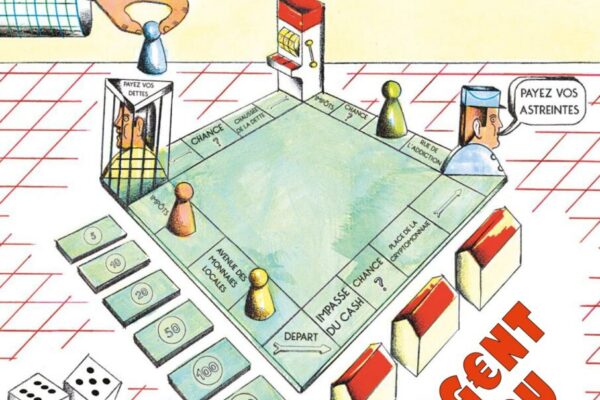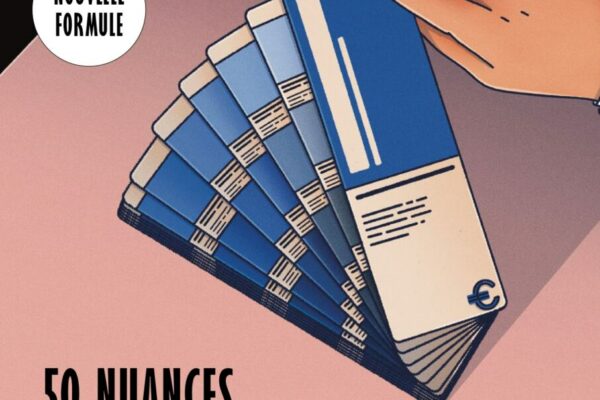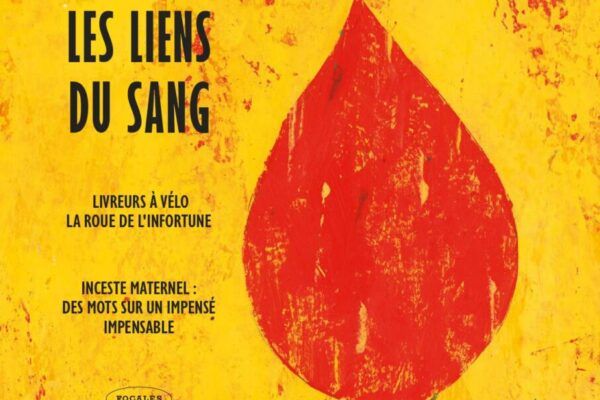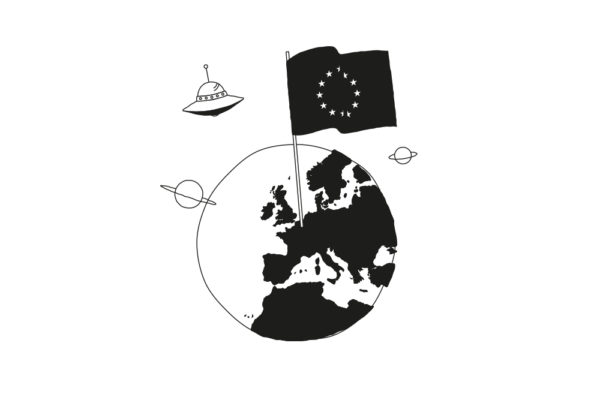En 2019, la Justice sociale s’est invitée au sein de la mobilisation climatique. Virée dans les archives d’Alter Échos, pour qui le lien entre social et environnement n’est pas neuf.
Les personnes en situation de pauvreté contribuent moins que les autres au changement climatique – l’empreinte en CO2 est, par exemple, quatre fois plus élevée chez les 10% les plus riches que chez les 10% les plus pauvres. Elles sont pourtant les premières victimes des phénomènes environnementaux, mais aussi des politiques de transition. «Lors de l’ouragan Katrina, ce sont les pauvres et les Noirs, souvent les mêmes personnes, qui ont été le plus touchés, les quartiers noirs étant souvent situés dans les zones inondables. Cet épisode a révélé la corrélation existant dans les problèmes raciaux et environnementaux», expliquait le sociologueRazmig Keucheyan à Alter Échos en 2015. Des inégalités environnementales qui sont également très présentes dans le contexte postcolonial, comme l’a montré l’exemple du chlordécone, un insecticide très toxique interdit en France, mais qui a continué à être utilisé allégrement dans les Antilles françaises.
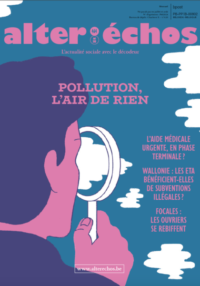 En Europe, les personnes précarisées sont plus exposées à la pollution, que ce soit dans leur quartier, dans leur travail ou dans leur habitat. Pour Catherine Bouland (École de santé publique de l’ULB), interrogée en 2018 pour notre dossier «Pollution, l’air de rien», les inégalités d’exposition à la pollution de l’air sont claires quand on superpose les cartes bruxelloises: «Les personnes plus précaires habitent plus près du trafic. On constate aussi que l’habitat paupérisé se situe à proximité des grandes chaussées, majoritairement dans le croissant pauvre.» Plus touchées par la pollution, les populations précarisées ont aussi moins de moyens d’y «échapper»: moins d’espaces verts dans les quartiers pauvres de la capitale, moins la possibilité d’aller passer le week-end à la campagne ou même de se rendre en classes vertes. Notre dossier mettait aussi en avant les résultats d’une étude française qui montrait que, «si les populations défavorisées ne vivent pas toujours dans les quartiers les plus pollués, elles meurent davantage lors des pics de pollution». En cause? Une superposition des facteurs de risques: peu de prévention en matière de santé, plus de temps dans les transports, mauvaise alimentation, pollution intérieure…
En Europe, les personnes précarisées sont plus exposées à la pollution, que ce soit dans leur quartier, dans leur travail ou dans leur habitat. Pour Catherine Bouland (École de santé publique de l’ULB), interrogée en 2018 pour notre dossier «Pollution, l’air de rien», les inégalités d’exposition à la pollution de l’air sont claires quand on superpose les cartes bruxelloises: «Les personnes plus précaires habitent plus près du trafic. On constate aussi que l’habitat paupérisé se situe à proximité des grandes chaussées, majoritairement dans le croissant pauvre.» Plus touchées par la pollution, les populations précarisées ont aussi moins de moyens d’y «échapper»: moins d’espaces verts dans les quartiers pauvres de la capitale, moins la possibilité d’aller passer le week-end à la campagne ou même de se rendre en classes vertes. Notre dossier mettait aussi en avant les résultats d’une étude française qui montrait que, «si les populations défavorisées ne vivent pas toujours dans les quartiers les plus pollués, elles meurent davantage lors des pics de pollution». En cause? Une superposition des facteurs de risques: peu de prévention en matière de santé, plus de temps dans les transports, mauvaise alimentation, pollution intérieure…
Avoirs, savoirs et pouvoirs
 En Région bruxelloise, la consommation énergétique des bâtiments représente 70% de la consommation globale. Là encore, ce sont les populations précarisées qui paient le prix fort, puisque les logements dont elles sont locataires sont souvent de véritables passoires. En 2014, Alter Échos consacrait un numéro spécial à la précarité énergétique. À ce moment-là, les 10% des ménages les plus pauvres dépensaient presque 15% de leurs revenus en factures d’énergie pour leur logement, contre à peine plus de 2% pour les 10% les plus riches. Une précarité en augmentation puisque, quelques années plus tard, l’Institut wallon de l’évaluation, de la prospective et de la statistique (Iweps) mettait en avant que 7,31% des consommateurs d’électricité avaient été comptabilisés en défaut de paiement en 2017, contre 3,37 en 2007 (lire l’édito que nous consacrions à ce sujet).
En Région bruxelloise, la consommation énergétique des bâtiments représente 70% de la consommation globale. Là encore, ce sont les populations précarisées qui paient le prix fort, puisque les logements dont elles sont locataires sont souvent de véritables passoires. En 2014, Alter Échos consacrait un numéro spécial à la précarité énergétique. À ce moment-là, les 10% des ménages les plus pauvres dépensaient presque 15% de leurs revenus en factures d’énergie pour leur logement, contre à peine plus de 2% pour les 10% les plus riches. Une précarité en augmentation puisque, quelques années plus tard, l’Institut wallon de l’évaluation, de la prospective et de la statistique (Iweps) mettait en avant que 7,31% des consommateurs d’électricité avaient été comptabilisés en défaut de paiement en 2017, contre 3,37 en 2007 (lire l’édito que nous consacrions à ce sujet).
Déchiffrer son contrat d’électricité, le mode d’emploi de sa chaudière ou s’y retrouver dans la multiplicité des acteurs du marché libéralisé: l’énergie est chère mais est aussi une matière bien obscure. Raison pour laquelle ont émergé vers 2010 de nouveaux métiers, aux confins du social et de l’énergie: «tuteurs énergie» au sein des CPAS wallons, «accompagnateurs énergie» dans le milieu associatif, ils accompagnent les ménages précarisés dans la recherche de solutions pour réduire leurs dépenses énergétiques. En 2007, ce sont aussi les groupes «Eco-watchers» qui voient le jour, faisant se rassembler des bénéficiaires de services sociaux wallons afin qu’ils se réapproprient les aspects écologiques et économiques de leur consommation d’énergie. «Le discours d’un expert est souvent fort éloigné de la réalité des gens, expliquait alors Stéphanie de Tiège, de l’asbl Empreintes-CRIE de Namur, dans un Focales consacré au projet. Le projet est une co-construction des participants. Je pars de leurs préoccupations, des difficultés qu’ils rencontrent, des sujets qu’ils ont envie d’aborder. Le but étant de trouver des solutions ensemble.»
Malgré la médiatisation dont les matières environnementales ont été l’objet ces derniers temps, les inégalités dans les connaissances persistent. Une étude de l’Appel pour une école démocratique (Aped) publiée en octobre dernier a montré que les connaissances, la motivation et l’engagement des élèves au sujet des enjeux environnementaux étaient très variables selon les filières d’enseignement. «Ce qu’il faut, c’est une véritable transition de civilisation. En commençant par le système éducatif…déclarait déjà Edgar Morin dans Alter Échos en 2015. Dans nos écoles, on nous enseigne encore à séparer les choses et les disciplines. Nos connaissances sont compartimentées. Or, la complexité du monde s’est accrue avec la mondialisation, jusqu’à rendre certains ‘biens fondés’ totalement imprévisibles. Résultat: nos schémas de pensée s’avèrent de moins en moins capables de traiter les problèmes à la fois dans leur globalité et dans leur rapport avec les parties. Nous avons tout à gagner à relier les connaissances, à favoriser la réflexion autocritique. Mais ce refus de voir la globalité, de constamment séparer l’homme de la nature, l’écologie de l’économie, la finance du social, ça nous rend somnambules…»
«L’éradication de la pauvreté est un objectif en soi du développement durable», a aussi rappelé Ides Nicaise, président du comité de gestion du Service de lutte contre la pauvreté, au cours de la matinée de présentation du rapport bisannuel 2018-2019 consacré à la thématique «durabilité et pauvreté» en décembre dernier. «La participation des personnes en situation de pauvreté à la définition des politiques durables est donc indispensable.» Et le service de lutte contre la pauvreté d’appeler à la création d’une conférence interministérielle (CIM) «développement durable et lutte contre la pauvreté», soulignant qu’il y a «une même urgence pour la lutte contre la pauvreté que pour le climat». Car, à l’heure actuelle, «ce qui est durable, c’est la misère». C’est ce qu’ont martelé des personnes en situation de pauvreté alors qu’on leur demandait de définir le concept de durabilité dans le cadre de la concertation organisée par le service en vue de la rédaction du rapport.