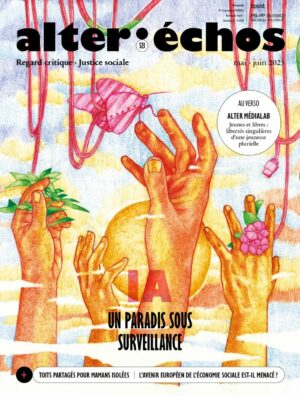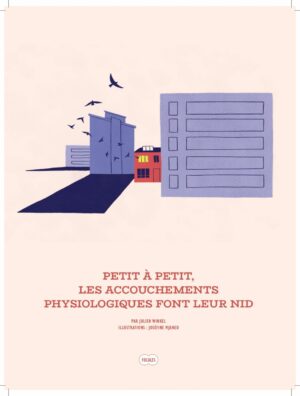Été 2022. Alors que les travaux de la nouvelle usine de l’entreprise pétrochimique Boréalis battent leur plein au port d’Anvers, la presse révèle les conditions de travail déplorables des travailleurs du chantier. Des ouvriers ukrainiens, turcs, philippins et bangladais sont entassés dans de petites chambres, dans des logements insalubres. Ils s’échinent sur le chantier six jours sur sept pendant au moins 10 heures quotidiennes pour un salaire modique de 650 euros mensuels, bien inférieur aux barèmes en vigueur dans le secteur. En cette année de coupe du monde de football, la CSC et la FGTB dénoncent des situations «d’esclavage» comparables à l’exploitation d’ouvriers asiatiques au Qatar. Deux ans plus tard, un juge d’instruction mène l’enquête. Plusieurs dizaines de travailleurs, philippins et bangladais pour l’essentiel, pourraient avoir été victimes de «traite des êtres humains».
Dans les articles de presse, c’est le «détachement des travailleurs» qui est alors pointé du doigt comme ayant favorisé ces pratiques présumées criminelles. «Le détachement est privilégié par des entreprises désireuses de frauder, car ce mécanisme est tellement complexe, avec de longues chaînes de sous-traitance, qu’il favorise de telles pratiques», affirme Jan Buelens, l’avocat de 17 ressortissants bangladais, de 77 turcs et 12 ukrainiens.
Une réforme pas si ambitieuse
En temps normal, le détachement des travailleurs est censé fluidifier, au sein de l’Union européenne, la «libre circulation des services». Une entreprise d’un pays «A» peut envoyer ses employés dans un pays «B» pour qu’ils y remplissent des missions temporaires, de construction, de nettoyage, d’informatique ou de spectacle vivant, limitées à 18 mois. Le principe du détachement, imaginé en 1996, est le suivant: les travailleurs détachés sont payés au tarif de leur pays d’accueil, mais restent assujettis au régime de sécurité sociale de leur pays d’origine.
Vu de loin, le détachement des travailleurs n’est qu’une goutte d’eau dans le monde du travail européen. Avec 1,9 million de personnes détachées en 2021, ces travailleurs en mission temporaire représentaient moins de 1% de l’ensemble de la force de travail européenne. Les principaux pays receveurs de détachés sont l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique et la France alors que les principaux pourvoyeurs sont la Pologne, l’Allemagne, la Lituanie et la Roumanie.
Vu de près, on se rend compte que le détachement est un phénomène d’ampleur dans certains secteurs et pays. En Belgique, 39% des détachements concernaient, en 2022, le secteur de la construction. Environ un cinquième des équivalents temps pleins de ce secteur sont des travailleurs détachés.
La réglementation est très complexe et, depuis les années 2000, le détachement est à la fois au cœur de fantasmes – «l’invasion» du plombier polonais – et de scandales bien réels, particulièrement dans le secteur de la construction. «Le détachement est devenu un business model pour envoyer des travailleurs flexibles et précaires un peu partout en Europe», atteste Tom Deleu, secrétaire général de la Fédération européenne des travailleurs du bâtiment et du bois. La crainte du «dumping social» ne date pas d’hier. L’exploitation de travailleurs roumains ou polonais dans les années 2010 n’a cessé d’alimenter la crainte d’une concurrence «déloyale» d’entreprises issues de l’Est, qui viendraient éroder les droits et conditions de travail à l’Ouest.
Vu de loin, le détachement des travailleurs n’est qu’une goutte d’eau dans le monde du travail européen. Avec 1,9 million de personnes détachées en 2021, ces travailleurs en mission temporaire représentaient moins de 1% de l’ensemble de la force de travail européenne. Les principaux pays receveurs de détachés sont l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique et la France alors que les principaux pourvoyeurs sont la Pologne, l’Allemagne, la Lituanie et la Roumanie.
Face aux polémiques à répétition, la Commission européenne a proposé, en 2018, une refonte de la directive européenne sur le détachement des travailleurs. Une réforme armée d’un slogan: «À travail égal, salaire égal». Car le détachement, s’il obligeait les entreprises à payer les employés selon les salaires en vigueur dans le pays d’accueil, n’empêchait pas de leur verser le salaire minimal du secteur. Ainsi, un ouvrier spécialisé roumain pouvait être détaché en Belgique et ne recevoir qu’une fiche de paie de manœuvre, dont le salaire est inférieur d’environ 20% à celui réellement en vigueur pour son niveau de compétences. Par ailleurs, le détaché ne touchait alors aucune des primes – 13e mois, sursalaire, mobilité – dont jouissaient les autres travailleurs sur le sol belge, accroissant encore un peu plus l’écart entre rémunération des locaux et des détachés.
Avec la directive révisée, le détaché doit être payé au barème en vigueur pour son niveau de compétence et le travail réellement effectué – l’ouvrier qualifié ne peut plus être payé comme manœuvre. Il devra de surcroît toucher les mêmes primes que le travailleur local. Enfin, le transport et le logement de l’employé détaché ne pourront plus être déduits du salaire du travailleur.
Voilà pour les améliorations théoriques, mais, en pratique, «ces modifications n’ont rien résolu, il y a des règles, mais pas assez de contrôles et très peu de sanctions», regrette Laetitia Baldan, secrétaire internationale de la CSC. D’abord parce que ces nouvelles règles européennes étaient déjà, pour la plupart, d’application en Belgique avant la réforme. Ensuite, «cette nouvelle directive passe complètement à côté de la cible», regrette Alexandre Govaerts, du service d’études de la centrale FGTB.
Vu de près, on réalise que le détachement est un phénomène d’ampleur dans certains secteurs et pays. En Belgique, 39% des détachements concernaient, en 2022, le secteur de la construction. Environ un cinquième des équivalents temps pleins de ce secteur sont des travailleurs détachés.
La cible manquée, particulièrement dans le secteur de la construction, c’est le contournement des règles. Les faux détachements. Les fraudes qui visent à échapper au paiement des cotisations sociales. Les heures non déclarées. Les ouvriers sous-payés. Les chaînes opaques de sous-traitance. «Comparativement aux autres secteurs industriels, dans le secteur de la construction, les coûts du travail représentent une part un peu plus substantielle des coûts de production, détaille Alexandre Govaerts. Les entreprises cherchent à réduire ces coûts pour décrocher des marchés et s’appuient sur le détachement. Des entreprises utilisent toutes les failles légales pour procéder à de la fraude salariale ou sociale. La récente modification de la directive sur le détachement des travailleurs n’a pas changé grand-chose à cet égard.»
Car, face à un marché des services libre et ouvert, on trouve des entreprises qui s’engouffrent dans les failles d’une réglementation très complexe et des services d’inspection nationaux fragmentés et pas toujours coopératifs, malgré les ponts que tente de jeter l’Agence européenne du travail. «Cela fait des années qu’un problème persiste: la méfiance entre institutions. Grâce à l’Agence européenne, les services d’inspection se parlent, se rencontrent. La situation s’améliore petit à petit, mais ce n’est pas suffisant», confirme Bruno De Pauw, du département des relations internationales de l’ONSS.
66%
L’affaire Boréalis symbolise à l’extrême les abus auxquels peut conduire le détachement, lorsqu’il se joue des règles en vigueur. On y trouve des galaxies de sous-traitants, des employeurs sans scrupules, des hommes de paille et des schémas de financements opaques. Dans ce cas précis, l’appel d’offres lancé par Boréalis pour la construction de son nouveau site industriel a été remporté par un consortium franco-italien – Irem-Ponticelli. C’est ce duo qui décide de sous-traiter une partie du travail à une succursale roumaine. Celle-ci se tourne notamment vers «Raj Bahr engineering», sorte d’agence d’intérim internationale, pour qu’elle convoie des travailleurs depuis l’Asie vers l’Europe. Raj Bahr possède des bureaux au Bangladesh, en Croatie, en Pologne et au Portugal. Une dizaine de travailleurs bangladais ont pu dégotter, via l’agence, un permis de travail et un permis de séjour douteux en Hongrie, où les travailleurs ont attendu des semaines, entassés, avant de se déplacer vers Anvers avec, pour certains, un arrêt au Portugal. La chaîne de sous-traitance, le caractère transnational des infractions, l’existence d’une agence d’intérim sans activité réelle dans la construction rendent ce type d’enquêtes particulièrement complexes pour les services d’inspection, l’auditorat du travail et les juges d’instruction. «Aujourd’hui, il n’y a pas de chantiers sans travailleurs détachés, explique Didier Godechoul, directeur de la direction «dumping social» à l’Office national de sécurité sociale. Les activités ne sont pas toujours illégales, mais beaucoup d’anomalies sont constatées, dans un secteur historiquement à risque lorsqu’on parle de fraude et de travail non déclaré.»
«Aujourd’hui, il n’y a pas de chantiers sans travailleurs détachés. Les activités ne sont pas toujours illégales, mais beaucoup d’anomalies sont constatées, dans un secteur historiquement à risque lorsqu’on parle de fraude et de travail non déclaré.»
Didier Godechoul, directeur de la direction «dumping social» à l’Office national de sécurité sociale
Dans une récente étude d’évaluation de la directive sur le détachement des travailleurs, commandée par la Commission européenne et publiée en avril 2024, on découvre que lors d’inspections menées sur chantier en Belgique, des infractions aux règles du détachement ont été constatées, en 2021, dans… 66% des cas. Un chiffre massue. Ces 66% couvrent des irrégularités très variées aux degrés de gravité divers. Un trop-plein d’heures supplémentaires; des primes de détachement en liquide, donc exemptées de toute cotisation; de faux formulaires de détachement; le non-paiement des cotisations sociales en Belgique lors de faux détachements et, dans des cas extrêmes, de la traite des êtres humains. Du côté des «patrons», on tempère le constat. Domenico Campogrande, directeur général de la Fédération de l’industrie européenne de la construction (FIEC), rappelle que les règles «relatives au détachement et les législations sociales nationales sont très complexes. Les irrégularités couvrent parfois des fraudes, certes, mais aussi des erreurs dues à un manque d’information dans le pays d’origine sur les législations en vigueur dans le pays de destination».
Libre circulation des services et avantage compétitif
Le détachement des travailleurs n’est pas qu’un outil détourné à des fins de «dumping social». Pour Domenico Campogrande, le détachement est une réponse utile aux besoins de main-d’œuvre dans des secteurs comme la construction. «Car c’est un secteur qui nécessite de la mobilité, de la flexibilité, pour répondre à des délais stricts, surtout dans un contexte de pénurie de main-d’œuvre.»
Historiquement, le détachement est souvent considéré comme un «compromis» tacite décroché en vue de l’entrée des nouveaux États membres de l’ancien bloc de l’Est dans l’Union européenne. Ces derniers ouvraient leur marché aux entreprises de l’Ouest et obtenaient, en «échange», via leurs travailleurs, un «avantage compétitif» à l’Ouest grâce au détachement. Le tout permettant d’alimenter leurs caisses de sécurité sociale et de garantir un flux de devises, via de l’épargne, des transferts d’argent ou tout simplement par l’impôt, car le travailleur détaché continue d’être fiscalement lié à son pays d’origine pendant 183 jours.
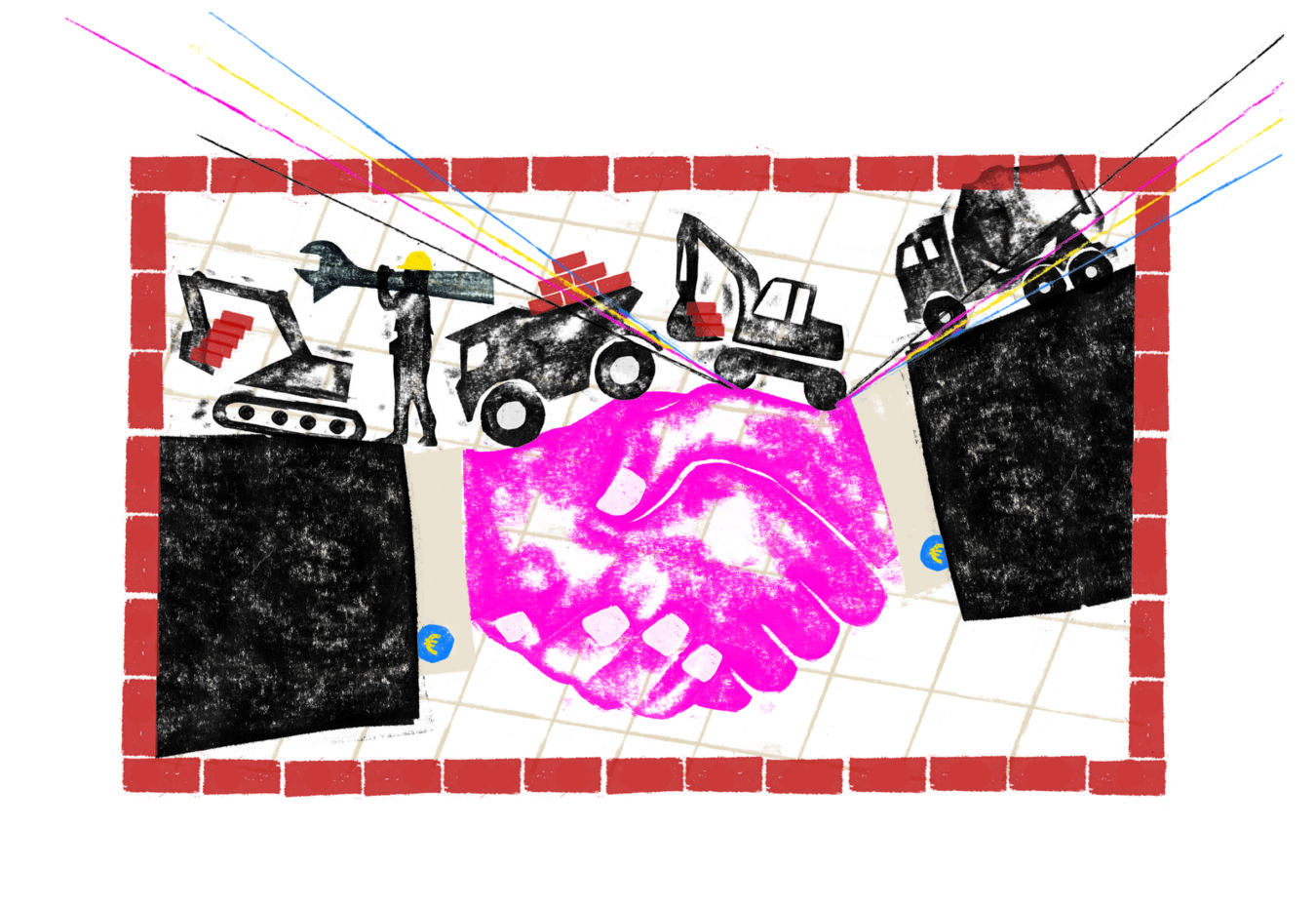
C’est le différentiel de «coût du travail» qui est censé rendre attractif le détachement pour les entreprises. «Le détachement permet d’embaucher des travailleurs dans des pays où les cotisations patronales et sociales sont plus basses, ce qui offre un avantage compétitif, même si celui-ci est à nuancer», reconnaît Domenico Campogrande. Il est très difficile de comparer les différents niveaux de cotisations sociales entre pays tant ils varient en fonction de la taille de l’entreprise et des statuts des travailleurs. Dans une étude de la KULeuven, coordonnée par Frederic De Wispelaere, on découvre qu’aux 27% de cotisations sociales patronales en vigueur en Belgique en 2021 correspondaient des taux de 22% au Portugal, de 16% en Pologne et en Slovénie et de 1,79% en Lituanie. «Si on prend en compte le fait que le logement et le transport des travailleurs détachés sont censés être à la charge de l’employeur et pas déduits du salaire de l’employé, alors l’avantage concurrentiel est sérieusement rogné. C’est là que certaines entreprises entrent dans des logiques de dumping social, de fraude», explique Bruno De Pauw. On coupe alors dans les salaires et on augmente le temps de travail, en débordant du cadre légal.
De plus en plus de travailleurs de pays tiers et de faux indépendants
Un chantier à Etterbeek, en 2020. On y trouve des travailleurs ukrainiens et biélorusses payés 6 euros de l’heure, 55 heures par semaine. Ils sont détachés depuis la Lituanie par une entreprise sans réelle activité dans ce pays. Leur donneur d’ordre est une société située en Belgique, elle-même sous-traitante d’une autre entreprise ayant signé un contrat avec un entrepreneur belge. Ce dernier a pignon sur rue dans notre pays et ferme les yeux. Le cas n’est pas fictif. Il confirme une réalité déjà soulignée par les académiques: c’est lorsque les travailleurs proviennent de pays aux très bas salaires que le risque d’abus est le plus grand. Dans l’étude de Frederic De Wispelaere, on découvre que le salaire minimum d’un travailleur bulgare en 2021 était de 332 euros, environ cinq fois moins que le salaire minimum belge. Les travailleurs bulgares sont considérés comme «à risque» dans les chaînes de sous-traitance et de détachement. Car ils seront plus enclins à accepter un salaire de 900 ou 1.000 euros mensuels en Belgique, bien plus élevé qu’en Bulgarie, alors que ces tarifs illégaux sont bien inférieurs à ceux pratiqués sur notre territoire. Cette gradation du «risque» se trouve encore accentuée dans le cas des travailleurs détachés issus de pays tiers; qui viennent donc de l’extérieur de l’UE. Ceux-ci peuvent être détachés à partir d’un pays du marché unique à condition qu’ils y aient acquis un titre de séjour et un permis de travail. Dans une étude de la chercheuse en économie Mathilde Muñoz sur le travail détaché en France, on apprend que les travailleurs bosniens détachés depuis la Slovénie gagnaient en moyenne deux euros par heure de moins que les travailleurs détachés slovènes.
Historiquement, le détachement est souvent considéré comme un «compromis» tacite décroché en vue de l’entrée des nouveaux États membres de l’ancien bloc de l’Est dans l’Union européenne. Ces derniers ouvraient leur marché aux entreprises de l’Ouest et obtenaient, en «échange», via leurs travailleurs, un «avantage compétitif» à l’Ouest grâce au détachement.
En Belgique, 26% des détachés dans le secteur de la construction sont issus d’un pays hors de l’UE –, Brésil, Ukraine, Biélorussie. Ces travailleurs sont «encore plus flexibles et vulnérables que les détachés européens», insiste Tom Deleu. Des accords bilatéraux entre pays aux forts liens historiques ou économiques ouvrent des portes au Portugal pour des ressortissants brésiliens ou angolais, en Slovénie pour des Bosniens, en Pologne et Lituanie pour des Biélorusses ou des Ukrainiens. Des entreprises «intermédiaires», bien intégrées dans les chaînes de sous-traitance, organisent le détachement de ces ressortissants, parfois directement à partir du Brésil ou de la Bosnie-Herzégovine, via le Portugal ou la Slovénie, vers la Belgique, la France ou l’Allemagne. Ces détachés d’un nouveau genre se retrouvent souvent isolés sur les chantiers, en situation précaire et sont peu enclins à protester contre leurs conditions de travail, car, malgré tout, leur salaire reste très attractif. «Ces pratiques n’ont rien à voir avec le détachement, enchaîne Tom Deleu. Normalement un travailleur détaché doit avoir un lien préalable avec son entreprise, elle-même doit être insérée dans son marché national; là, des agences d’intérim qui n’ont rien à voir avec la construction embauchent dans le but de détacher à partir d’un pays ‘d’origine’ – par exemple le Portugal – où ces travailleurs n’ont parfois jamais mis les pieds.»
À côté des détachés des pays tiers, on trouve sur les chantiers de plus en plus de travailleurs détachés «indépendants», souvent suspectés de n’avoir d’indépendance que le nom. S’il est possible pour un indépendant d’être formellement détaché, les dispositions salariales de la directive sur le détachement ne s’appliquent pas à ces travailleurs censés fixer eux-mêmes leurs taux horaires et leurs cadences de travail. Ils devraient être leurs propres patrons. «Mais en général ils viennent à plusieurs, ils ont un responsable et un seul client, donc ce sont de faux indépendants», assène Salvadore Alonso Merino, responsable syndical principal à la CSC, à Liège. C’est ce que confirme Gianni De Vlaminck, secrétaire fédéral «construction» de la FGTB: «Il y a des ouvriers qui ne savent même pas qu’ils sont indépendants et le découvrent en cas de problème ou d’accident.» Alors qu’en 2022, en Belgique, 16% des travailleurs détachés l’étaient sous le statut d’indépendant, ce pourcentage grimpe à environ 30% dans le secteur de la construction. Parmi eux, combien d’indépendants de façade? Impossible à savoir. C’est ce que dit Alban Janvier, de l’Institut national d’assurances sociales pour travailleurs indépendants: «Il y a bien des contrôles sur chantier pour vérifier que les indépendants ne sont pas de faux indépendants, mais il est très difficile de prouver un lien de subordination entre un travailleur et une entreprise, surtout lorsqu’il n’y a pas de plainte.»
Dans l’enchevêtrement de la sous-traitance
Un jugement du tribunal de première instance francophone de Bruxelles du 17 octobre 2023 montre l’étendue potentielle des fraudes. Plus de 80 travailleurs étaient alors embauchés sur le chantier du Centre hospitalier Jean Titeca à Etterbeek. Ces ouvriers étaient détachés par une société portugaise, au dernier échelon d’une chaîne de cinq entreprises sous-traitantes. Il s’agissait de Brésiliens, payés environ 10 euros l’heure contre les 17 prévus par le barème. Certains avaient été embauchés en Belgique. Et presque tous étaient munis de faux titres de séjour portugais et de faux formulaires de détachement, le formulaire «A1». Ce document, essentiel, prouve l’assujettissement à la sécurité sociale du pays d’origine. Le hic, c’est que ce formulaire est facilement falsifiable, et souvent falsifié, selon plusieurs sources contactées à l’ONSS. En se munissant de faux A1, les employés, sur demande de leur patron, tentent d’éviter tout versement de cotisations sociales. Et si les règles du détachement ne sont pas respectées sur les chantiers belges, c’est en Belgique que ces cotisations devraient être versées.
Aujourd’hui, les syndicats et fédérations patronales plaident pour rendre obligatoire l’obtention du formulaire A1 avant tout détachement, car il est aujourd’hui toléré que les autorités du pays d’origine ne le produisent qu’après le début d’une mission de détachement. Et sans ce formulaire, le travailleur passe à travers les mailles du filet, il n’est assujetti nulle part. Les syndicats réclament aussi que tout octroi, préalable au détachement, de formulaire A1 soit inscrit dans une base de données numérique partageable à l’échelle européenne. Mais au niveau de l’UE, les discussions s’enlisent autour du statut de ce document. La réforme du règlement de coordination des systèmes de sécurité sociale achoppe, notamment sur ce point, depuis 2016. Certains États, comme la Roumanie, sont réticents.
Les travailleurs bulgares sont considérés comme «à risque» dans les chaînes de sous-traitance et de détachement. Car ils seront plus enclins à accepter un salaire de 900 ou 1.000 euros mensuels en Belgique, bien plus élevé qu’en Bulgarie, alors que ces tarifs illégaux sont bien inférieurs à ceux pratiqués sur notre territoire. Cette gradation du «risque» se trouve encore accentuée dans le cas des travailleurs détachés issus de pays tiers, qui viennent donc de l’extérieur de l’UE.
Même lorsqu’un formulaire A1 est délivré en bonne et due forme par le pays d’origine, rien ne prouve que les règles du détachement soient respectées. Pour détacher des travailleurs, une entreprise est censée réaliser au moins 25% de son chiffre d’affaires dans le pays où son siège social est situé. Sans cela, le détachement est irrégulier, dès lors, le formulaire A1 doit être rendu caduc et les cotisations sociales devraient être payées en Belgique. Mais comment vérifier que 25% de l’activité d’une entreprise a bien lieu dans le pays d’origine? Se pose à nouveau la question de la coopération entre services, comme en témoigne Bruno De Pauw: «Comment cette activité est-elle mesurée dans le pays d’origine? En allant explorer des données authentiques ou par la consultation d’un simple questionnaire? Les administrations sont souvent de bonne foi, mais ont-elles les moyens de contrôler cette activité, ont-elles le personnel? Y a-t-il des banques de données fiables? Des possibilités d’envoyer des inspecteurs?» Des entrepreneurs belges sont parfois tentés de créer des sociétés fictives, en Slovénie, en Slovaquie ou en Roumanie, dans le seul but de bénéficier de taux de cotisations sociales moins élevés grâce au détachement. Ces sociétés «boîtes aux lettres» sont dans le collimateur des autorités, car elles n’ont pas d’activité réelle dans ces pays, alors qu’il s’agit d’une des conditions pour détacher un travailleur.
Sibille Boucquey est premier substitut à l’auditorat de Bruxelles. Comme les autres magistrats de l’auditorat de Bruxelles, elle traque les escroqueries au droit pénal social, qui visent notamment «à ne pas payer de cotisations sociales ou à ne pas les payer en Belgique alors qu’elles le devraient»; c’est le cas par exemple si de faux formulaires A1 sont produits ou si l’entreprise qui détache n’a pas d’activité dans le pays d’origine du travailleur. À ses yeux, la situation sur le terrain n’évolue pas favorablement. Les chaînes de sous-traitance, parfois gigantesques, Sibille Boucquey tente de les remonter, du pays d’origine jusqu’aux entreprises belges tout en haut de la pyramide, afin d’engager leur responsabilité. Mais la tâche est ardue. Il faut coopérer avec les services étrangers, pas toujours volontaires, obtenir des témoignages, suivre les flux financiers, trouver les donneurs d’ordre. Les entrepreneurs belges sont généralement protégés, car la loi, lorsqu’il s’agit de récupérer le paiement des rémunérations dues aux travailleurs, n’implique la responsabilité directe d’une entreprise que pour le premier maillon de la chaîne de sous-traitance. «Alors qu’il y a parfois quatre ou cinq échelons de sous-traitance», regrette Sibille Boucquey. Pourtant, ces entreprises belges, «si elles ne sont pas les organisatrices directes des infractions, elles sont au moins au courant de la façon dont tout cela fonctionne». «Plus on descend la chaîne de sous-traitance, plus les risques d’abus sont importants», disent en chœur les syndicats. Une «lasagne qui permet de dissoudre les responsabilités», ajoute Didier Godechoul. Et même en cas de condamnation d’une entreprise, «il est quasiment impossible de récupérer les actifs à l’étranger, regrette-t-il. Le recouvrement d’actifs est déjà très difficile en Belgique, il l’est encore plus en Roumanie. Cela coûte trop cher et cela demande trop de temps. En général la société fautive a eu le temps de disparaître. Il y a une véritable impunité. C’est la manière dont le détachement est organisé qui fait l’illégalité du phénomène. Et pourtant cela coûte des millions à la sécurité sociale belge».
Des entrepreneurs belges sont parfois tentés de créer des sociétés fictives, en Slovénie, en Slovaquie ou en Roumanie, dans le seul but de bénéficier de taux de cotisations sociales moins élevés grâce au détachement. Ces sociétés «boîtes aux lettres» sont dans le collimateur des autorités, car elles n’ont pas d’activité réelle dans ces pays, alors qu’il s’agit d’une des conditions pour détacher un travailleur.
Les syndicats ne souhaitent pas éliminer le détachement, mais réclament de mieux le réguler en limitant les chaînes de sous-traitance à trois échelons, en demandant l’embauche de personnel d’inspection, en interdisant les agences d’intérims spécialisées dans le détachement tout en réclamant la délivrance obligatoire préalable d’un formulaire A1. Les fédérations d’entrepreneurs – Embuild en Belgique et la FIEC au niveau européen – soutiennent certaines de ces mesures. «Les employeurs de la construction ont toujours été des précurseurs dans la lutte contre le dumping social, nous écrit Embuild. Ce phénomène crée de la concurrence déloyale.» Mais à la CSC, Cihan Durmaz, secrétaire de la CSC bâtiments, industries, énergie à Bruxelles, ne l’entend pas de cette oreille: «Embaucher des travailleurs détachés est devenu une condition inévitable pour soumettre une offre. Les entreprises sont en compétition, et le détachement leur permet de tirer les prix vers le bas et de gagner des marchés. La construction n’est pas un secteur délocalisable. Alors c’est la main-d’œuvre qu’on délocalise.»
LE RÉSUMÉ
• Au sein de l’Union européenne, le détachement des travailleurs permet à une entreprise d’un pays «A» d’envoyer ses employés dans un pays « B » pour y remplir des missions temporaires.
• En 2018, une refonte de la directive européenne sur le détachement des travailleurs a eu lieu. But de l’opération : permettre aux travailleurs détachés de bénéficier des mêmes rémunérations que les travailleurs locaux.
• Malgré cela, dans le secteur de la construction, l’écheveau des sous-traitances, la fragmentation des contrôles ou encore la complexité de règles, rendent le contournement de celles-ci aisées, ouvrant la voie au dumping social.