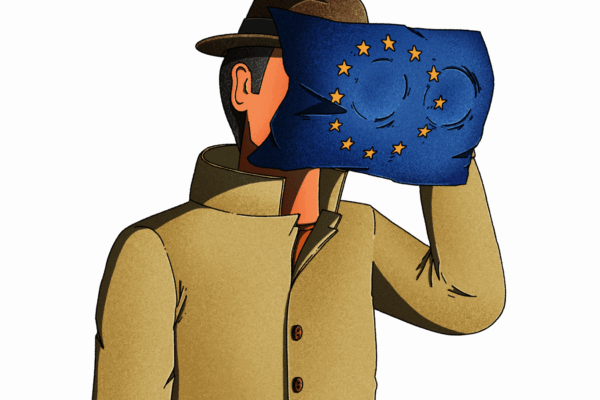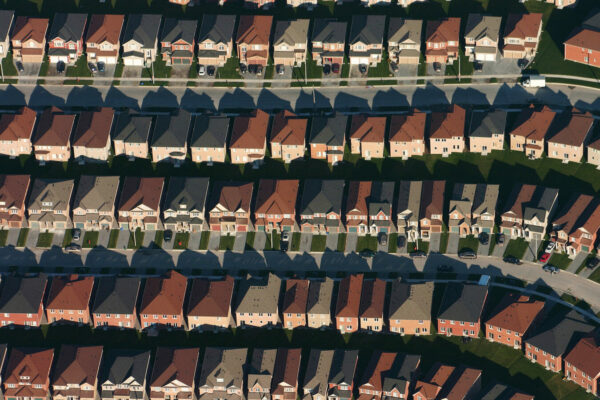Alter Échos: Un enfant sur sept vit dans la pauvreté en Belgique. Comment appréhendez-vous ces chiffres?
Solayman Laqdim: Cela fait près de 20 ou 25 ans que je travaille au sein de secteurs dédiés à l’accompagnement de publics particulièrement vulnérables. Cette situation ne me surprend donc pas, car j’ai toujours été confronté à la pauvreté et à la grande précarité. Ce qui demeure en revanche très préoccupant, c’est de constater la dégradation continue des conditions de vie et la manière dont, à chaque étape, un nouveau seuil est franchi.
À Bruxelles, on voit aujourd’hui des familles avec enfants contraintes de vivre dans la rue, une situation qui n’existait pas auparavant. Même cette réalité, nous ne parvenons plus à l’éviter. Ce que l’on évoque souvent sous le terme «pauvreté infantile» ne décrit pas uniquement une difficulté matérielle. En réalité, ces enfants ne sont pas intrinsèquement pauvres, mais grandissent dans des familles confrontées à des situations de pauvreté. C’est cette dimension globale qu’il faut désormais prendre en compte. Il est évident que l’absence de moyens financiers complique tout. On mesure déjà combien la pauvreté peut freiner un parcours scolaire ou affecter la santé des enfants. Mais lorsque l’on n’a pas d’argent, il devient aussi impossible d’accéder à l’offre culturelle, sportive ou aux structures d’accueil de la petite enfance. En réalité, la pauvreté empêche l’exercice même des droits garantis par la Convention internationale des droits de l’enfant. C’est, à mes yeux, la priorité absolue en Belgique. Par ailleurs, il existe un écart inacceptable entre les principes affirmés par le législateur et leur mise en œuvre sur le terrain.
AÉ: Comment est-il possible d’enrayer cette spirale?
SL: La prévention et la mise en œuvre de politiques sociales ambitieuses en amont constituent une priorité. Le lien entre l’accès à un logement décent et la bascule dans la pauvreté est désormais bien documenté. Certains publics identifiés comme à risque, tels que les familles monoparentales – en particulier les mères seules, qui encourent un risque de pauvreté quatre fois plus élevé –, ou les jeunes sortant de l’aide à la jeunesse, pour qui un quart se retrouvent sans domicile fixe dans les deux ans suivant leur majorité, nécessitent une attention particulière.
À Bruxelles, on voit aujourd’hui des familles avec enfants contraintes de vivre dans la rue, une situation qui n’existait pas auparavant. Même cette réalité, nous ne parvenons plus à l’éviter.
Il s’agit de développer de véritables réponses solidaires, plutôt que d’affaiblir encore des acquis déjà fragilisés. Lorsque l’État se retire de ses responsabilités en matière de solidarité, d’autres acteurs prennent le relais, qu’il s’agisse de religieux ou de réseaux criminels, lesquels savent parfaitement comment les approcher ou les recruter.
AÉ: Vous évoquez la situation dramatique de certains enfants à Bruxelles…
SL: J’ai été témoin d’un enfant de 9 ans dormant seul dans la rue, ainsi que de jeunes filles de 12 ou 13 ans se prostituant. Il est inconcevable que de telles situations existent dans la capitale de l’Europe. Outre les fusillades médiatisées, une misère profonde sévit. Pour beaucoup de ces enfants, l’absence d’espoir conduit à une bascule dramatique.
AÉ: Les institutions censées protéger ces enfants sont elles-mêmes fragilisées…
SL: Un mouvement très offensif et agressif se manifeste à l’égard des institutions, des services publics et de la solidarité, au point que ces notions sont presque considérées comme des gros mots. Ce courant, nourri par un discours politique et idéologique prônant la responsabilisation individuelle et la réduction du rôle de l’État, fragilise profondément les structures publiques. Le risque majeur réside dans l’affaiblissement de ces structures, qui finissent par se replier sur elles-mêmes et perdre de vue leur mission première. Prenons l’exemple des services d’aide à la jeunesse (SAJ) ou des services de protection de la jeunesse (SPJ): le manque et la rotation de personnel compromettent l’efficacité de ces services, suscitant de l’agressivité, voire des comportements protectionnistes. Ce cercle vicieux conduit à une forme de maltraitance institutionnelle, qui, paradoxalement, justifie la désagrégation progressive de ces institutions. En somme, c’est un serpent qui se mord la queue.
AÉ: Vous évoquez un cercle vicieux de maltraitance institutionnelle. Concrètement, quel impact cela a-t-il sur les jeunes que ces services sont censés accompagner?
SL: La situation est préoccupante. L’état de santé mentale de la jeunesse est alarmant, avec une augmentation de 60% de la consommation d’antidépresseurs chez les 12-18 ans en seulement deux ans. Un enfant sur dix envisage le suicide, ce qui en dit long sur notre société. Nous sommes proches d’une véritable épidémie de troubles mentaux. J’aimerais que la santé mentale des jeunes devienne une cause nationale, à l’instar de la France.
Un mouvement très offensif et agressif se manifeste à l’égard des institutions, des services publics et de la solidarité, au point que ces notions sont presque considérées comme des gros mots. Ce courant, nourri par un discours politique et idéologique prônant la responsabilisation individuelle et la réduction du rôle de l’État, fragilise profondément les structures publiques. Le risque majeur réside dans l’affaiblissement de ces structures, qui finissent par se replier sur elles-mêmes et perdre de vue leur mission première.
Les jeunes soulignent un contexte global défavorable qui les empêche de se projeter: peu de perspectives professionnelles, une écoanxiété grandissante, des conflits aux frontières de l’Europe. Le futur apparaît de plus en plus inquiétant. De plus, et on le sait, des liens étroits existent entre santé mentale et pauvreté, genre ou migration.
AÉ: Dans ce contexte difficile, la participation comme la prise de parole des jeunes est souvent présentée comme un levier d’amélioration. Qu’en est-il dans la réalité?
SL: Tout le monde s’accorde à reconnaître l’importance de la parole des jeunes, mais rares sont ceux qui s’emploient réellement à la recueillir et à lui donner un pouvoir d’action. Trop souvent encore, cette parole reste décorative ou symbolique, relevant davantage de la mise en scène que d’une réelle participation. Longtemps, les enfants ont été considérés comme des objets de droit. Le terme même «enfant», issu du latin infans, désigne celui qui n’a pas de voix. Cette perception perdure aujourd’hui. Dans notre institution, nous avons voulu rompre avec cette logique en créant un conseil consultatif de jeunes, chargé d’orienter nos projets et de contribuer à la rédaction de notre rapport annuel.
AÉ: En juin dernier, Fabian, un enfant de 12 ans, a été tué par la police dans le parc Élisabeth à Bruxelles alors qu’il jouait sur une trottinette. On a pu entendre votre tristesse, notamment au micro de la RTBF. Cinq mois plus tard, avez-vous eu des réponses à vos demandes sur la manière dont la police doit traiter spécifiquement les mineurs?
SL: Ce qui m’a d’abord frappé, c’est le silence. Lorsque j’ai été invité sur La Première, j’étais convaincu qu’il ne s’agissait pas d’un simple fait divers et que le consensus serait évident. La scène se déroule dans un parc, à 18 h 30. Fabian n’était pas un délinquant; il aurait pu être le fils de n’importe qui. Pourtant, hormis la Ligue des droits humains, rares sont les institutions qui ont pris la parole publiquement; les silences ont été lourds. Aucun responsable politique n’a condamné clairement les faits. Lors de la cérémonie, quelques conseillers communaux étaient présents, mais aucun ministre ne s’est déplacé. Les parents de Fabian m’ont confié: «Vous êtes le seul à avoir défendu notre fils.»
Avec ma collègue flamande, Caroline Vrijens, nous avons adressé une lettre au ministère de l’Intérieur afin de solliciter une rencontre autour de la question du réflexe du droit de l’enfant. Plus de cinq mois plus tard, nous n’avons toujours reçu aucune réponse.
Il est essentiel de comprendre que ces situations ne sont pas isolées. Ce n’est pas un hasard: si l’on observe la liste des trente dernières personnes décédées à la suite d’une intervention policière, toutes étaient issues de la diversité, et nombre d’entre elles étaient des enfants.
AÉ: Ce silence des institutions que vous décrivez s’inscrit-il dans une tendance plus large? On pense notamment aux restrictions croissantes des politiques migratoires. Qu’est-ce que cela révèle selon vous?
SL: Les libéraux envisagent aujourd’hui de réduire les aides sociales destinées aux familles avec enfants, sans réellement prendre la mesure de la précarité dans laquelle elles vivent. Ce sont pourtant celles et ceux qui se trouvent le plus éloignés de leurs droits qui nécessitent le plus de soutien. Dans le même temps, d’importantes coupes budgétaires sont évoquées dans le domaine de l’asile, alors que les dispositifs actuels peinent déjà à garantir un accompagnement digne aux personnes nouvellement arrivées. Cette logique témoigne d’une forme de déshumanisation, symptomatique d’une société qui tend à se refermer sur elle-même. Or, c’est précisément la solidarité qui demeure le fondement de notre capacité à vivre ensemble.
Les libéraux envisagent aujourd’hui de réduire les aides sociales destinées aux familles avec enfants, sans réellement prendre la mesure de la précarité dans laquelle elles vivent. Ce sont pourtant celles et ceux qui se trouvent le plus éloignés de leurs droits qui nécessitent le plus de soutien.
À cela s’ajoute une autre source d’inquiétude: à partir de juin 2026, l’entrée en vigueur du pacte migratoire européen durcira encore les contrôles aux frontières et renforcera la criminalisation des migrants, risquant d’aggraver les tensions et la vulnérabilité de milliers de personnes.
AÉ: Toutes ces difficultés ne vous découragent pas à exercer votre mandat?
SL: Non, sinon je serais parti. Je reste parce que je suis indigné et engagé. Ce qui m’inquiète profondément aujourd’hui, c’est le système idéologique, puissant et insidieux, qui se met progressivement en place. Je vois des personnes que j’ai longtemps considérées comme progressistes basculer, et cela me préoccupe. Le manque de moyens peut être compensé par la créativité, mais lorsque disparaissent la considération et l’humanité, le danger devient réel.
Cette offensive dépasse nos frontières: elle touche l’ensemble de l’Europe, et même au-delà. Le secteur associatif, tel que je l’observe aujourd’hui, en sort ébranlé, presque sonné. Il est urgent de se remobiliser, de retrouver la force d’affronter cette attaque, car si nous cédons, nous perdrons. Et nous ne pouvons pas nous permettre de perdre.