L’e-santé, c’est quoi?
Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), l’e-santé se définit comme «les services du numérique au service du bien-être de la personne». Les systèmes d’information et de partage des données, les téléconsultations et la santé mobile (pratiques de santé supportées par des appareils connectés) sont les trois grands domaines de l’e-santé.
Mais le champ de l’e-santé est difficile à cartographier, prévient le philosophe Alain Loute (faculté de médecine de l’UCL), qui évoque la présence dans la littérature de plus de cinquante définitions différentes: «La prolifération de tous ces termes n’est pas anodine. Elle est le reflet de la rapidité et du foisonnement du développement technologique. Mais elle s’explique surtout par le fait que l’e-santé est un objet au cœur de différentes logiques d’acteurs: elle constitue tout à la fois un secteur de pratiques médicales innovantes, de nouvelles formes d’organisation des soins, un nouveau secteur industriel, le vecteur de nouvelles formes de politique publique en matière de santé, ainsi que de nouvelles pratiques d’information et de communication entre acteurs et de nouvelles formes de sociabilité numérique des patients», explique-t-il dans une interview pour Le Magazine du Point Culture1.
3,8 millions. C’est le nombre de consultations du portail www.masante.be par 3 millions de visiteurs uniques entre avril et juin 2021 – contre 100.000 à 400.000 consultations par trimestre avant la crise du Covid. Une véritable explosion qui s’explique aisément: tous les courriers relatifs à la vaccination renvoient vers ce portail où l’on accède à ses résultats de «tests Covid» et à son certificat de vaccination. Une «vague Covid» sur laquelle l’administration compte bien surfer pour inciter les patients à se connecter davantage à la plateforme fédérale de collaboration numérique permettant aux patients, aux prestataires de soins et aux établissements de santé d’échanger et de partager les données médicales.
Cette plateforme, tout comme ses pendants régionaux (le Réseau Santé wallon, le Réseau Santé bruxellois et Collaboratief Zorgplatform en Flandre), est au cœur des plans belges «e-santé», dont le premier a vu le jour à l’automne 2012. Meilleure qualité des soins via l’amélioration de la collaboration entre les prestataires de soins, simplification administrative, préservation de la sécurité sociale en mettant un terme aux actes médicaux «doublons»: les promesses du partage des données de santé sont nombreuses. Il en est une autre dont on parle moins: l’empowerment du patient, amené à devenir «copilote» de ses soins, si l’on en croit le cinquième chapitre du «plan d’action e-Santé 2019-2021». «La volonté de faire tout un chapitre sur l’empowerment du patient, c’était de se dire que la loi ‘droit des patients’ de 2002 – qui comporte le droit d’accéder à son dossier médical – devait être mise à jour compte tenu des évolutions digitales, commente Thibaut Duvillier, administrateur général adjoint eHealth et de la Banque Carrefour (BCSS). Pour nous, c’était important que le patient reste propriétaire de ses données. En outre, le patient qui connaît les éléments de santé le concernant respectera mieux sa médication et améliorera la qualité de sa prise en charge.»
Fracture numérique et faible litteratie
Accéder à ses données de santé est une chose. Les comprendre en est une autre. Une fois connectés sur massante.be, on ne tombe que sur des données brutes. La plateforme, sur laquelle on peut trouver son Sumehr (summarized electronic health record), une copie de ses prescriptions électroniques et, bientôt, ses schémas de médication, «manque d’un pan éducatif», reconnaît Thibaut Duvillier, qui annonce toutefois l’introduction, dès l’année prochaine, de données interprétées qui prendront la forme de pop-up et d’onglets renvoyant vers de la littérature accessible.
Plus largement, l’enjeu est aussi d’orienter les patients dans le dédale des milliers d’offres d’information et d’applications, plus ou moins commerciales, plus ou moins éthiques, proposées dans le monde de la santé numérique. «On le voit maintenant avec le problème de la vaccination, on a un problème de culture sanitaire en Belgique et particulièrement en Belgique francophone. C’est clair que les patients sont un peu sous-informés», décrypte François Perl, directeur du pôle acteur social et citoyen de Solidaris. En Belgique, un tiers de la population âgée de 15 ans et plus aurait un faible niveau de connaissance en matière de santé, ce qui signifie qu’elle ne dispose pas des compétences suffisantes pour prendre des décisions concernant sa santé, estime Sciensano (Health Interview Survey, données 2018).
Le consentement en question
Clef de la relation de confiance entre le soigné et le soignant, les contours du secret médical se sont vus modifiés par l’informatisation et l’échange de données de santé. «Auparavant quand on partageait l’information, c’était très personnalisé. On demandait certaines informations pour un objectif précis», expliquait Benjamin Fauquert, médecin généraliste à la maison médicale Le Noyer et chercheur à l’école de santé publique de l’ULB, à la revue Santé conjuguée2. Désormais, «on n’envoie plus le document à une personne, mais on le rend disponible à chaque personne ayant une autorisation pour ce patient».
Alors que les (tentatives de) dérives liées au partage de données à des tiers sont légion hors de nos frontières – en Grande-Bretagne, en 2019, le National Health service autorisait Amazon à utiliser des données de santé collectées par le service public pour développer ses produits (Lire «Pour votre santé, un smartphone suffira», Alter Échos n° 485, juillet 2020)3; en France, en 2014, un projet de connexion d’un programme de téléobservance de l’apnée du sommeil prévoyait d’informer l’assurance maladie en cas de non-observance, avant d’être abandonné à la suite d’un recours auprès du Conseil d’État –, beaucoup regardent avec circonspection la manière avec laquelle l’État permet – ou pas – l’échange de données dans notre pays et rend possible – ou non – les croisements entre les différentes bases de données. En témoignent les vifs débats autour de la personne de Frank Robben, patron de la Smals (société de TIC qui travaille pour les services publics), de la BCSS et de eHealth, controversé notamment parce qu’il gère ces plateformes informatiques extrêmement sensibles tout en siégeant à l’Autorité de protection des données (Relire notre dossier «Big data, bug brother?» Alter Échos n°433, novembre 2016).
«On part de plus en plus de l’idée que, par définition, la gestion des données est mauvaise pour le patient, qu’elle s’inscrit dans une société de contrôle et qu’elle sert avant tout à développer des applications et des services payants, regrette François Perl. En Belgique, «il faut rappeler que l’architecture de l’e-santé a été construite tant pour le prestataire que pour le patient.» Et que cette architecture est «décentralisée», à savoir qu’elle ne stocke aucune donnée, mais se «contente» d’orchestrer les liens entre les différents systèmes. «À aucun moment, l’Inami, la Cocom ou l’Agence du médicament n’ont accès aux données de santé qui restent stockées chez les prestataires de soins (réseaux de médecins généralistes, des hôpitaux, etc. NDLR).» Un système qui doit garantir la sécurité des échanges – mais qui repose aussi sur la sécurité des serveurs des prestataires de soins eux-mêmes4…
«Il y a pour l’instant des discussions sur la possibilité de mettre en place un seul dossier patient centralisé, relève toutefois François Perl. Pas mal de prestataires en rêvent pour de bonnes raisons: on a atteint un niveau limite de ce qu’on peut faire avec un système en interconnexion, car le patient doit donner toute une série d’autorisations, sinon il ne se passe rien. Cela devra se faire de manière coordonnée et avec une très, très bonne information et pédagogie. Mais on est loin d’un système Big Brother en Belgique en matière de santé…»
D’autres «verrous» sécurisent la manière dont nos données de santé circulent: l’échange ne peut se faire qu’entre les prestataires de soins qui ont une relation thérapeutique avec le patient. (L’électronique pourrait ici avoir un certain avantage par rapport au papier: la traçabilité. Pas question, en effet, pour un médecin d’aller ouvrir une armoire en douce pour accéder au dossier d’un patient qu’il ne soigne pas.) Des règles d’accès basées sur le principe de proportionnalité ont été mises en place. (Un infirmier qui fait une injection intramusculaire d’un médicament à un patient ne doit pas pour autant avoir accès à son dossier psychiatrique ou gynécologique.) Enfin, le patient doit avoir donné son consentement «éclairé» pour le partage de ses données.
Ce consentement aurait été donné par 9,6 millions de Belges. Vraiment? «Cette notion de consentement éclairé est un peu théorique, soyons clairs, concède Thibaut Duvillier. En Belgique, on a voulu que cette demande soit faite à chaque patient. Êtes-vous au courant de ce qu’est ce consentement et êtes-vous d’accord avec ce partage des données? Le problème, c’est que souvent cette explication n’a pas eu lieu. Vous avez pu aller chez votre médecin qui a pris votre eID et enregistré votre consentement en parlant de tout autre chose… Idem à l’hôpital. À votre arrivée, vous signez plein de papiers et il y a certainement dans ces documents une petite case sur ce partage de données…»
Téléconsultations: accessibilité vs médecine à deux vitesses
Les questions de sécurité des données et de consentement sont aussi au cœur du développement de la télémédecine. Les consultations à distance peuvent améliorer l’accessibilité aux soins – soit parce que les services ne couvrent pas suffisamment certains territoires, soit parce que d’autres freins entravent l’accès aux soins (Lire dans le dernier numéro d’Alter Échos: «Le pari de l’e-santé pour un meilleur accès aux soins», septembre 2021) – et la pandémie a, encore une fois, donné un coup d’accélérateur à ce phénomène, des millions d’actes ayant été réalisés à distance afin d’assurer la continuité des soins et de réguler les flux des malades.
Si l’on en croit une étude du Centre fédéral d’expertise des soins de santé (KCE), il n’existe aucune preuve montrant que les consultations vidéo ont un impact différent – ni positif ni négatif – des consultations «ordinaires» sur la santé des patients5. L’organe d’études a d’ailleurs encouragé, en juin 2020, le développement des «soins numériques» «comme complément utile à une consultation en face à face, et non pour la remplacer», tout en insistant sur la nécessité du consentement du patient et celle «que ces applications soient assorties de garanties de sécurité et de conformité à toutes les exigences légales». Un des dangers de cette expansion fulgurante des téléconsultations réside aussi dans un développement à deux voies. «Tout le monde a les technologies suffisantes pour des téléconsultations, ne fût-ce que par téléphone. La fracture se situe entre du numérique cheap ou du bon numérique», observe Alain Loute, philosophe à la Faculté de médecine de l’UCL.
«Un suivi global ne peut pas se faire via une appli.» Fanny Dubois, Fédération des maisons médicales
Une chose est sûre, les acteurs du secteur marchand sont sur la balle. Les assurances AXA ont développé leur plateforme en ligne de consultation d’un médecin généraliste ou d’un psychologue. Proximus propose aussi depuis quelques mois son application Doktr qui vous met en contact, «en quelques minutes», avec un médecin par téléphone ou par vidéo. Un projet qui «vise à soulager le personnel soignant et à donner aux patients des outils digitaux leur permettant de prendre une part active dans leur parcours de soins», selon un communiqué de l’entreprise. Face à ces évolutions, nombre de médecins se montrent préoccupés par la commercialisation des soins. «Qui va aller sur ces applis? Des personnes financièrement en galère, car l’accès à un médecin généraliste y est (pour le moment, NDLR) gratuit, s’inquiète Fanny Dubois, secrétaire générale de la Fédération des maisons médicales. Si le problème n’est pas réglé, le médecin va renvoyer le patient chez un autre médecin, ce qui n’est pas cohérent au niveau de l’efficience de l’utilisation de l’argent de la sécurité sociale. Cela va à l’encontre du modèle de santé publique que l’on défend: des soins primaires de proximité, dans le quartier, puisqu’on sait que la santé est très fort influencée par l’environnement, que ce soit le logement, la mobilité, le revenu ou l’alimentation. Un suivi global ne peut pas se faire via une appli.»
François Perl, de son côté, regarde le phénomène avec prudence, mais sans le condamner d’emblée. «Dans le choix des opérateurs, c’est peut-être mieux de travailler avec des structures avec lesquelles on peut parler, qui payent des impôts en Belgique et qui ont un actionnariat public… C’est peut-être mieux que ce soit Proximus plutôt qu’un GAFAM.» Et de prôner plutôt la mise en place d’un cadre de régulation, «comme cela a été fait avec les softwares médicaux»: «Ceux qui entreront dedans, entreront dedans, et les autres non.»
Autre risque de la médecine à distance, peu mesuré jusqu’à présent dans le contexte de la crise: l’extension de la responsabilité du patient, relève aussi Alain Loute, illustrant son propos par le témoignage d’une neurologue française qui suit par visio des patients atteints de la maladie de Charcot. «Cette spécialiste trouvait que la téléconsultation était quelque chose d’intéressant. Mais il y a eu des effets qu’elle n’avait pas anticipés, comme le fait qu’elle ne maîtrisait pas l’espace dans lequel avait lieu la consultation.» Qui se trouve dans la pièce avec le patient? Dans quelles conditions se déroule la consultation? Avec quel outil? Une obligation déontologique impose au médecin de choisir un lieu adéquat pour ses consultations. «Ici, c’est comme si la garantie de ce lieu adéquat était transférée au patient.»
Le même type de constat avait déjà été posé au sujet de la télésurveillance. «Un malade travaille et ce travail peut prendre différentes formes. Il doit se prendre en main, parfois il va jusqu’à mener un travail de coordination de ses soins, poursuit Alain Loute. Certains sociologues ont montré que ce travail du patient pouvait être étendu avec le numérique dans le cadre d’hospitalisation à domicile ou du suivi des maladies chroniques.» Exemple? La saisie manuelle d’informations (prendre sa tension, etc.), qui pourrait même poser des questions d’ordre juridique: «À qui incombe la responsabilité si le patient a mal saisi cette information?»
Santé numérique: quelle gouvernance?
Alors que l’e-santé faisait l’objet, depuis plusieurs années, d’une politique planifiée et volontariste de la part de nos gouvernements, «avec le Covid, cette logique de planification s’est croisée avec une logique d’expérimentation pas toujours contrôlée, décode Alain Loute. On a employé des dispositifs qui ne sont pas toujours les meilleurs et peut-être que leurs usages vont perdurer. Une fois qu’on utilise une technologie, on ne peut pas aussi simplement que ça revenir en arrière. Il y a des effets d’usages et des acteurs économiques qui se sont imposés dans ce champ. Or, pendant un an, on a expérimenté sans se donner les moyens d’avoir des retours de terrain.» Comment, aujourd’hui, reprendre le contrôle sur une machine qui semble tourner en roue libre? «Il faut pluraliser la voix des patients, évaluer dans la durée, mais aussi sortir d’une éthique de l’acceptabilité des technologies et poser la question, plus radicale, de leur désirabilité. Car aujourd’hui, c’est comme si on considérait qu’elles étaient nécessairement bonnes…», soutient le philosophe.
«Il faut sortir d’une éthique de l’acceptabilité des technologies et poser la question, plus radicale, de leur désirabilité.» Alain Loute, philosophe (UCL).
«Plus que jamais les citoyens ont droit à beaucoup plus de démocratie et de mise en débat au sens d’éducation populaire sur ces sujets», précise aussi Fanny Dubois. En effet, si s’empêcher de réfléchir collectivement à ces questions peut créer des fantasmes, l’informatisation «influence aussi les façons de se représenter le monde et est au service des cultures dominantes. Dans notre mouvement, nous estimons qu’elle doit être au service de nos valeurs d’autogestion et de multidisciplinarité» (Relisez nos dossiers «Imaginer une santé en commun», Alter Échos n°490, janvier 2021 et «Transformation numérique. Au tour de l’associatif», Alter Échos n°496, septembre 2021).
Le résumé
• Avec la crise du Covid-19, la plateforme e-Health qui permet aux patients et aux prestataires de soins de partager les données de santé est passée de 100.000-400.000 à 3,8 millions de consultations par trimestre.
• Même constat dans le domaine de la télémédecine, où des millions d’actes médicaux ont été posés à distance au cours des derniers mois.
• Alors que l’e-santé faisait l’objet d’une politique planifiée et volontariste de la part de nos gouvernements, avec le Covid, elle s’est superposée avec une logique d’expérimentation pas toujours contrôlée.
1 «La santé numérique: 3 questions à Alain Loute», Le Magazine de Point Culture, sur www.pointculture.be
2 «L’informatisation, une menace?», Santé Conjuguée n°80: Le secret profesionnel: partagé, dévoilé, maintenu, bafoué…, septembre 2017, par Marinette Mormont.
3 Par Caroline Molly (trd. du journal OpenDemocracy).
4 Lire notamment à ce sujet: «Les données de santé des Belges, mal protégées, s’échappent en Russie», Médor, mars 2021, Cédric Vallet, Quentin Noirfalisse.
5 Vidéo-consultations dans le suivi des patients atteints de maladies chroniques somatiques – Synthèse, Health Services Research (HSR). Bruxelles: Centre Fédéral d’Expertise des Soins de Santé (KCE), juin 2020, Mistiaen P, Devriese S, Pouppez C, Roberfroid D, Savoye I.
En savoir plus
«Transparence et démocratie : les oubliées des données Covid?», Alter Échos web, 23 janvier 2021, Robin Lemoine.
«Santé connectée, santé pour tous?», Alter Échos n° 432, novembre 2016, Marinette Mormont.


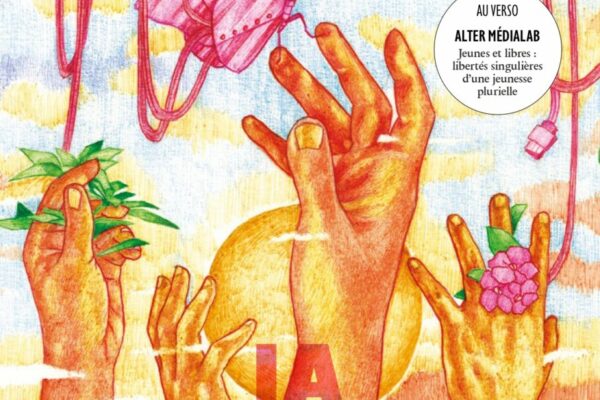
















«On est face à un problème assez classique, continue François Perl. Des outils de politiques publiques assez performants au niveau de l’e-santé, mais fort concurrencés par tout ce qu’on trouve sur le marché privé. Il s’agit de trouver la meilleure manière d’informer correctement le patient. À un moment donné, a-t-on interconnecté les pratiques de santé communautaire avec le développement de l’e-santé? On se rend compte globalement que non. On fait le même constat à propos de nos propres pratiques au sein de la mutuelle. Nous avons donc des réflexions sur ce que peut devenir l’agence mutuelliste de demain: bien moins un guichet de remboursement qu’une agence avec un conseiller, notamment pour les personnes qui n’ont pas accès au numérique à la maison, et toujours, évidemment, dans le respect du secret médical.» La création d’un réseau d’«écrivains publics numériques», annoncée par le secrétaire d’État à la digitalisation Mathieu Michel, est aussi évoquée par Thibaut Duvillier, qui met néanmoins en avant la limite imposée par le secret médical: «Nous ne pouvons pas aider le citoyen dans la compréhension de ses données sanitaires puisque nous ne pouvons pas avoir accès à ses données.»