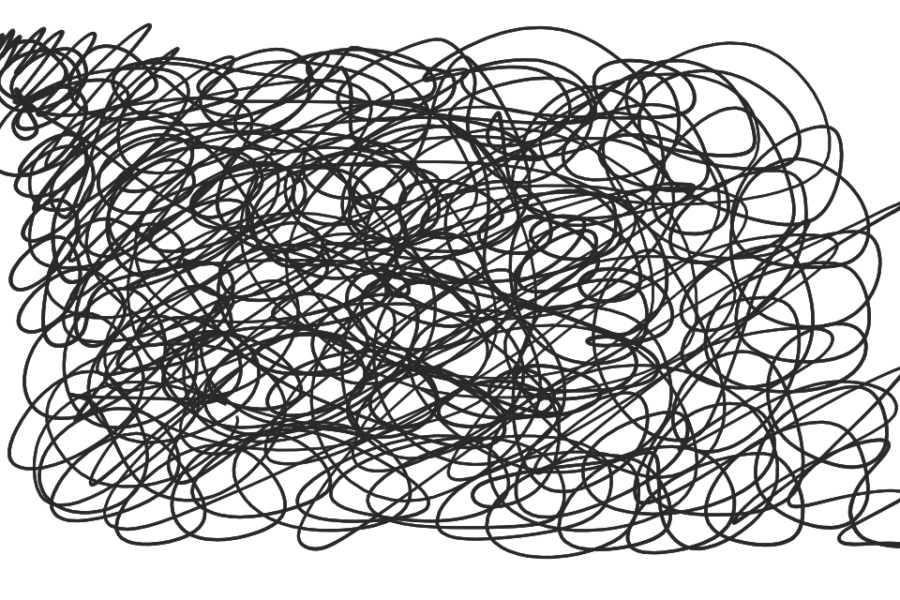Les femmes migrantes sont extrêmement vulnérables face aux violences domestiques. Sans réseau, sans connaissance des lois, parfois sans maîtrise des langues du pays, elles sont les proies idéales d’hommes violents. Si des dispositifs permettent de protéger – imparfaitement – les femmes venues en Belgique dans le cadre du regroupement familial, rien de tel n’existe pour les femmes sans papiers, dont le statut de victime n’est quasiment pas reconnu.
Nour ne s’en est pas encore sortie. «Je vis toujours avec lui, mais nous sommes séparés. Dès que j’en ai la possibilité, je trouve un logement et je m’en vais.» La délivrance comme horizon, après des années de cauchemar. Nour est arrivée en Belgique en 2015 pour rejoindre un ressortissant algéro-marocain, qui lui avait fait miroiter une vie confortable, un mariage paisible et un titre de séjour.
Mais elle n’a rien vu de tout cela. «Il fallait faire tout ce qu’il disait. Sortir quand il le voulait. Par exemple, pour ce qui est du sexe, les femmes selon lui ne peuvent pas dire ‘non’, je n’avais pas la possibilité de dire non, je n’avais pas le choix.» Le viol conjugal comme arme de terreur intime. Avec ses conséquences.
Un jour, Nour se découvre enceinte. Son compagnon, qui n’a jamais tenu sa promesse de mariage, ne veut pas de cet enfant. Elle est illico dégagée de l’appartement, sans préavis et se retrouve à la rue. L’homme change la serrure et la calomnie dans tout le voisinage.
La perspective qui s’offre à Nour est alors des plus sombres: le Samusocial et la vie d’errance. Par conséquent, le jour se son accouchement, elle supplie le père de l’enfant de les «reprendre». «Soit j’acceptais la violence soit je me retrouvais à la rue avec mon bébé. Je n’avais pas le choix.» Les viols conjugaux reprennent. Et un jour, l’homme fait parler les poings. «Il ne m’a frappée qu’une seule fois. Devant ma fille de 3 ans. Ça, c’était inacceptable. J’ai appelé la police pour qu’il comprenne. Mais je n’ai jamais porté plainte, car j’étais sans papiers, et donc j’étais obligée de rester dans un trou, en silence.»
Aujourd’hui, Nour sort peu à peu de ce trou. Elle a obtenu un titre de séjour d’un an et cherche un logement pour s’extirper de la mainmise de cet homme dangereux. Sa situation, extrêmement précaire, est celle de nombreuses autres femmes migrantes en Belgique. Victimes de violences conjugales et dans l’incapacité de faire valoir ce statut de victime, même si les situations diffèrent considérablement en fonction du statut de séjour de ces femmes – sans papiers ou détentrices d’un titre de séjour. «On inflige des violences sociétales et institutionnelles à des femmes qui sont déjà victimes de violences», dénonce Giorgia Scalmani, animatrice à la maison Couleurs femmes de Vie féminine à Schaerbeek.
«Nous tenons compte de l’état de victime de violences et nous n’allons pas la flanquer en cellule.» Police de Bruxelles, zone Midi
Regroupement familial: une protection fragile
Lorsqu’une femme rejoint son conjoint en Belgique dans le cadre du regroupement familial, elle obtient un titre de séjour conditionné, pendant cinq ans, à la cohabitation réelle du couple. «En cas de défaut de cohabitation, nos services doivent envoyer un ordre de quitter le territoire», explique Dominique Ernould, porte-parole de l’Office des étrangers (OE). Pendant les cinq premières années en Belgique, la séparation n’est donc pas envisageable… sauf à perdre son titre de séjour.
Il existe cependant des exceptions à cette règle, prévues dans la loi, pour les victimes de violences conjugales. «Une victime peut expliquer pourquoi elle a dû quitter son conjoint», ajoute Dominique Ernould. Cette procédure prévoit d’octroyer un délai de un à trois mois à la victime pour réunir le maximum de preuves afin d’étayer ses affirmations relatives aux violences subies. «Nous acceptons tout document utile, précise la porte-parole de l’Office des étrangers. Une plainte ou un P-V d’audition à la police. Des certificats médicaux, des témoignages, des attestations d’hébergement de centres spécialisés.» Bien sûr, l’OE peut aussi «demander au parquet l’état d’avancement de l’affaire en cours», pour en savoir plus sur le dossier. Mais de l’aveu de Dominique Ernould, «cela ne tourne pas super vite et super bien».
Quoi qu’il en soit, sur la base de l’analyse du dossier, le statut de «victime de violences conjugales» d’une personne venue en Belgique au titre du regroupement familial peut ouvrir un droit au séjour distinct de celui du mari.
Le but poursuivi par le législateur étant qu’une plainte pour violences ne pénalise pas la victime avec une perte du séjour. «Le souci, c’est que la charge de la preuve des violences est un poids très important pour les femmes», déclare Maria Miguel-Sierra, directrice de l’asbl «La voix des femmes». L’avocate spécialisée en droit de la famille Caroline Prudhon abonde en son sens: «Il s’est instauré une pratique, tant à l’Office des étrangers qu’au Conseil du contentieux des étrangers, qui consisterait à appliquer ces clauses de protection en fonction d’un degré de violence ou de violences à répétition. Ce n’est pourtant pas prévu par la loi.» Bref, l’OE demanderait beaucoup…
«La stratégie des conjoints est d’accroître cet isolement, dont la barrière de la langue fait partie.» Yamina Zaazaa, codirectrice du Centre de prévention des violences conjugales et familiales
Porter plainte, apporter des preuves sont autant d’actes très difficiles à poser. Pour le faire, il faut échapper «aux stratégies de contrôle et d’isolement de conjoints et maris qui ont compris que l’apport de preuves contre eux pourrait ouvrir un droit au séjour», décrit Yamina Zaazaa, codirectrice du Centre de prévention des violences conjugales et familiales. Selon le Conseil de l’Europe, les femmes victimes de violences ne portent plainte que dans 13,9% des cas. Le chiffre est certainement beaucoup plus bas pour les femmes migrantes.
Car celles-ci sont plus vulnérables. «Elles sont privées d’un réseau pour les aider à connaître leurs droits, ajoute Yamina Zaazaa. La stratégie des conjoints est d’accroître cet isolement, dont la barrière de la langue fait partie. Certaines ne savent pas qu’il faut faire un certificat médical. Et, quand elles le savent, il leur faut échapper au contrôle de l’homme pour voir un médecin.» Plus le contrôle est total, plus la possibilité de porter plainte est ténue. «Parfois, le conjoint va effacer le nom sur la sonnette, enchaîne Yamina Zaazaa. Il va la radier du domicile, ne pas lui donner d’argent, l’empêcher de se former.» La prison à la maison.
Dans ces conditions, ce sont surtout les violences physiques qui sont prises en compte par les autorités. «Les cas de violences psychologiques ou économiques sont malheureusement plus difficiles à prouver et à faire reconnaître auprès de l’Office des étrangers», explique Coralie Hublau, du Ciré. Des témoignages peuvent être récoltés. Des SMS. Des P-V de police retranscrivant la violence verbale. Mais le processus est une gageure. «Et les preuves ne sont pas toujours acceptées, nous ne savons pas toujours quels critères sont appliqués par l’OE», poursuit Maria Miguel-Sierra.
Le 7 février 2019, la Cour constitutionnelle a apporté une grande clarification dans les critères d’obtention des clauses de protection. «Cet arrêt soulage pas mal de situations», se réjouit Coralie Hublau. En effet, la loi de 1980 avait instauré une différence de traitement entre les personnes qui possèdent un titre de séjour suite à un regroupement familial, en fonction de l’origine de leur conjoint ou conjointe.
Pour les victimes dont le conjoint est belge ou européen, les clauses de protection – et donc l’obtention d’un titre de séjour individuel – ne s’appliquent que si elles sont capables de démontrer qu’elles possèdent suffisamment de revenus pour assurer sa subsistance en Belgique. Cette exigence n’est pas de mise lorsque les deux conjoints sont de nationalité étrangère.
Pour la Cour constitutionnelle, les objectifs poursuivis par le législateur ne sauraient justifier un traitement différent alors que ces deux catégories d’étrangers «se trouvent dans les mêmes situations particulièrement difficiles» (dans son mémo à la Cour constitutionnelle, le Conseil des ministres justifie cette différence de traitement par le fait que 70% des regroupements familiaux le sont avec des Belges. Le but était alors de «maîtriser la pression migratoire»). Aujourd’hui, l’Office des étrangers applique l’arrêt dans un sens favorable, «sans examiner les ressources des femmes victimes», nous dit-on à l’Office des étrangers. Mais pour combien de temps? En effet, le législateur pourrait décider de résoudre cette différence de traitement par l’application de conditions plus restrictives – et donc d’un examen des ressources applicable à tout le monde. «Nous attendons que s’exprime la volonté du législateur, confirme Dominique Ernould. Pour l’instant, nous ne savons pas quelle sera l’orientation.»
Sans-papiers: dans le vide intégral
Si les femmes qui possèdent un titre de séjour lié au regroupement familial bénéficient d’une protection – certes imparfaite – en cas de violences conjugales, tel n’est pas le cas des femmes sans papiers. «Les femmes sans papiers ne savent pas porter plainte. Elles ont cette crainte qui règne dans la tête, celle de se faire arrêter. Elles sont obligées de se taire», témoigne l’une des membres du Comité des femmes sans papiers. «Cela ne vient pas à l’esprit des sans-papiers d’aller porter plainte, adhère Giorgia Scalmani. Ces femmes sont invisibles et elles se sentent comme telles.»
Pas évident, en effet, d’aller porter plainte au commissariat de police lorsque cette plainte pourrait rimer avec centre fermé et expulsion. «L’agent de police a une double casquette, récapitule Coralie Hublau. D’un côté, il doit enregistrer la plainte. De l’autre il doit jouer son rôle de police administrative, il doit donc contacter l’Office des étrangers.» C’est ensuite à l’OE de décider de la marche à suivre. Ordre de quitter le territoire. Centre fermé. Libération. Selon les associations féministes ou de défense de droits des étrangers, il règne un flou total sur les pratiques en cas de plainte pour violences conjugales déposée par des femmes sans papiers.
«Les femmes sans papiers ne savent pas porter plainte. Elles ont cette crainte qui règne dans la tête, celle de se faire arrêter.» Membre du Comité des femmes sans papiers
Dans ce contexte incertain, Caroline Prudhon a fait son choix: «Personnellement, je conseille à mes clientes sans papiers de ne jamais se rendre seules au commissariat. Je leur dis qu’il est plus sage d’y aller accompagnées d’une association avec une étape préalable dans un service d’accueil des victimes qui pourra les aider. Dans ces services, ils savent à quel horaire et dans quel commissariat les femmes pourront bénéficier d’un bon accueil, car c’est très aléatoire.»
Qu’en est-il dans la réalité? Existe-t-il des formes de protection des femmes sans papiers dans les commissariats ou à l’Office des étrangers?
Difficile d’obtenir des réponses claires. L’OE affirme tenir compte des plaintes en cours… mais sans appliquer de règle générale. «Lorsque la police dresse un P-V qui mentionne des violences conjugales, cela peut empêcher la détention en centre fermé», déclare Dominique Ernould. Et si la personne est arrêtée et mentionne les violences conjugales à l’équipe du centre fermé, «alors nous pouvons lever l’écrou et entamer une procédure pour qu’elle obtienne le statut de victime et un titre de séjour temporaire, mais cela n’arrive pas si souvent», ponctue la porte-parole. Dans ce genre de cas, la victime est invitée à introduire une demande de régularisation dite «9 bis», pour circonstances exceptionnelles. Sauf que ces cas théoriques n’arrivent pas souvent. L’Office des étrangers ne possède pas de chiffres et Dominique Ernould reconnaît que ces cas de figure sont «peu fréquents, car les femmes sans papiers ne portent pas souvent plainte».
À Bruxelles, au sein de la zone de police Midi, l’inspectrice principale du service enquête, Sandrine De Boeck-Desmedt, et Sandrine Vergouts, du service d’assistance policière aux victimes, confirment qu’il est «assez rare que des sans-papiers franchissent la porte d’un commissariat de peur d’être rapatriés».
Une peur légitime? Si les policières rappellent qu’en général, «l’Office des étrangers est contacté», lorsqu’une personne sans papiers s’adresse à la police, elles affirment aussi «ne pas être inhumaines. Nous tenons compte de l’état de victime de violences et nous n’allons pas la flanquer en cellule», même si un transfert vers un centre fermé reste dans le domaine du possible si l’OE le décide. «Toutefois, la magistrate de référence nous a affirmé n’avoir pas de souvenir d’éloignement du territoire dans le cadre de dossiers de violences conjugales», dit Sandrine De Boeck-Desmedt. Bref, malgré toutes les précisions des autorités, une chose est claire: la loi belge ne prévoit pas de protection particulière des femmes sans papiers victimes de violences conjugales.
De telles lois existent pourtant dans d’autres pays européens. L’idée est alors de faire primer le statut de victime sur l’absence de titre de séjour. L’Espagne, la France, l’Italie, la Grèce et les Pays-Bas possèdent des dispositions – plus ou moins restrictives – permettant aux femmes sans papiers d’obtenir un titre de séjour temporaire si elles ont été victimes de violences domestiques. Le plus souvent, le permis est octroyé le temps de mener à son terme la procédure judiciaire à l’encontre de l’auteur des faits.
Ces dispositifs sont souvent inspirés des préceptes de la convention d’Istanbul sur la prévention et la lutte contre les violences à l’égard des femmes et la violence domestique. S’ils sont souvent salués par le monde associatif, ils ne sont pas pour autant la panacée. Alyna Smith, experte de l’ONG Picum (Plateforme pour la coopération internationale sur les sans-papiers), en pointe certains effets pervers: «Les protections existent dans la loi, mais paradoxalement elles peuvent diminuer la crédibilité des femmes. Dans ces pays, la police aura tendance à voir ces plaintes comme motivées par un désir de régularisation. C’est un vrai problème. Ce type de dispositifs peut fonctionner si on adopte une approche cohérente, faite de formations afin que le regard change sur les victimes sans papiers.»
Malgré ces réserves, le tissu associatif belge est globalement favorable à l’option «titre de séjour» pour les femmes sans papiers et victimes. «Il faut absolument trouver une solution pour ces femmes, au niveau du séjour, mais aussi des solutions d’hébergement, plaide Maria Miguel-Sierra. Sans cela, elles ne peuvent s’extraire de la violence.»