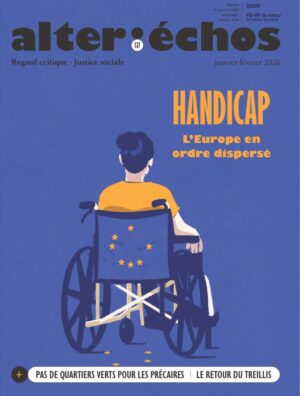Nathalie Monteyne et Florence Boreux sont médiatrices au service de médiation de dettes (SMD) du CPAS d’Yvoir, en région namuroise. Toutes deux sont confrontées dans leurs dossiers à des problèmes d’addictions: les plus fréquents sont le tabagisme et l’alcoolisme qu’il faut d’une manière ou d’un autre intégrer dans les budgets. Depuis quelque temps, les jeux en ligne sont également présents, ainsi que l’achat et la vente de bitcoins (voir article sur les addictions aux jeux). La question des drogues est également source d’endettement, mettant le budget et la vie en général en très net déséquilibre, mais les dossiers de médiation de dettes dans lesquels les personnes en difficulté présentent des addictions aux drogues sont plutôt rares, sans doute parce que ces personnes sont nettement plus marginalisées, ne sont pas en mesure de gérer leur situation financière ou encore sont sans domicile, ce qui, de facto, les «protège» des poursuites des créanciers.
À côté de ces situations les plus fréquentes, il y a aussi des addictions plus «modernes», comme celles liées au shopping ou aux commandes en ligne, notamment avec des dossiers Klarna, pour lesquelles les personnes utilisent les possibilités de paiement différé sans avoir les moyens et qui posent des problèmes épineux dans les dossiers, car les contacts avec de tels créanciers sont difficiles. On rencontre aussi des addictions à l’amour, parfois doublées de fraudes sentimentales, avec des détournements d’argent parfois considérables.
Un sujet tabou comme l’argent
Un des premiers problèmes qui se posent dans ces dossiers, c’est le fait que les personnes en difficulté ne confient pas nécessairement l’existence de ces addictions et les conséquences qu’elles entraînent sur le budget. Comme l’explique Nathalie, «bien souvent, les personnes refusent de reconnaître qu’elles ont un problème, elles cachent les difficultés ou les minimisent. Il est donc difficile d’avoir une vision claire de la situation».
Un des premiers problèmes qui se posent dans ces dossiers, c’est le fait que les personnes en difficulté ne confient pas nécessairement l’existence de ces addictions et les conséquences qu’elles entraînent sur le budget.
La question du tabac semble peut-être celle qui est la plus facile à aborder, car mieux tolérée socialement. Dans le cas de l’alcoolisme, s’il s’agit d’un couple en médiation, si l’un des deux n’est pas concerné par l’addiction, il évoquera plus facilement le problème rencontré par son conjoint. Mais ce n’est pas pour autant que la gestion de ces dossiers est évidente. Comme le souligne Florence Boreux, «les personnes, même si elles souhaitent s’en sortir, sont sujettes à des rechutes répétées, lors desquelles elles disparaissent dans la nature, parfois pendant de longs mois, puis réapparaissent. Dès lors, les démarches reprennent là où elles en étaient restées, mais avec une situation qui a bien souvent empiré. Dans certains cas, il y a rémission et une situation stabilisée, qui permettent de mener à bien la médiation de dettes, mais dans de nombreux dossiers, les démarches sont fastidieuses, bancales et souvent vouées à l’échec».
Comment aborder ces difficultés?
On l’a dit, il n’est pas forcément évident pour les médiatrices et médiateurs de dettes de gérer ces dossiers. Comme l’explique Nathalie, «on est amené à devoir élaborer un budget, alors même qu’on n’est pas informé de l’existence d’une addiction. Dans ce cas, la médiation de dettes ne sera pas efficace, car la consommation d’alcool, de tabac ou de drogues ne sera pas budgétisée et se fera au détriment d’autres dépenses. S’il y a dialogue entre médiateur de dettes et médié, on essaie alors de cadrer les dépenses pour ces addictions, par exemple en proposant aux fumeurs de préférer le tabac roulé et les tubes à cigarettes plutôt que les paquets tout faits qui ne cessent d’augmenter. Quand il s’agit de dépenses excessives en shopping, on oriente vers la deuxième main ou des applis comme Vinted. On en discute longuement pour les convaincre des efforts à effectuer. Ce n’est pas évident parce qu’on rentre dans l’intimité des personnes et que l’on attend d’elles une prise de conscience».
«On est amené à devoir élaborer un budget, alors même qu’on n’est pas informé de l’existence d’une addiction. Dans ce cas, la médiation de dettes ne sera pas efficace, car la consommation d’alcool, de tabac ou de drogues ne sera pas budgétisée et se fera au détriment d’autres dépenses.»
Nathalie Monteyne
Florence souligne: «Dans certains cas, on se dit que c’est peine perdue et, quand la machine judiciaire est activée, cela représente aussi des coûts pour la société. La nécessité de passer par la nomination d’un administrateur de biens peut s’avérer la meilleure solution, même si les personnes ne sont pas forcément d’accord avec de telles mesures et essaient d’y échapper. Mais c’est sans doute une solution plus adaptée, surtout si l’administrateur de biens est formé aux addictions.»
La nécessité d’un dialogue, sans jamais rompre le lien
Dans le cadre de ce dossier, nous avons aussi interrogé une jeune médiatrice de dettes active en province de Luxembourg, à Chiny. Maud Goffinet, du SMD du CPAS de Chiny, laquelle met surtout l’accent sur le dialogue et la nécessité de transparence dans le chef du médié. C’est pourquoi elle aborde d’emblée la question des addictions dès l’entame de la médiation de dettes.
«J’aborde cette question dès le premier entretien: je leur dis que je suis transparente et qu’il est nécessaire qu’ils le soient aussi. Plutôt que d’éluder le sujet, je préfère poser directement la question: “Avez-vous des fragilités?”, “Est-ce que vous consommez?” Je leur explique que s’ils ne jouent pas cartes sur table, il ne sera pas possible d’avancer sur de bonnes bases et la médiation de dettes ne sera jamais ajustée aux dépenses réelles. Une fois la question abordée, il n’y a plus de honte, le tabou est évacué et on peut en parler.»
Des dossiers compliqués
Mais il est clair que ces prises en charge demandent un investissement de temps considérable. Il y a de nombreuses raisons qui mènent aux addictions, comme des fragilités, la dépression, la solitude. Donc, il est nécessaire de mettre en place un suivi. Comme le souligne Maud, «ce qui compte avant tout, c’est la relation de confiance et le lien que l’on peut créer dans ce type de dossiers. Mais il faut s’adapter, agir quand c’est nécessaire et ne pas s’oublier non plus en tant que médiatrice de dettes et se protéger soi-même».
Dans certains cas, en effet, les médiatrices qui témoignent ressentent de l’agressivité chez les personnes prises en charge, voire du harcèlement lorsqu’il s’agit de dégager de l’argent pour leurs addictions. Le fait d’avoir pu suivre des formations avec des asbl spécialisées, comme l’asbl Nadja (Liège), Phénix (Namur) ou encore L’Équipe (Bruxelles), ou de participer à des concertations locales sur le sujet, par exemple avec la Commission des jeux de hasard, comme ça a été le cas pour Medenam l’an dernier, permet de mettre de la distance et de mieux gérer ces situations.
Et le recours au RCD?
Évoquer les addictions dans le cadre d’une procédure de règlement collectif de dettes n’est pas forcément évident. Comme l’explique un médiateur de dettes interrogé, «on préfère augmenter un peu le budget nourriture et y intégrer le tabac, l’alcool ou le cannabis, pour ne pas révéler les problèmes de dépendance à tous les créanciers. Le juge, lui non plus, n’évoque pas forcément la question dans son jugement. Quand tout se passe bien, on n’est pas obligé d’aborder ces questions. Mais quand le RCD échoue ou est suivi d’un 2e ou 3e RCD, si les addictions sont la cause des problèmes, cela finit par se savoir et le juge encadrera alors la procédure de manière plus stricte, avec une guidance budgétaire et, le cas échéant, des mesures d’accompagnement, comme le suivi d’une cure».
Le problème est que les personnes sujettes aux addictions contractent généralement de nouvelles dettes en cours de procédure, alors que celle-ci ne permet pas l’endettement post-admissibilité, ou alors décrochent, rechutent, partent à l’étranger. Le médiateur ou la médiatrice de dettes est alors confronté à des cas de conscience où il/elle doit parfois se résoudre à demander la révocation d’un dossier, si la personne ne collabore pas. Or si le dossier est révoqué, la personne ne pourra plus introduire de RCD avant cinq ans. Pour de tels cas, la solution du plan 0 semble être une bonne solution, car elle permet une plus grande souplesse.