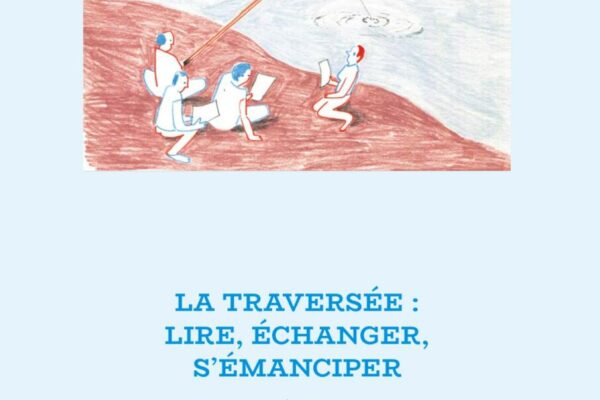Expérience spirituelle, exploration de l’esprit, projet littéraire… Du XIXe siècle à nos jours, nombre d’écrivains ont usé de psychotropes afin d’y puiser l’inspiration ou d’en relater les effets. Au-delà de leur caractère expérimental, ces textes évoquent aussi l’image de ces produits dans la société.
Un soir de décembre 1845, «obéissant à une convocation mystérieuse», le poète Théophile Gautier se rend à l’hôtel Pimodan, une vieille maison sur l’île Saint-Louis à Paris. Il va assister pour la première fois à une séance du Club des hachichins. Créé en 1844 par le médecin et psychiatre Jacques-Joseph Moreau de Tours, ce club accueille scientifiques, hommes de lettres et artistes (Balzac, Baudelaire, Nerval…), qui viennent y expérimenter les effets de psychotropes, principalement le haschich. Dans son texte «Le Club des hachichins»(1), Théophile Gautier narre, sous la forme d’un conte fantastique, l’une de ces rencontres.
À son arrivée à l’hôtel, le médecin lui remet une petite soucoupe de porcelaine du Japon, sur laquelle gît «un morceau de pâte ou confiture verdâtre, gros à peu près comme le pouce». Et lui dit: «Ceci vous sera défalqué sur votre portion de paradis.» Après avoir avalé leur part, les convives se mettent à table. S’ensuivent un repas et une soirée aux allures fantasmagoriques.
«Peu à peu le salon s’était rempli de figures extraordinaires, comme on n’en trouve que dans les eaux-fortes de Callot et dans les aquatintes de Goya*: un pêle-mêle d’oripeaux et de haillons caractéristiques, de formes humaines et bestiales: en toute autre occasion, j’eusse été peut-être inquiet d’une pareille compagnie, mais il n’y avait rien de menaçant dans cette monstruosité. C’était la malice, et non la férocité qui faisait pétiller ces prunelles […]»
«Plus loin se démenaient confusément les fantaisies des songes drolatiques, créations hybrides, mélange informe de l’homme, de la bête et de l’ustensile, moines ayant des roues pour pieds et des marmites pour ventre, guerriers bardés de vaisselle brandissant des sabres de bois dans des serres d’oiseau, hommes d’État mus par des engrenages de tournebroche […]»
L’«écriture de la drogue» est un corpus de textes «qui parlent de l’expérience de l’écrivain sous influence», explique Annie Monette, chercheuse en études littéraires à l’Université du Québec à Montréal(2). Elle diffère de la «littérature de la drogue», plus large, qui englobe tous les écrits mettant en scène usages et usagers. «Écrire sous drogue, c’est quelque chose de très difficile, commente la chercheuse. Les quelques écrivains qui tentent de le faire se heurtent à de nombreux écueils parce que la drogue vient perturber toutes sortes de fonctions dont ils ont besoin.» Exemple? Henri Michaux (1899-1984), sous mescaline, n’est parfois plus capable de tenir son stylo. Il se contente de noter des traits pour signifier une petite ou une plus longue «absence». Dans la plupart des cas, l’expérience est donc réécrite a posteriori.
Promotion vs condamnation
L’écriture et plus largement la «littérature de la drogue» témoignent de l’histoire des consommations. Haschich et opium chez les écrivains de la période romantique, cocaïne dans les années vingt (les «années folles»), LSD et autres hallucinogènes chez les artistes de la contre-culture des années cinquante et soixante, ecstasy et excitants dans notre société de consommation. Sans surprise, les textes reflètent aussi les débats qui touchent à ces produits. Avant même l’existence de mesures législatives prohibitives (les premières conventions qui interdisent l’usage de l’opium datent des années 1910), certains auteurs promeuvent ou dénoncent l’usage de produits psychotropes.
Théophile Gautier par exemple, s’il décrit des hallucinations qui peuvent virer au cauchemar après avoir ingéré de la pâte de chanvre, n’en vante pas moins «les fabuleux prodiges».
«J’ai compris alors le plaisir qu’éprouvent, suivant leur degré de perfection, les esprits et les anges en traversant les éthers et les cieux, et à quoi l’éternité voulait s’occuper dans les paradis. Rien de matériel ne se mêlait à cette extase; aucun désir terrestre n’en altérait la pureté. D’ailleurs, l’amour lui-même n’aurait pu l’augmenter, Roméo hachichin eût oublié Juliette.»
Baudelaire se montre beaucoup plus critique. Il vénère l’alcool, qui «exalte la volonté» et «rend bon et sociable», et tolère l’opium, qu’il consomme pour des raisons médicales et dont il est devenu dépendant (le laudanum, teinture alcoolique d’opium, est utilisé comme analgésique depuis le XVIe siècle et jusqu’au début du XXe): «[…] Dans le cas du Mangeur d’opium, il n’y a pas de crime, il n’y a que faiblesse, et encore faiblesse si facile à excuser.» Il éprouve en revanche une farouche aversion pour le haschich, qu’il considère comme avilissant pour l’homme et déshonorant pour le poète.
«La volonté surtout est attaquée, de toutes les facultés les plus précieuses. On dit, et c’est presque vrai, que cette substance ne cause aucun mal physique, aucun mal grave, du moins. Mais peut-on affirmer qu’un homme incapable d’action, et propre seulement aux rêves, se porterait vraiment bien, quand même tous ses membres seraient en bon état? Or, nous connaissons assez la nature humaine pour savoir qu’un homme qui peut, avec une cuillérée de confiture, se procurer instantanément tous les biens du ciel et de la terre, n’en gagnera jamais la millième partie par le travail. Se figure-t-on un État dont tous les citoyens s’enivreraient de haschich? Quels citoyens! quels guerriers! quels législateurs!» (Paradis artificiels, 1860)
La désapprobation quant à l’usage de psychotropes émaille les écrits au cours du temps. Les années 80, marquées par la crise économique et l’expansion de l’épidémie du sida, sont le terreau de romans pour ados qui évoquent le vécu de jeunes aux prises avec les difficultés les plus sordides (drogues, avortements, viols…). L’un des plus connus: L’herbe bleue (Beatrice Sparks, 1972), aux tonalités moralisatrices.
Burroughs anti-prohibition
De son côté, William S. Burroughs, figure emblématique de la Beat Generation, évite tout excès de romantisme ou de moralisme. Avec son premier ouvrage Junky publié en 1953, il expose tant les plaisirs des premiers flashs d’héroïne que les angoisses et douleurs du manque. Il dépeint un tableau, l’univers de la came, avec ses personnages et ses routines: les «péripéties d’une accoutumance», le «besoin qui dévore», les «courses nocturnes pour s’approvisionner», «l’ennui des jours». Bref, «une histoire vraie des vraies horreurs d’un vice», selon son ami le poète Allen Ginsberg(3).
Les années cinquante sont celles du maccarthysme, de la chasse au communisme, mais aussi à l’immoralité et aux drogues. Le sujet est à ce moment si délicat que la première maison d’édition, Ace Books, insère dans le texte un certain nombre de commentaires inquiets («Cette déclaration est simple ouï-dire»; «Cela est contredit par les autorités médicales reconnues») ainsi qu’une «note de l’éditeur» à visée dissuasive, explique Oliver Harris, professeur de littérature américaine (Keele University)(4).
Le contexte politique n’empêche pas Burroughs de s’opposer ouvertement aux politiques répressives. «Quand je m’étais tiré des États-Unis, la came était déjà un sujet brûlant. Les premiers symptômes de l’hystérie générale apparaissaient clairement. L’État de Louisiane avait voté une loi faisant de tout intoxiqué un criminel. Comme […] le mot ‘intoxiqué’ n’était même pas défini, il n’était pas nécessaire ni utile d’avoir des preuves pour vous arrêter. […] C’était une législation policière condamnant un mode de vie. […] Je voyais mes chances d’échapper à une condamnation s’amenuiser de jour en jour tandis que la mentalité antidrogue devenait une paranoïa obsessionnelle pareille à l’antisémitisme sous les nazis.»
L’auteur fustige le manque d’infrastructures de soins. Il interroge aussi la frontière arbitraire entre drogues légales et illégales. Lors de l’une de ses nombreuses tentatives pour se défaire de l’héroïne, le protagoniste se met à boire de l’alcool jusqu’à plus soif. Il est ivre de jour comme de nuit et, après dix jours à ce régime, il se trouve «dans un état lamentable»: «Je ne me lavais plus. J’avais maigri, mes mains tremblaient, je renversais tout, me prenais les pieds dans les chaises et tombais. Mais je paraissais avoir une énergie illimitée et une capacité à boire que je ne me connaissais pas […].» Au cours de l’une de ses visites, Ike, son ami – et dealer par ailleurs – déclare être «content de le voir arrêter la came», mais juge sévèrement son alcoolisme: «Tu bois et tu deviens cinglé: ça me fait mal au cœur de te voir renoncer à la drogue (héroïne) pour quelque chose de pire. J’en connais des tas qui ont arrêté de se camer. […] Ils se mettent aussitôt à boire et ils claquent au bout de deux ou trois ans.»
Surtout, Burroughs réprouve l’hypocrisie qui entoure le sujet de l’addiction, dénonçant «les coups médiatiques des autorités pour soulever l’opinion publique contre la came et faire passer de nouvelles lois», de même que les pratiques policières en matière de stupéfiants: «Maintenant que le Bureau des Narcotiques a décidé de boucler tous les camés des États-Unis, il lui faut, pour opérer, un nombre accru d’agents. Pas uniquement un nombre accru, mais aussi un type nouveau. […] Des drogués entrent maintenant dans la brigade des stupéfiants pour avoir de la came gratis et une impunité totale.»
Dans l’introduction à son récit, l’écrivain pointe en fait du doigt l’engrenage sans fin dans lequel la politique de prohibition a mis le pied. Un extrait aux accents contemporains(5):
«La dépendance à la came ne se limite pas aux drogués. Nombreux sont les agents des stups et les revendeurs non drogués qui dépendent autant de la came que le premier drogué venu. Ils n’en prennent pas, mais ils en ont besoin, et pas uniquement pour gagner de quoi vivre. Le zèle de certains policiers procède d’un lien spécial avec la came. Ce sont des drogués au second degré, et pour cet état-là, point de remède.»
* Eaux-fortes: gravures sur cuivre (Jacques Callot, XVIIe siècle), les aquatintes étant un procédé particulier de gravures à l’eau-forte (Goya, fin XVIIIe siècle).
(1) «Le Club des hachichins», Théophile Gautier, paru dans la Revue des deux Mondes, 1er février 1846.
(2) Sur Radio Canada: https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/c-est-fou/segments/entrevue/18298/drogue-romans-ecrivains-psychotropes-annie-monette.
(3) Extrait d’une lettre d’Allen Ginsberg adressée à Ace Books (12 avril 1952).
(4) Junky. Le texte définitif de «Junk», William S. Burroughs, édition établie et présentée par Oliver Harris, Éditions Gallimard, 2008 et 2016 pour la traduction en français.
(5) Lire à ce sujet le dossier «Répression des drogues: peine perdue», Alter Échos 465, juillet 2018.