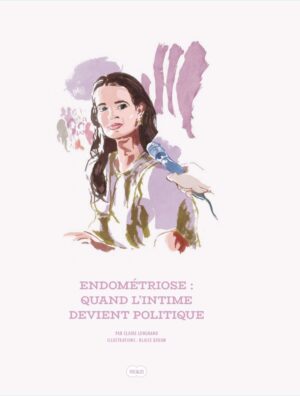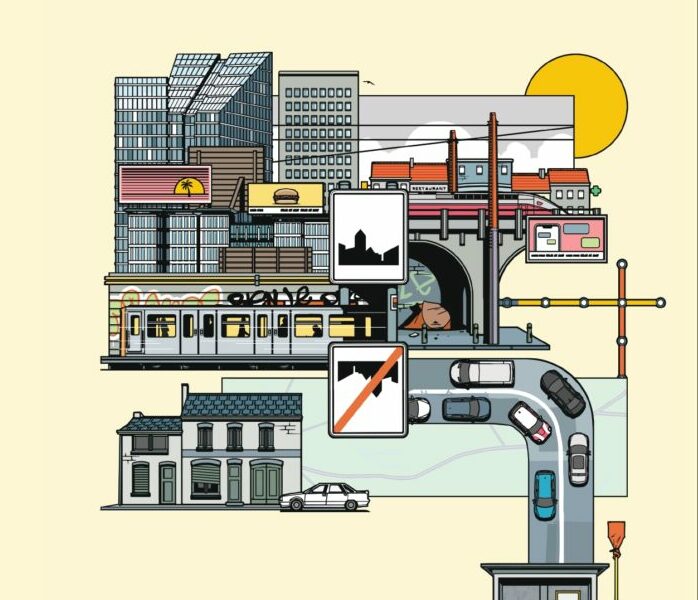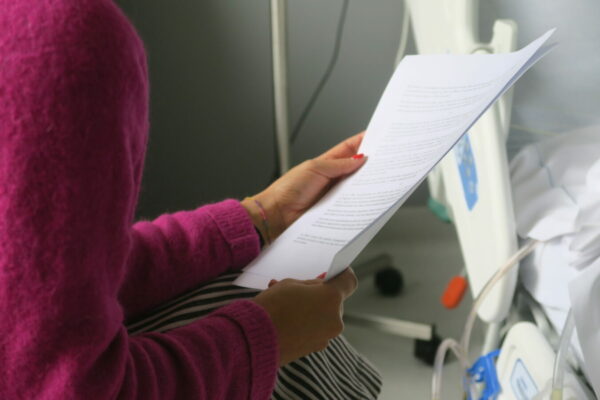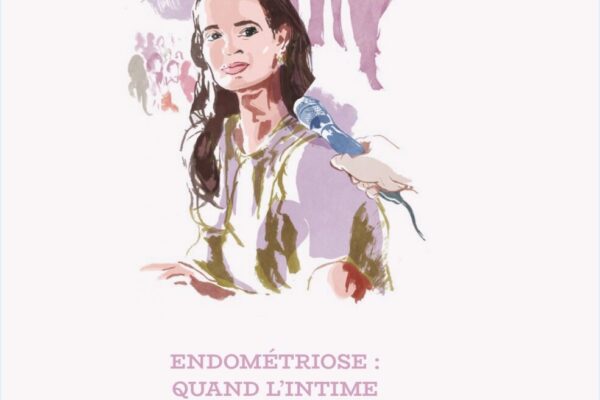En lançant l’appel à témoignage, il a fallu seulement quelques heures pour être contactée par des jeunes queers et/ou racisés ayant grandi en campagne prêts à témoigner. Chaque fois, cette même phrase est revenue: «Il y a beaucoup de choses à dire!» David et Gaspard le disent depuis leur ville-bouée. Tigy et Nolwenn par appel, depuis leur maison familiale respective qu’elles ne quittent presque pas durant leurs brefs retours en campagne. Ils et elles sont le reflet d’une jeunesse malmenée par le manque de diversité de nos zones rurales.
En Wallonie, le brassage culturel reste moindre qu’à Bruxelles, mais il y a tout de même 25,5% de personnes d’origine étrangère, selon l’office belge de statistique Statbel. Parmi elles, 41,2% sont issues d’un pays situé en dehors de la zone euro. Cependant, l’étude ne précise pas combien vivent en ville et en zone rurale. Même chose pour les personnes LGBTQIA+. Selon une enquête Ipsos menée en 2023, près d’une personne sur dix est queer en Belgique, mais impossible de savoir si ces personnes se trouvent majoritairement en zone urbaine. Par contre, il suffit de se balader en campagne wallonne, hors des chefs-lieux, pour constater que les personnes racisées et LGBTQIA+ y sont, au minimum, bien moins visibles que dans les villes. Alors, quel impact a ce manque de représentation sur des jeunes qui y grandissent en tant que minorité?
Scolarité abîmée
En Flandre, un élève sur cinq est victime de racisme selon l’association Scholierenkoepel. Et lorsque les parents sont originaires d’un pays hors UE, cela passe à un jeune sur deux. Il n’existe pas de chiffres similaires pour la Wallonie, mais cela ne veut pas dire que les violences racistes n’y existent pas, surtout lorsque les personnes racisées évoluent dans des zones rurales où elles sont peu nombreuses.
La première fois que Nolwenn, 22 ans et d’origine congolaise, entend le «n-word» (expression anglophone pour désigner sans le nommer le mot «nigger», NDLR), elle a seulement 8 ou 9 ans et s’amuse dans la cour de son école à Marche-en-Famenne en province de Luxembourg. «Les garçons jouaient au foot et la balle est arrivée vers moi. Je ne l’ai pas renvoyée et l’un deux m’a lancé ‘sale négresse’. De la manière dont il l’a dit, je savais déjà que c’était violent», raconte-t-elle en jouant avec son collier argenté.
Nolwenn en parle directement à un professeur, mais il ne se passe rien. À moins de 10 ans, elle fait donc également l’expérience de la victimisation secondaire. Cette double violence infligée à une personne victime, ici de racisme, qui subit une réaction inadéquate face à la dénonciation de son vécu. En secondaire, lorsqu’elle décide d’utiliser sa voix pour s’indigner de ce qu’elle vit, le concept de «misogynoire», une combinaison du sexisme et du racisme dont sont victimes les femmes noires, fait son apparition.
Au même moment, dans une école secondaire de Marchin dans la province de Liège, Tigy, 22 ans aujourd’hui, d’origine éthiopienne et adoptée par deux parents blancs, fait face à du «racisme décomplexé». «Un midi, je veux rentrer dans le réfectoire, mais un garçon de rhéto refuse parce que je suis Noire. J’essaye de forcer l’entrée et là, il me touche puis crie ‘Hon non! J’ai touché la Noire!’, avant d’aller se laver les mains, raconte-t-elle depuis sa chambre d’enfant, blottie dans un tee-shirt aussi gris que ce souvenir. J’avais l’impression que le problème venait de moi. Il n’y avait aucune personne qui me ressemble, aucune organisation. Je me suis sentie complètement seule.» Elle a fini par changer d’école en troisième secondaire.
«Un midi, je veux rentrer dans le réfectoire, mais un garçon de rhéto refuse parce que je suis Noire. J’essaye de forcer l’entrée et, là, il me touche puis crie ‘Hon non! J’ai touché, la Noire!’, avant d’aller se laver les mains. J’avais l’impression que le problème venait de moi. Il n’y avait aucune personne qui me ressemble, aucune organisation. Je me suis sentie complètement seule.»
Tigy, 22 ans
Juliette Nijimbere, coordinatrice de l’asbl Ibirezi Vy’Uburundi, sensibilise au racisme à Jodoigne dans le Brabant wallon et dans les villages aux alentours. Depuis 2018, elle mène aussi des animations antiracistes dans des classes de 5e et 6e primaire. Un travail qui permet de défaire les préjugés et d’épauler certains jeunes, qui, comme Tigy, sont parfois les seules personnes racisées de leur école. «J’ai beaucoup d’enfants qui pleurent lorsqu’on aborde la question du racisme. Des enfants qui, avant l’animation, n’ont raconté les discriminations subies ni à leurs parents ni à leurs professeurs», raconte-t-elle.
David, 29 ans, a grandi dans un petit village du côté de Florenville dans la province de Luxembourg. Bien que ce Métis d’origine belgo-mauricienne ne fût pas le seul jeune racisé de son établissement, la solitude était bien présente. «On était tous isolés et je pense que le fait de faire communauté entre personnes racisées aurait fait polémique dans mon village à la mentalité très fermée», raconte-t-il sans détour, sa casquette vissée sur la tête. La solitude se poursuivait aussi à la maison, puisque David a été élevé dans une famille blanche, n’ayant plus de contact avec sa mère mauricienne. Également gay, si aujourd’hui il affirme ouvertement son homosexualité, à l’époque du lycée et de sa vie en campagne, pas question pour lui d’en parler. «J’avais l’impression que faire un coming out aurait été comme tendre un bâton pour se faire battre.»
Vivre son homosexualité dans le secret, Gaspard en a aussi fait l’expérience. Âgé de 28 ans, il a fait toute sa scolarité à Louvain-la-Neuve, mais a grandi dans les alentours, notamment à Chastre dans le Brabant wallon. Gaspard revient sur cette période compliquée d’une voix douce, en passant sa main dans son mulet brun foncé: «C’était un enjeu pour moi de rester discret parce que j’avais des camarades ou potes gay qui subissaient des violences homophobes, comme se faire cracher dessus dans la cour de récré.» Pourtant, au même moment, Gaspard vit ses premières expériences romantiques et sexuelles.
Il apprend notamment à se découvrir en tant que queer au Moustachu, un bar gay de Louvain-la-Neuve. Près de chez sa mère, mais à une quarantaine de minutes à pied de chez son père, Gaspard s’y rend tous les vendredis avec ses meilleurs potes gay, même s’«il ne fallait pas être vu là-bas». Puis, le bar a fermé et avec lui une opportunité pour certaines personnes LGBTQIA+ des alentours de se retrouver et de faire communauté.
Partir un jour…
Un jour, la majorité à peine révolue, Nolwenn, Tigy et Gaspard ont décidé de prendre un aller simple pour Bruxelles. David aussi prend le chemin de la ville, mais choisit Liège comme point de chute. Même si l’homophobie et le racisme ne sont pas absents des zones urbaines, ils sont tous les quatre appelés par la promesse de plus de diversité.
La multiculturalité des villes s’explique par le fait que «les migrations se font souvent par des portes d’entrée et les grandes villes en sont», énonce Marco Martiniello, professeur à l’Université de Liège et directeur du Centre d’études de l’ethnicité et des migrations. Arrivée à Bruxelles, Nolwenn rejoint directement une association antiraciste, le cercle culturel afrodescendant BINABI. «Ça m’a fait du bien de voir des personnes qui me ressemblent. Il n’y avait plus constamment cette charge raciale[1] sur mes épaules», dit-elle avec le sourire. «Le milieu urbain reste toujours un fer de lance, notamment pour ce qui est des mouvements antiracistes», ajoute Marco Martiniello.
Au-delà de quitter la campagne pour trouver plus de diversité, pour de nombreux jeunes LGBTQIA+, il est parfois nécessaire d’échapper à sa famille. «Avec le temps, les campagnes se fragmentent, s’individualisent et il y a un repli sur la cellule familiale. Or, les personnes LGBT peuvent se retrouver avec des cellules familiales réduites ou violentes et sont plus centrées sur leur famille ‘choisie’. Sauf que choisir sa famille quand il y a très peu de contacts avec d’autres personnes LGBT, c’est compliqué», énonce Pavel Kunysz, ancien président de la fédération wallonne LGBTQIA+ Prisme.
«Avec le temps, les campagnes se fragmentent, s’individualisent et il y a un repli sur la cellule familiale. Or, les personnes LGBT peuvent se retrouver avec des cellules familiales réduite ou violentes et sont plus centrées sur leur famille ‘choisie’. Sauf que choisir sa famille quand il y a très peu de contacts avec d’autres personnes LGBT, c’est compliqué.»
Pavel Kunysz, ancien président de la fédération wallonne LGBTQIA+ Prisme
David a vécu des expériences difficiles dans son cadre familial et son arrivée en ville lui a permis de respirer. «La ville est beaucoup plus mixte et j’ai compris que ce n’était pas moi le problème même si toute ma vie, dans n’importe quel endroit du monde, j’aurais peur de tenir la main de mon copain.» Les existences des personnes racisées et LGBTQIA+ restent une lutte. En 2024, l’Unia a ouvert 643 dossiers liés à des faits de racisme et en a traité 136 liés à des faits de LGBTIphobie.
«Dans nos expériences de terrain, nous voyons une augmentation de l’intolérance envers les jeunes LGBTQIA+. Tout comme nos collègues de Liège ou Charleroi», énonce Céline Billion, coordinatrice de la MAC Luxembourg. Par exemple, le phénomène des guets-apens homophobes a connu une recrudescence à Bruxelles. Messaline Jaumotte, auteur de l’article «L’arc-en-ciel au-delà des villes» et animateur socioculturel chez Scan-R, confirme: «Il n’y a pas plus ou moins de violence et d’inclusivité dans les campagnes qu’en ville, je le vois aussi dans les classes où je vais. Mais il y a plus de monde dans les secondes, c’est plus rapide de trouver sa communauté. Alors qu’à la campagne, face à des violences, on se retrouve tout seul.»
Sans retour?
Si pour Gaspard aussi, «les paradis LGBTQIA+ n’existent pas», il ne se voit pas quitter la ville pour retourner en campagne… du moins, pour le moment: «D’ici cinq-dix ans peut-être. À condition que ce soit entre queers dans une dynamique plutôt anarchiste et libertaire.» Une possibilité qui confirme l’observation de Messaline Jaumotte: «Les personnes LGBTQIA+, qui créent des événements ou une communauté à la campagne, sont d’abord passées par la ville. Elles y développent des outils parce qu’il y a toujours ce lien fort entre communautés queers et villes.»
Quant à Nolwenn, elle ne se voit pas du tout revenir vivre à Marche-en-Famenne même si elle aime retourner voir sa famille. Même dualité du côté de Tigy, car les violences qu’elle a subies ont sali son rapport à la ruralité. «Je pense que c’est impossible pour une personne racisée de rester.» David le confirme: «Je n’y vais plus du tout à l’heure actuelle parce que chaque fois que j’y suis retourné, ça m’a vraiment fait mal.»
«Il n’y a pas plus ou moins de violence et d’inclusivité dans les campagnes qu’en ville, je le vois aussi dans les classes où je vais. Mais il y a plus de monde dans les secondes, c’est plus rapide de trouver sa communauté. Alors qu’à la campagne, face à des violences, on se retrouve tout seul.»
Messaline Jaumotte, auteur de l’article «L’arc-en-ciel au-delà des villes» et animateur socioculturel chez Scan-R
Impossible de refaire le passé, mais il est encore assez tôt pour les futures générations queers et racisées qui vont grandir en zone rurale. Tigy insiste sur l’importance de sécuriser l’existence des personnes racisées pour permettre plus de diversité sur le long terme. Les voix de Gaspard et Nolwenn se rejoignent: peut-être faudrait-il des associations, des référents et des professionnels formés au sein même des établissements scolaires. Ces initiatives auraient pu permettre à Gaspard d’être, plus tôt encore, «un PD fier».
À travers leurs animations, Messaline Jaumotte et Juliette Nijimbere participent à rendre les espaces plus «safe» et agréables pour les jeunes queers et racisés de nos campagnes. Pourtant, ils ne sont pas encore les bienvenues dans toutes les écoles. «Si j’utilisais les mots ‘lutte contre le harcèlement’, les établissements accepteraient beaucoup plus facilement…», assure Juliette Nijimbere.
[1] Développée par la chercheuse Maboula Soumahoro, la charge raciale est «la tâche épuisante d’expliquer, de traduire, de rendre intelligibles les situations violentes, discriminantes ou racistes».