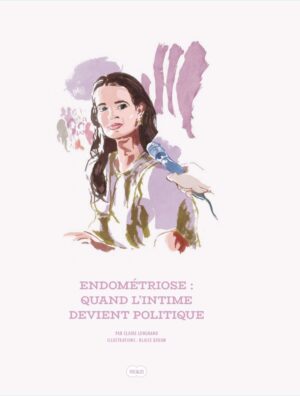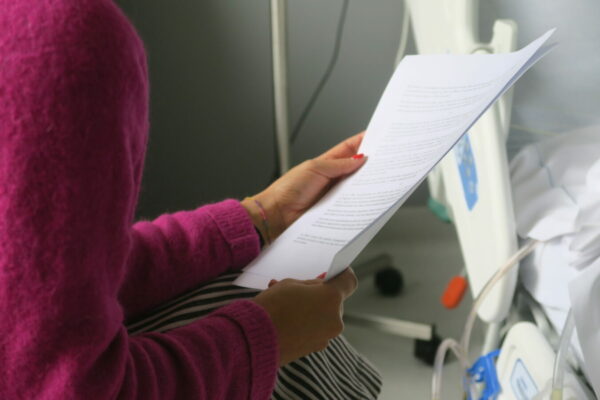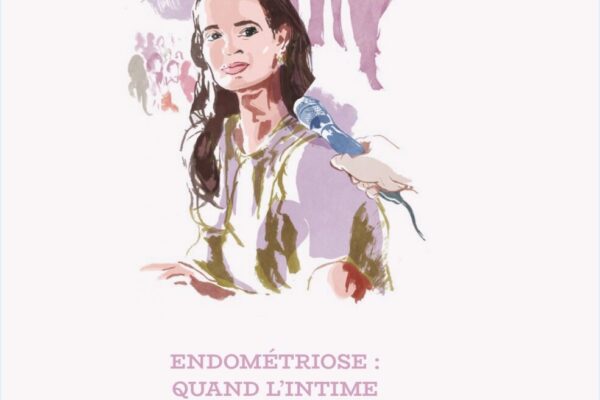Le ciel déjà bien sombre de l’Europe sociale s’est encore un peu plus obscurci le 14 janvier dernier. Ce jour-là, dans un avis adressé à la Cour de justice de l’Union européenne (UE), l’avocat général Nicholas Emiliou préconisait ni plus ni moins l’annulation «intégrale» – si ça ne tenait qu’à lui – ou, au mieux, partielle de la directive sur les salaires minimaux.
Passée presque inaperçue, l’analyse de l’avocat général chypriote pourrait pourtant avoir de lourdes conséquences pour les travailleurs. «Le précédent serait énorme», confirme d’emblée Rafael Lamas, directeur à l’international et aux affaires européennes à la FGTB. «Les objectifs sociaux de l’UE seraient totalement sapés, et l’équilibre entre une Europe économique et une Europe sociale basculerait entièrement en faveur de la première.»
Les enjeux sociaux sont majeurs. Pour en saisir la portée, il faut remonter à octobre 2022: après deux ans de négociations tendues, l’UE adoptait pour la première fois une loi visant à améliorer les salaires minimaux en Europe.
«Cette directive marque une avancée majeure vers une Europe plus sociale», explique à Alter Échos la députée fédérale Écolo Sarah Schlitz. «Elle ne fixe pas un salaire minimum uniforme, mais oblige les États membres à garantir des rémunérations décentes et à renforcer la négociation collective.»
Et pour cause: l’Europe reste marquée par de fortes disparités salariales. En 2020, juste avant la présentation de la directive, le salaire minimum brut atteignait 2.090 euros au Luxembourg, contre seulement 286 euros en Bulgarie, soit un écart de un à sept.
La directive est «un outil crucial contre le dumping social et pour rééquilibrer les rapports de force entre employeurs et travailleurs», poursuit l’écologiste, rappelant qu’en Belgique, le texte législatif pourrait soutenir l’action syndicale dans les secteurs les plus fragiles et favoriser une revalorisation des salaires les plus bas.
Contorsion juridique
L’écriture de la loi a constitué un véritable imbroglio juridique et les législateurs ont dû redoubler de créativité, non sans une certaine prise de risque. L’article 153 (5) du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne interdit explicitement à l’Union européenne de s’immiscer directement dans les rémunérations.
Louvoyant entre les obstacles juridiques, la Commission a invoqué l’article 153 (1, b) qui autorise l’Union à compléter les activités des États membres sur les conditions de travail, et l’article 153 (2), qui permet de fixer des exigences minimales via des directives dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité.
«Les objectifs sociaux de l’UE seraient totalement sapés, et l’équilibre entre une Europe économique et une Europe sociale basculerait entièrement en faveur de la première.»
Rafael Lamas, FGTB, en évoquant la possible annulation de la directive
Résultat: une directive aux allures de recommandation. L’article 5 invite les États à évaluer l’adéquation des salaires minimaux légaux, en s’appuyant sur des références internationales (60 % du salaire médian brut, 50 % du salaire moyen brut). De même, dans les pays où la couverture des négociations collectives reste sous les 80 %, un plan d’action publique doit être transmis à la Commission, avec calendrier, mesures concrètes et évaluation quinquennale. Mais aucune intervention directe.
Grâce à sa souplesse juridique, le texte a été adopté sans difficulté au Conseil, à l’exception du rejet de la Suède et du Danemark. Ces deux pays ont toujours dénoncé une atteinte à leurs compétences sociales et surtout à l’autonomie des partenaires sociaux, redoutant l’imposition d’un salaire minimum légal.
Dès décembre 2020, un mois après la proposition de la Commission, le Parlement suédois lançait une mise en garde aux colégislateurs européens: «La proposition constitue une menace réelle pour le modèle du marché du travail suédois, car elle permettra à la Cour de justice de l’Union européenne d’examiner tant les salaires en Suède que le modèle suédois de convention collective.»
Le traumatisme Laval
La référence explicite à la Cour renvoie à un véritable traumatisme collectif: l’arrêt Laval de 2007. Saisie sur un conflit opposant un syndicat suédois et une entreprise lettonne détachant ses travailleurs en Suède, la Cour avait jugé que le droit de grève pouvait être restreint s’il entravait excessivement la libre prestation de services. La lecture de l’institution judiciaire avait sidéré les syndicats à l’époque et fait aujourd’hui encore couler beaucoup d’encre.
Dès lors, l’annonce d’une directive pour renforcer les salaires minimaux a semé la panique chez les syndicats scandinaves, redoutant une nouvelle interprétation abusive par la Cour. En décembre 2021, le syndicat suédois LO suspendait ses cotisations à la Confédération européenne des syndicats (CES), dénonçant une trahison concernant la directive. «Nous ne pouvons pas payer quelqu’un qui nous assassine», avait alors justifié son secrétaire, Torbjörn Johansson.
«Cette directive marque une avancée majeure vers une Europe plus sociale»
Sarah Schlitz, députée fédérale Écolo
Début 2023, le couperet tombait. Copenhague et Stockholm lançaient une action en annulation devant la Cour. Leur action a immédiatement suscité une levée de boucliers de nombreux États européens, dont la Belgique, aussitôt «intervenue avec d’autres pour soutenir le Conseil et la Commission quant à la légalité de cette directive», se rappelle une source diplomatique.
La CES a vite réagi en opposant un contravis juridique à «l’opinion aberrante» de l’avocat général Emiliou, selon sa secrétaire générale Ester Lynch. «L’Union européenne a au contraire l’obligation de prendre des mesures positives pour protéger les droits collectifs des travailleurs, garantis par la Convention européenne des droits de l’homme et la Charte sociale européenne», a fustigé la représentante syndicale.
La Commission européenne se dit confiante. Une analyse «juridique approfondie» avait été menée, nous assure-t-elle, notamment sur l’article 5 concernant la procédure de fixation des salaires minimaux, en ligne avec les principes de subsidiarité et de proportionnalité. Cette analyse a été par ailleurs validée par les services juridiques du Conseil et du Parlement européen, affirme l’institution.
Un boulevard ouvert pour les politiques antisociales
La confirmation de l’invalidité de cette directive aurait des répercussions insondables, notamment en Belgique. «Cela ralentirait la dynamique en faveur d’un renforcement des syndicats là où ils sont affaiblis, et donc aussi en Belgique, où la couverture syndicale est en deçà du seuil de 80 % recommandé, rappelle la députée Schlitz. En Belgique, c’est bien la négociation collective qui tire les salaires vers le haut.»
D’autant que pour la députée, le salaire minimum légal – 2.070,48 euros début 2025 – reste trop bas, surtout dans les grandes villes. «À Bruxelles ou à Anvers, une personne seule au salaire minimum, même à temps plein, peut se retrouver (…) proche ou en dessous du seuil de pauvreté. Ce constat est encore plus dur pour les parents solos ou les temps partiels contraints.»
Et les perspectives ne sont guère encourageantes. La députée pointe la volonté du gouvernement Arizona de comprimer les salaires: travail de nuit repoussé à minuit, affaiblissement de la protection syndicale, droit de manifester restreint et maintien de la loi de 1996 qui plafonne les hausses salariales.
«La proposition constitue une menace réelle pour le modèle du marché du travail suédois, car elle permettra à la Cour de justice de l’Union européenne d’examiner tant les salaires en Suède que le modèle suédois de convention collective.»
Le parlement suédois en 2020, à propos de la directive
Pour elle, attaquer la directive revient donc à «faire le jeu de ceux qui veulent maintenir la concurrence sociale entre États membres». «Les sociétés d’Europe de l’Est ont davantage besoin de cette directive, bien plus que nous ou les Scandinaves», renchérit pour sa part Raphaël Lamas de la FGTB.
Selon la Commission européenne, les salaires réels ont chuté de 3,9 % en 2022 et de 0,4 % en 2023, avec un léger rebond depuis. Ils restent toutefois en dessous du niveau de 2019 dans de nombreux pays. La couverture des négociations collectives stagne elle aussi: en 2024, seuls huit États atteignaient le seuil de 80 % fixé par la directive, 13 % en Pologne, 14 % en Grèce et 15 % en Roumanie.
Pour les syndicats, l’arrêt sera un test crucial pour le projet social européen. Le doute est réel. La Cour suit souvent l’avis de l’avocat général, entre deux tiers et quatre cinquièmes des cas, selon les études. Et elle a déjà annulé des textes législatifs par le passé, comme celui de la directive de 2014 sur les services de communications électroniques. Verdict attendu en octobre.