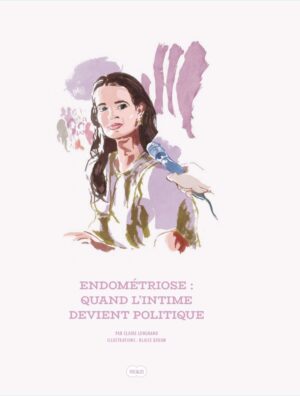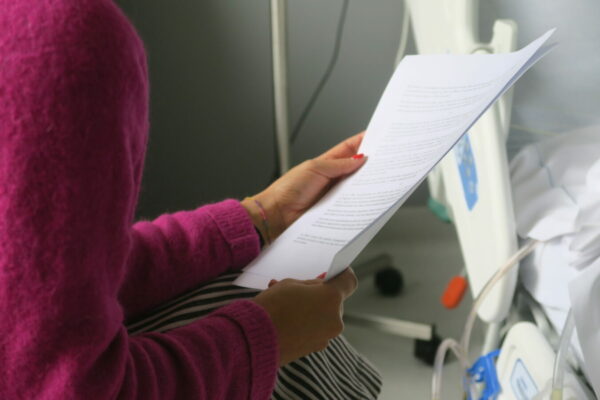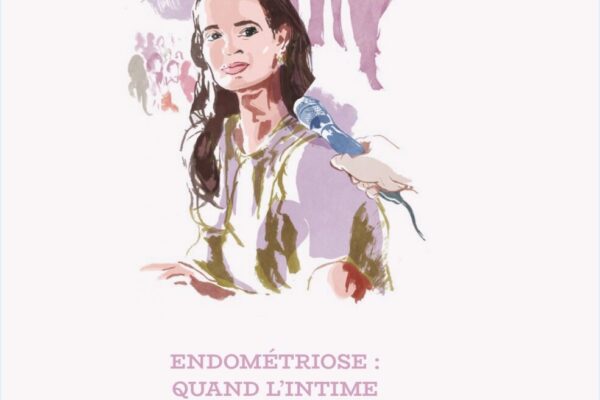Il y avait huit partis autour de la table des négociations, soit le double de la coalition fédérale de l’époque. Au printemps 1998, les libéraux et les écologistes ne sont pas au gouvernement, mais ils montent à bord et rejoignent ainsi les socialistes et les sociaux-chrétiens pour mener ensemble une mégaréforme – police et justice –, évidente et urgente, vu le désastre de l’affaire Dutroux survenue deux ans plus tôt (enlèvement, séquestration, viol et meurtre de filles mineures). En 1996, la Belgique découvrait que la police et la gendarmerie se faisaient la guerre, retenaient des informations capitales, ne collaboraient pas et que cela déclenchait de graves conséquences. Ensuite, le 23 avril 1998, lorsque Marc Dutroux, incarcéré, échappe à la police et à la justice pendant quelques heures, avant d’être retrouvé par un garde champêtre wallon… Le pays comprend que la répartition du territoire entre les gendarmes (plutôt campagnes) et les policiers (plutôt villes) est hautement problématique.
Octopus: huit bras et beaucoup de ventouses
Vu le désastre, deux ministres (Intérieur et Justice) démissionnent dès le lendemain de l’évasion, le 24 avril 1998. Quant au Premier ministre, Jean-Luc Dehaene, lui aussi est prêt à démissionner… Il se fait rattraper par Louis Michel dans l’hémicycle du parlement. Le président des libéraux francophones (le PRL, devenu le MR) et chef de l’opposition à la Chambre lui dit: «Ne fais pas ça, ne démissionne pas.» Il lui propose de travailler ensemble sur une grande réforme, lui indique qu’il peut compter sur les libéraux depuis l’opposition. «L’important, c’était de réformer la police et la justice, souligne aujourd’hui encore Louis Michel. On a réussi à faire une loi ‘opposition et majorité’, sans calcul partisan.» Ce sont les accords dits «Octopus» – soit «pieuvre» en français, avec huit bras et beaucoup de ventouses. Il y avait huit partis autour de la table: sociaux-chrétiens, socialistes, écologistes, libéraux, francophones et néerlandophones. Un grand gagnant? «Pour nous, les libéraux, les accords Octopus ont été le pas de porte pour revenir au pouvoir, se félicite encore Louis Michel. Notre attitude non partisane nous a ramenés dans une certaine forme de fréquentabilité. D’ailleurs, j’ai formé le gouvernement fédéral suivant, en 1999, et Antoine Duquesne est devenu ministre de l’Intérieur pour mettre en place la réforme des polices.»
«L’important, c’était de réformer la police et la justice, souligne aujourd’hui encore Louis Michel. On a réussi à faire une loi ‘opposition et majorité’, sans calcul partisan.»
En un mois, le volet «police» est négocié. Le samedi 23 mai 1998, une dépêche Belga pointe à 22 h 42 pour annoncer un «accord global», finalisé ce jour-là après quatre heures de discussion, pour «une réforme phasée et simultanée menant à une police fédérale et à une police locale». Les services de police vont connaître la réorganisation complète tant attendue. La police sera désormais «intégrée», c’est-à-dire qu’elle fonctionnera à deux niveaux (1) au sein d’un même corps, plutôt qu’à deux corps qui ne se parlent pas.

Et donc: la gendarmerie disparaît. Principalement active dans les campagnes, et au départ pour porter renfort aux gardes champêtres, les gendarmes formaient un «corps d’élite», «une sorte de police militaire qui faisait du travail civil sur le territoire». Les décideurs politiques interviewés pour cet article et actifs en 2000, soit au moment de la mise en route de la police intégrée, évoquent un «état-major» à la très (trop) grande autonomie. «La loi de 1998 met fin à la toute-puissance de la gendarmerie», résume Olivier Maingain (ex-FDF, l’ancêtre de DéFi).
Sept missions de base
Telles que redéfinies, les zones de police locale doivent désormais assurer sept missions de base2. Or, pour assurer cela, il faut du monde. Qui? Combien? Trente, quarante, cinquante policier(ère)s par zone? La fameuse norme KUL, établie en 1999, déterminera une «capacité policière théorique» par commune, basée sur 14 paramètres3. «Dès le départ, la norme KUL était contestée, mais ici, elle a été bien perçue, indique Willy Demeyer (PS, bourgmestre de Liège depuis 1999). Disons que dans les grandes zones, on ne s’est pas beaucoup tracassé de savoir quel était le chiffre. On a additionné les gendarmes casernés sur la zone aux policiers communaux déjà sur place, et on a dit: ‘Voilà, c’est ça.’ Et à Liège, c’était – et c’est toujours — 1.113 policiers.»
Liège est une version relativement «simple» de la réforme au sens où la ville et la zone de police sont identiques (zone monocommunale), ce qui donne une unité de commandement unique. Dans d’autres cas, et spécialement hors des grosses agglomérations, plusieurs communes doivent cohabiter au sein d’une même zone de police (zone pluricommunale) afin de se partager une équipe de police qui puisse assurer les sept missions de base prévues. Les bataillons de l’ex-gendarmerie sont prioritairement dirigés vers les petites communes et les zones de police pluricommunales, dites «rurales», qui étaient moins fournies en policiers que les zones urbaines. «Malgré le regroupement, on n’est pas arrivé au niveau de suffisance dans certaines zones pour assurer les services de police 24 h/24», souligne Olivier Maingain (ex-FDF, bourgmestre de Woluwe-Saint-Lambert, qui a participé aux prémices des zones de police).
Les bataillons de l’ex-gendarmerie sont prioritairement dirigés vers les petites communes et les zones de police pluricommunales, dites «rurales», qui étaient moins fournies en policiers que les zones urbaines.
Au sein de la Région bruxelloise, ça se passe relativement bien, avec peu de regroupements – «on considérait que Bruxelles était suffisamment étoffée en policiers». Mais en dehors… Olivier Maingain cite des cas (encore valables aujourd’hui) de communes de la périphérie bruxelloise qui renvoient les citoyen(ne)s à Bruxelles pour enregistrer leurs plaintes s’il s’agit d’incidents nocturnes. Willy Demeyer, pareil: il mentionne les zones de police pluricommunales situées autour de Liège, toutes en sous-effectifs, qui renvoient les plaignant(e)s vers «Natalis» (soit le commissariat de la police de Liège, situé rue Natalis 60-64) pour toute intervention le week-end. «Les zones des grandes villes assument des missions pour leur environnement proche», résume Willy Demeyer, vingt-cinq ans après l’instauration des zones de police. Le bourgmestre liégeois enchaîne avec un autre point, apparu après 1998, mais qui ne cesse de s’aggraver: les tâches de la police fédérale qui retombent, de plus en plus, vu les coupes budgétaires aux niveaux supérieurs, sur les agents locaux. «À Liège, notre brigade judiciaire compte une centaine d’agents, mais on nous refile des enquêtes qui devraient être faites par le fédéral. Tout cela se fait au détriment de la police de quartier…» Pourtant, la proximité figurait dans l’esprit et l’intention de l’apparition de la police intégrée en 1998.
Totalement déséquilibré?
«Il a fallu trois ans pour que les zones de police se mettent en place», rappelle Olivier Maingain. Les discussions sont alors plus complexes que l’accord général de 1998, puisqu’elles mêlent territoires et… financements. La norme KUL détermine le nombre d’effectifs, qui déterminent la dotation fédérale prévue pour chaque commune afin de financer une partie de son staff policier. «Je me souviens d’une réunion au Mouvement réformateur lors de laquelle j’étais assis à côté du bourgmestre de Bastogne», détaille Bernard Clerfayt, en reprenant son ancienne casquette de bourgmestre de Schaerbeek (en 2001, il était sous la bannière du FDF, alors allié au PRL, devenu depuis le MR). À Bastogne comme à Schaerbeek, explique-t-il, l’État fédéral s’était engagé à fournir (et surtout à financer) 40 ex-gendarmes. Équitable. Cependant, Bastogne nécessitait, d’après la norme KUL, un nombre total de policiers bien moindre que Schaerbeek: 50 pour Bastogne, 440 pour Schaerbeek. Résultat des courses: «Sur ses 50 policiers prévus par la norme KUL, le bourgmestre de Bastogne devait en payer 10 de la poche des Bastognards, soit ceux qu’il avait déjà avant la réforme, tandis que l’État fédéral allait, lui, en payer 40 nouveaux. À Schaerbeek, je payais de ma poche les 400 policiers qu’on avait déjà et l’État fédéral en ajoutait 40.» Toujours équitable? Totalement déséquilibré, estime Bernard Clerfayt. «L’organisation policière antérieure à la réforme de 1998 a créé un gigantesque déséquilibre dans les financements, puisque l’État fédéral a gardé la logique de payer la police dans les campagnes et de laisser les villes, historiquement riches, assumer seules les grandes polices urbaines. Ça fonctionnait dans les années 1950 et 1960, mais à partir de 1970, les villes ont commencé à s’appauvrir… Or les villes ont continué, et continuent depuis, à avoir des charges de police très élevées. Pourtant, nous ne sommes plus aussi riches que cela.» Et Willy Demeyer, du même avis, souligne simplement ceci: «La plus petite zone en province de Luxembourg est mieux financée par le fédéral que la plus grosse zone de Liège, par tête de policier.»

«C’est toujours la même chose: les bourgmestres veulent faire payer davantage le fédéral pour leur police», résume Louis Tobback. Socialiste flamand, il était à la manœuvre pour les accords Octopus, en tant que ministre de l’Intérieur en 1998. Pour lui, cette tension perpétuelle entre les bourgmestres et le fédéral résulte d’une gestion bancale du territoire en Belgique. Il n’existe pas vraiment de «zones rurales» en Belgique, dit-il, qui seraient exemptes d’enjeux sécuritaires. «Pendant des années, des communes se sont dites ‘rurales’, mais, dans la plupart des cas, elles sont situées autour de Louvain, Anvers, Gand, Liège, Bruxelles… Ce n’est pas rural! C’est le prolongement des villes! Ces communes devraient payer pour leur sécurité. Or, pour le moment, ces communes paient beaucoup trop peu leur police locale. C’est là toute la perversité du système: ces bourgmestres veulent garder leurs impôts très bas, beaucoup plus bas que dans les villes, parce qu’ils aiment attirer une bourgeoisie qui paie moins d’impôts chez eux.»
«C’est toujours la même chose: les bourgmestres veulent faire payer davantage le fédéral pour leur police.»
Louis Tobback
L’actuel ministre de l’Intérieur, Bernard Quintin (MR), aura du fil à retordre sur le dossier «police», poursuit Louis Tobback. «Les bourgmestres ne sont pas prêts à céder, dit-il, et ils ont raison, d’un point de vue tactique, parce que dans leur for intérieur, ils savent bien que, tôt ou tard, on se demandera à quoi ils servent et pourquoi ils maintiennent un faux-fuyant sur la sécurité.» C’est ainsi qu’un ancien ministre de l’Intérieur socialiste (Tobback) se retrouve à admirer son successeur libéral (Quintin) «pour sa poigne». «Il en aura grand besoin.» Il s’agit aujourd’hui, pour Bernard Quintin, de toucher à la norme KUL, qui semble inscrite dans le marbre depuis 1999. «Est-ce que ce qu’on a fait en ce temps-là est parfait?», demande Louis Tobback au regard de l’ensemble de la réforme des polices. Non, mais c’était un énorme pas en avant.
- Les accords Octopus ont été transposés dans la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux et organisé en 196 zones de police locale.
- Travail de quartier; accueil; intervention; assistance policière aux victimes; gestion négociée de l’espace public; recherche et enquêtes locales; circulation.
- Le degré d’équipement de la commune, le revenu net imposable moyen par habitant, ou encore la proportion de seniors dans la population sont autant d’indicateurs pris en compte.