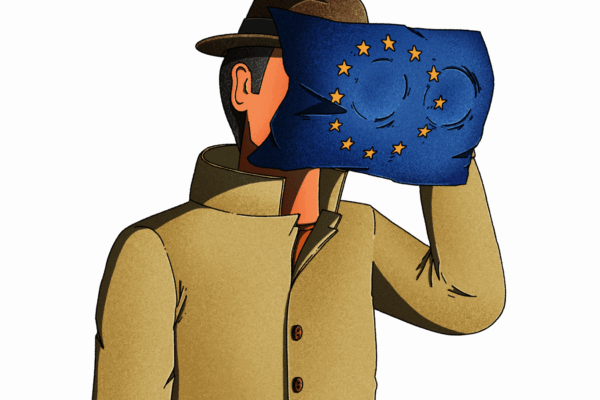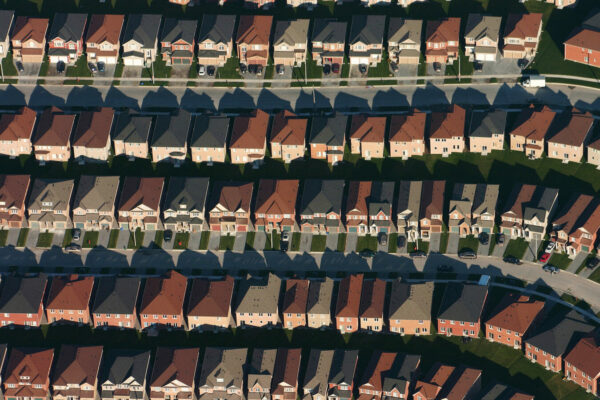C’est une histoire somme toute classique. Début des années 2010, Kalvin Soiresse Njall, journaliste d’origine togolaise et future figure des luttes décoloniales en Belgique, est de sortie au Châtelain, quartier cossu de la commune d’Ixelles. Arrivé face à un bar de nuit qui lui fait de l’œil, l’homme se présente au vigile… qui lui refuse l’entrée. «Il aurait pu invoquer le fameux ‘code vestimentaire obligatoire’ ou le manque de place à l’intérieur, ironise Njall. Lui a préféré exiger une carte de membre. Le même soir, d’autres connaissances – blanches – ont pourtant pu rentrer sans aucune contrepartie.» Quelques années plus tard, alors conseiller juridique au MRAX, le Mouvement contre le racisme, l’antisémitisme et la xénophobie, Kalvin Soiresse Njall va vivre une expérience similaire lors de testings effectués dans des établissements ciblés pour leur mauvaise réputation, en compagnie d’individus habillés de la même manière, mais de couleurs de peau différentes. «Les Blancs rentraient systématiquement, se souvient-il. Parfois, certaines femmes noires étaient admises, mais jamais les hommes d’origine étrangère. Et ces habitudes n’appartiennent pas au passé: c’est la réalité quotidienne et concrète de centaines de personnes.» Devenu député bruxellois, l’écologiste a décidé de porter la problématique devant le Parlement après une nouvelle affaire médiatisée en 2021. «Il est temps de prendre des mesures fortes, car trop peu de sanctions sont appliquées aux établissements qui pratiquent le racisme, estime-t-il. À ce jour, j’attends toujours des réponses concrètes de la secrétaire d’État en charge de l’Égalité des chances…»
Des chiffres lacunaires
Selon Unia, le Centre interfédéral pour l’égalité des chances et la lutte contre les discriminations, 148 signalements ont été recensés entre 2017 et 2025 dans le secteur de l’Horeca. Pas moins de 59 d’entre eux concernaient des critères raciaux, ce qui représente une proportion non négligeable, même si ces chiffres semblent très éloignés de la réalité du terrain. «De nombreuses victimes estiment que porter plainte ne changera rien, déplore Nicha Mbuli, juriste au MRAX. Rassembler les témoignages et les preuves de la discrimination subie représente une charge très lourde que beaucoup préfèrent éviter… Alors rien ne change.» Face au manque cruel de données, le réseau bruxellois de la santé en milieux festifs Safe ta night a également mené son enquête sur les violences sexistes et sexuelles dans la communauté LGBTQIA+ ainsi que les publics racisés en milieux festifs. «Il en ressort surtout que les victimes de discrimination intersectionnelle ont moins tendance à aller voir les institutions par manque de confiance, éclaire Laëtitia Vangasse, chargée de projet. Ils choisissent également de manière beaucoup plus sélective les lieux où faire la fête.»
Selon Unia, le Centre interfédéral pour l’égalité des chances et la lutte contre les discriminations, 148 signalements ont été recensés entre 2017 et 2025 dans le secteur de l’Horeca. Pas moins de 59 d’entre eux concernaient des critères raciaux, ce qui représente une proportion non négligeable, même si ces chiffres semblent très éloignés de la réalité du terrain.
Le récent rapport «Racisme en milieux festifs» du Plan bruxellois de lutte contre le racisme rappelle que malgré «une prise de conscience croissante des acteur(rice)s du secteur de la nuit et des efforts institutionnels», la discrimination de personnes racisées en milieu festif reste une réalité. Bien sûr que des prétextes aussi louches qu’une «soirée privée» ou des «problèmes logistiques» sortent encore de la bouche des sorteurs et physionomistes pour justifier un accès interdit. Évidemment que les noctambules racisés doivent composer avec des fouilles corporelles plus intensives, une surveillance exacerbée ou une expulsion prématurée des lieux en cas d’incident. «Inévitablement, cela en amène certains à adopter des comportements d’évitement pour limiter les répercussions sur eux-mêmes», souligne Laëtitia Vangasse. Cela commence par la banalisation de la violence subie, mais ça va jusqu’à l’auto-exclusion de certains lieux, la création d’espaces festifs «parallèles», voire une forme de repli communautaire.
Le récent rapport «Racisme en milieux festifs» du Plan bruxellois de lutte contre le racisme rappelle que malgré «une prise de conscience croissante des acteur(rice)s du secteur de la nuit et des efforts institutionnels», la discrimination de personnes racisées en milieu festif reste une réalité.
«À la suite du mouvement ‘Balance ton bar’ (qui dénonce les violences et les agressions sexuelles dans les bars et les clubs, NDLR), certains bars et clubs se sont dits démunis face aux phénomènes de brutalité et discrimination, glisse Sylvie Van Huffel, de Safe ta night. La demande d’encadrement a alors littéralement explosé. Les moyens restent limités, mais nous proposons gratuitement une vidéo d’accroche, un recensement d’articles et d’outils, et nous redirigeons également vers des acteurs plus à même de répondre à la demande de formation comme Brussels by Night ou le Plan Sacha.» De là à dire que nous sommes à un tournant dans la lutte contre les discriminations de personnes racisées en milieu festif, il reste un grand pas à franchir. Parce que s’il existe des gérants désireux de s’investir réellement dans ces problématiques en participant – ainsi que leur personnel – à des formations continues et en assurant une communication constante quant au protocole, «d’autres cherchent juste à ‘cocher les cases’ pour éviter les témoignages négatifs sur les réseaux sociaux», se désole Sylvie Van Huffel.
Loi VS réalité
Conformément à la loi du 30 juillet 1981 contre le racisme et la xénophobie, tout acte de discrimination dans l’accès aux biens et services est considéré comme une infraction. Au niveau pénal, un comportement portant atteinte à une personne en raison d’un ou de plusieurs critères protégés peut donc être sanctionné d’une amende de 50 à 1.000 euros et/ou d’un emprisonnement d’un mois à un an. «Toute la difficulté consiste à fournir des preuves matérielles des faits et des intentions claires de l’auteur avec des éléments concrets et vérifiables», précise Nicha Mbuli, du MRAX. Face à ces obstacles parfois insurmontables, des actions au civil sont également possibles. Elles permettent le partage de la charge de la preuve, répartissant ainsi entre la victime et l’accusé l’apport d’évidences. «Les exemples de cas de discrimination en soirée portés devant la justice sont toutefois assez rares, regrette Nicha Mbuli. La dernière véritable affaire remonte à 2012, lorsqu’un jeune d’origine étrangère a été le seul de son groupe d’amis, Belges de souche, à se voir refuser l’entrée d’une discothèque à Hasselt.» Face à l’incapacité du tenancier de se justifier, le tribunal l’a condamné pour discrimination. «Le problème, c’est que ces cas de jurisprudence ne servent pas toujours à faire évoluer la loi, regrette Nicha Mbuli. Les tenanciers, eux en revanche, s’adaptent. Ils ne sont plus si ouvertement discriminants, mais se retranchent derrière les excuses de la carte de membre ou de la tenue vestimentaire.» Des structures telles que les MRAX ou Safe ta Night ne baissent toutefois pas les bras et poursuivent leur travail de sensibilisation pour s’assurer que les personnes discriminées comprennent qu’aucun signalement n’est vain. «C’est le moyen ultime pour attirer l’attention des politiques sur la réalité et bousculer les gérants d’établissements régulièrement pointés du doigt», plaide Nicha Mbuli.
Vers une charte institutionnalisée?
Formatrice et conférencière sur les questions liées au racisme et aux discriminations, Betel Mabille a récemment travaillé avec l’organisme Visit Brussels sur la question du racisme dans les milieux festifs. Cette collaboration s’est matérialisée par la création de formations destinées aux gérants ainsi qu’aux vigiles et membres de care-teams, ces équipes mobiles qui interviennent en soirée pour promouvoir la santé et le bien-être. «Cela reste difficile d’aborder les questions raciales, constate Betel Mabille. On est encore dans un racisme très moral: si l’on vient à pointer des comportements ou des manières de fonctionner discriminants, les intervenants peuvent rapidement se mettre sur la défensive ou prétexter qu’ils ne peuvent pas contrôler tous les comportements des autres.» Un argument que Betel Mabille balaie d’un revers de la main. «Tous les employés signent un règlement d’ordre intérieur auquel ils sont liés… Il n’y a donc aucune raison qu’une charte anti-discrimination soit tout d’un coup problématique. Si l’on reste dans le silence sans décortiquer, on n’avancera jamais.» De nombreux acteurs insistent sur l’importance du levier administratif et financier pour contraindre les tenanciers à adapter leurs habitudes. L’experte prône quant à elle l’organisation de formations qui mèneraient à une réflexion collective des acteurs du monde de la nuit en vue d’institutionnaliser une charte solide. «Si c’est du one-shot, ça n’aura qu’un impact individuel et non structurel. En revanche, si cela s’inscrit dans la continuité et devient une priorité pour les structures concernées qui assureraient un suivi, cela peut devenir intéressant.» Cela pourrait par exemple permettre de renforcer l’encadrement des victimes, souvent démunies sur le moment ou confrontées à des care-teams, trop peu formées et majoritairement constituées de Blancs, qui font plus de mal que de bien.
Note de la rédaction: Contacté par mail, Lorenzo Serra, président de l’association Brussels By Night, qui représente les établissements et opérateurs de la nightlife dans la capitale, s’est d’abord montré réactif et disponible pour une interview… avant de se dire finalement très occupé.