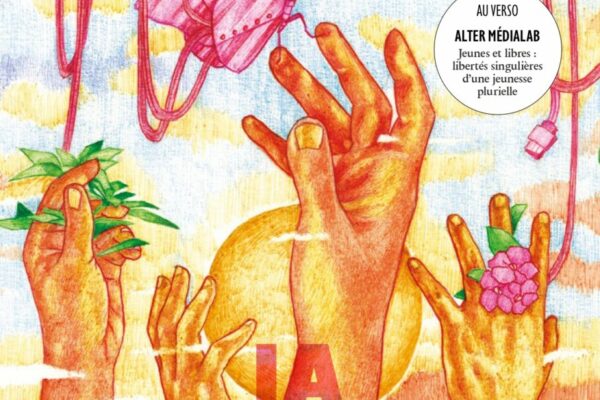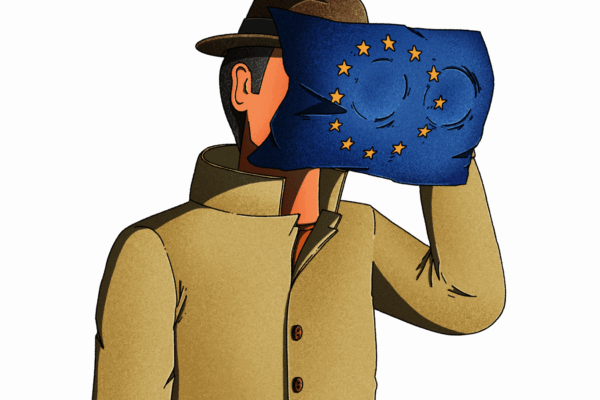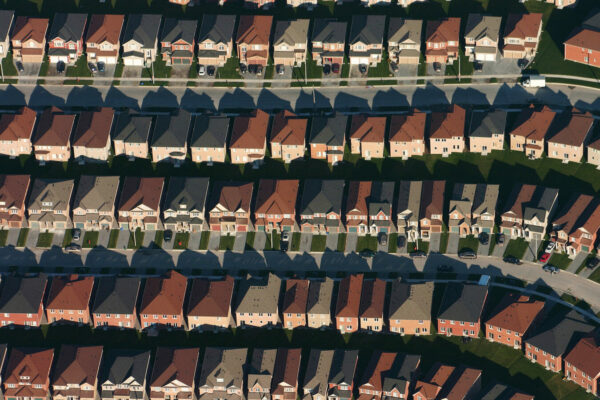Alter Échos: Dans plusieurs de vos interventions, vous insistez sur les dimensions sociales et politiques de la souffrance au travail. Concrètement, comment articulez-vous cette analyse sociale avec votre pratique clinique?
Thomas Périlleux: En équipe, nous réfléchissons régulièrement à ces questions: au contexte immédiat – les formes d’organisation du travail – mais aussi au contexte plus large, les transformations du système économique capitaliste et l’empreinte du néolibéralisme. Ce sont des enjeux vastes, qui n’apparaissent pas toujours explicitement dans les consultations, mais qui sont présents en arrière-plan. Car la clinique elle-même ouvre des leviers de critique: beaucoup de patients expriment qu’ils ne supportent plus les modes de travail dans lesquels ils ont été pris et auxquels, d’une certaine manière, ils ont participé. Cette prise de conscience est déjà au cœur de la rencontre clinique. Notre position n’est pas de parler à la place des patients ni de décider pour eux de leur avenir professionnel. En revanche, nous pouvons accompagner ce moment de crise – personnelle, existentielle, morale – dans leur rapport au travail. Elle se heurte évidemment à des contraintes très concrètes: le retour au travail, le salaire, les conditions matérielles de vie. Mais il y a un principe auquel nous tenons fermement: refuser une clinique purement adaptative qui viserait à réinsérer les patients dans le circuit productif sans interroger ce qui les a malmenés.
AÉ: À partir de cette approche sociale et critique, avez-vous observé une évolution ces dernières années dans les profils ou les demandes des personnes que vous rencontrez?
TP: Ce que j’observe s’accentuer, et de manière très récente, ce sont surtout les questions de précarité. Même des personnes pourtant insérées professionnellement expriment une forte inquiétude: crainte d’une concurrence accrue, peur de perdre leur emploi, ou encore peur de voir la qualité de leur travail se détériorer. En contrepoint, il y a aussi une attente très forte de retrouver du sens au travail. Parfois, cela s’accompagne d’une remise en cause plus large du système économique et d’un désir de solutions alternatives.
Ce que j’observe s’accentuer, et de manière très récente, ce sont surtout les questions de précarité. Même des personnes pourtant insérées professionnellement expriment une forte inquiétude: crainte d’une concurrence accrue, peur de perdre leur emploi, ou encore peur de voir la qualité de leur travail se détériorer.
AÉ: Et quelles sont les formes de souffrance professionnelle que vous rencontrez le plus souvent?
TP: Sur ce point, les choses sont assez nettes: dans huit ou neuf cas sur dix, les patients arrivent avec un diagnostic de burn-out. Ce que nous observons le plus massivement, c’est l’épuisement, l’effondrement. On traduit burn-out par «épuisement», mais j’ai aussi parlé «d’effondrement», comme si la colonne vertébrale du sujet-travailleur se disloquait, comme si tous les appuis se perdaient. Ce n’est pas un hasard si beaucoup de patients racontent qu’un matin, ils n’ont simplement plus pu se lever: un élan se brise, une verticalité se fige. C’est une image métaphorique, certes, mais elle dit bien le contraste avec l’état précédent, souvent marqué par une suractivité. À cette hyperactivité succède soudain une forme d’immobilité radicale.
AÉ: On le voit bien dans les débats publics: il reste très difficile de faire entendre la parole des travailleurs en souffrance et de mettre en lumière ce qui dysfonctionne dans le système…
TP: Je crois qu’il faut distinguer deux niveaux: d’une part, la possibilité de prendre la parole sur le lieu de travail, et d’autre part, la difficulté à faire entendre publiquement les souffrances et les malaises liés au travail. Sur le lieu de travail, beaucoup de patients décrivent des climats de peur, parfois même de terreur. La parole y est soit extrêmement formatée, soit carrément interdite. Or, quand la parole est empêchée, toute l’expérience devient indicible. Mais il existe aussi des obstacles plus internes à la prise de parole sur le travail. Christophe Dejours parle à ce sujet d’un «déficit de mots»: l’expérience de travail est souvent en avance sur ce que nous sommes capables d’en formuler. Nous disposons de savoirs tacites, d’intelligences pratiques, difficiles à décrire et à transmettre. Parler de son activité est déjà en soi un exercice complexe. Le premier obstacle tient à ce qu’on peut dire – ou plutôt à ce qu’on n’ose pas dire – du négatif de l’expérience de travail, de la souffrance qu’elle génère. Exprimer une difficulté est souvent perçu comme un aveu de faiblesse, parce que le modèle dominant reste celui de la performance, et même de la surperformance. Dans ce cadre, évoquer un problème, c’est risquer d’être immédiatement étiqueté comme incompétent ou non performant. Cela rend évidemment très difficile la mise en public de la souffrance au travail: on s’expose à des jugements dépréciatifs en révélant des fragilités que d’autres préfèrent ne pas voir en eux-mêmes. Ce mécanisme participe à une insensibilisation croissante, à la diffusion d’un certain cynisme dans les milieux de travail comme dans l’espace public. Et certaines formes de gouvernement – dans les entreprises comme dans la sphère politique – jouent de la honte comme d’un outil d’oppression particulièrement efficace.
Exprimer une difficulté est souvent perçu comme un aveu de faiblesse, parce que le modèle dominant reste celui de la performance, et même de la surperformance. Dans ce cadre, évoquer un problème, c’est risquer d’être immédiatement étiqueté comme incompétent ou non performant.
AÉ: Concernant les mesures gouvernementales visant à «remettre au travail» les personnes en incapacité de longue durée – avec ces chiffres souvent avancés, comme les 100.000 malades de longue durée –, comment les analysez-vous?
TP: En consultation, ce que nous constatons, c’est qu’il existe chez les personnes en arrêt de longue durée un désir très largement partagé de reprendre le travail. Contrairement à certaines représentations, nous n’observons presque jamais une volonté de prolonger l’arrêt «le plus longtemps possible». Au contraire: beaucoup souhaitent reprendre trop tôt. Or, par expérience, nous savons qu’un retour précipité après un burn-out expose fortement au risque d’une rechute et d’un nouvel arrêt, ce qui complique encore davantage la suite. La question de la temporalité est donc centrale, et elle varie énormément d’une personne à l’autre. Je comprends que, du point de vue politique, il existe des impératifs de standardisation – prévoir des cadres d’accompagnement à 3, 6 ou 9 mois, par exemple. C’est une logique administrative qui a ses raisons. Mais la temporalité psychique relève d’une autre logique: elle ne se laisse pas réduire à des délais uniformes. C’est ce décalage qui rend parfois les dispositifs difficiles à ajuster. Une reprise durable n’est possible que si quelque chose change: soit dans le rapport de la personne à son travail, soit dans l’organisation du travail elle-même. Ignorer les alertes que constituent ces arrêts, ce serait passer à côté de ce qu’ils signifient. Plus largement, cela renvoie à la place du travail dans nos sociétés, entendu ici comme travail salarié. On observe parfois une assimilation entre travail et vie, ou entre travail et utilité sociale, comme si l’on ne valait que par sa place dans le système productif. Ce sont des représentations qu’il faudrait pouvoir remettre en question.
À lire: Le travail à vif – Souffrances professionnelles, consulter pour quoi? aux éditions Eres.