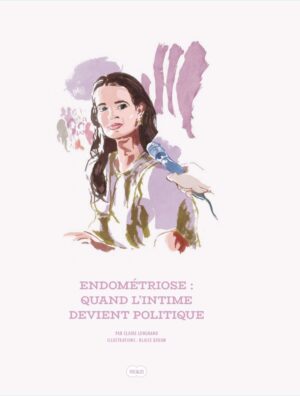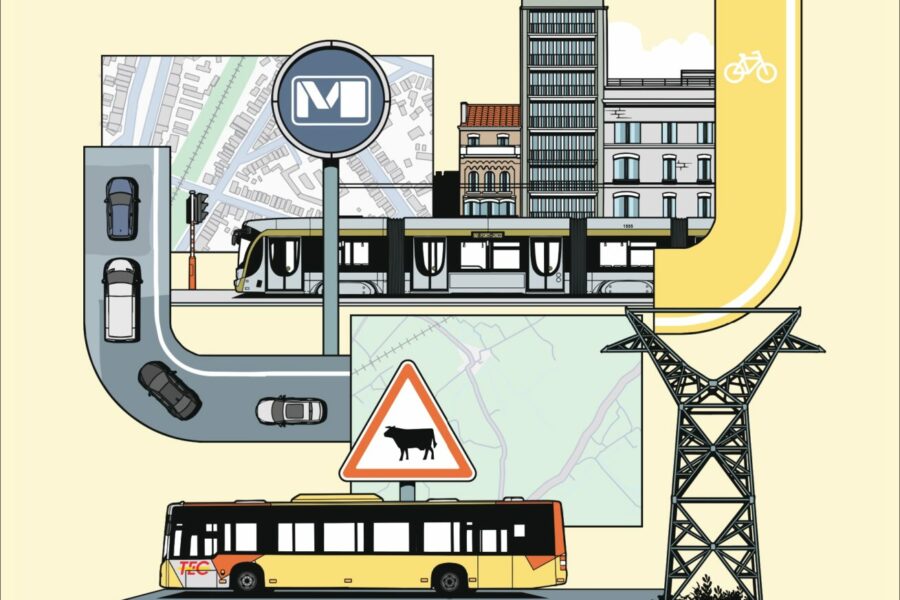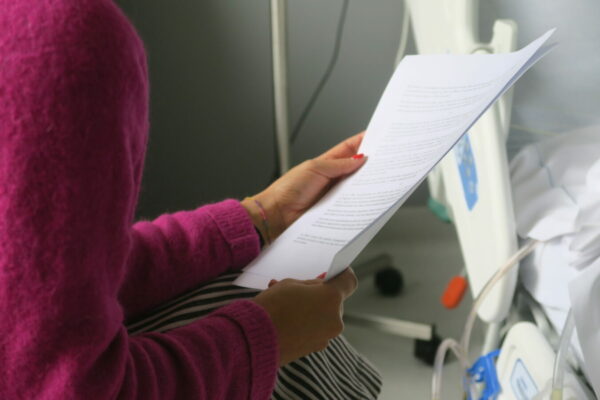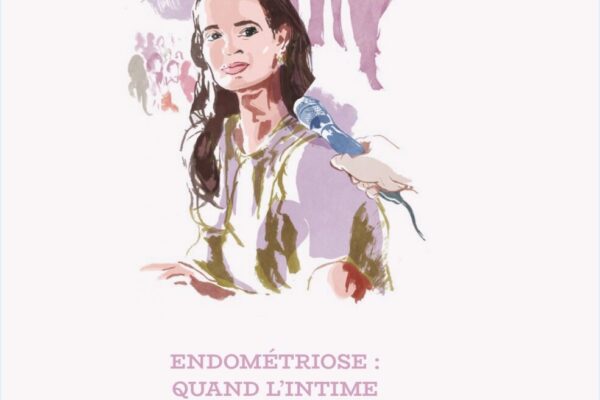Le géographe français Christophe Guilluy a décrit dans plusieurs ouvrages la fracture qui existe entre les habitants du périurbain et ceux des grandes métropoles. Selon l’auteur de La France périphérique – un immense succès en librairie et un grand sujet de débat, tant à gauche qu’à droite –, un gouffre culturel, social et politique se creuse entre ces deux territoires, le premier, victime de la désindustrialisation – celui d’une «majorité ordinaire», modeste, laissée pour compte –, et le deuxième, l’espace réservé d’une élite politique et culturelle progressiste, plus déconnectée des réalités et attentes sociales de cette majorité invisible. Qu’en est-il de cette fracture en Belgique? Le sentiment de déconnexion entre ville et campagne existe-t-il et le déclassement est-il palpable dans les zones périphériques? Quels sont les contours d’une fracture entre villes et périphéries et quelle est son influence sur le vote? Décryptage avec Émilie Van Haute, professeure à SciencePo ULB et chercheuse au Cevipol, dont les recherches portent notamment sur les élections et le comportement électoral.
Alter Échos: Comment pourrait-on définir la «Belgique périphérique»?
ÉMILIE VAN HAUTE: La Belgique est un pays densément peuplé dans lequel il faut distinguer la ville, la périphérie et la campagne. Ces trois types de territoires se différencient par leur situation socio-économique de ceux de la France. En Belgique, la périphérie compte des zones prospères, tout comme certaines campagnes, tandis que les centres urbains le sont moins. Un autre élément important à relever pour définir ce sujet est la croissance démographique observable partout ces dernières années, et de manière encore plus marquée dans les zones périphériques des villes. Démographiquement et électoralement, la périphérie pèse donc davantage qu’avant.
AÉ: Une enquête récente en France a montré l’existence d’un «malus rural» qui désigne les difficultés de la vie dans les communes à faible densité, comme l’accès aux services publics, liées au coût de la mobilité notamment[1]. Ce malus rural entraînerait un ressentiment rural. Observe-t-on cela aussi en Wallonie?
ÉVH: On ne peut pas parler du même phénomène pour la Belgique. La France est fortement marquée par le déclin des services publics en matière d’éducation, de santé, etc., en zones rurales. C’est moins le cas en Belgique francophone. Par ailleurs, la question de l’accès aux services publics se pose également dans les centres urbains en Belgique.
AÉ: Comment évaluer le clivage entre le centre et la périphérie?
ÉVH: Nous avons réalisé une étude sur la polarisation, définie comme le sentiment de distance entre citoyens, soit d’ordre affectif (antipathie et intolérance), soit d’ordre idéologique (gauche-droite).
Nous avons mesuré les deux indicateurs en Belgique lors des élections de 2019 et de 2024. Nous n’avons pas constaté d’augmentation de ce sentiment de distance chez les citoyens et les citoyennes. Par contre, nous avons pu relever des différences notables entre territoires. On observe une polarisation affective plus forte dans les zones en déclin économique.
Le fait d’«avoir perdu», couplé au fait de vivre à proximité de zones prospères, engendre un sentiment de déprivation et un ressentiment lié au fait de «savoir qu’on est en déclin, mais que d’autres ne le sont pas». Il existe dans ces zones un ressentiment à l’égard des partis politiques et des élites qui pousse ces personnes à «essayer autre chose» pour contrer ce sentiment de délaissement et cette situation de déprivation. Ces personnes font alors le choix d’un vote plus radical, pour le Vlaams Belang ou le PTB. Bien que ces partis diffèrent, le rapport au politique des personnes qui votent pour ces partis est le même: ces votes témoignent d’un fort ressentiment démocratique. On le voit, les inégalités socio-économiques amènent à un ressentiment démocratique et à un vote radical, qui à son tour stimule l’antipathie entre électeurs protestataires et non protestataires, par exemple le mépris des électeurs du PTB de la part des électeurs de partis traditionnels, et vice versa.
Le fait d’«avoir perdu», couplé au fait de vivre à proximité de zones prospères, engendre un sentiment de déprivation et un ressentiment lié au fait de «savoir qu’on est en déclin, mais que d’autres ne le sont pas». Il existe dans ces zones un ressentiment à l’égard des partis politiques et des élites qui pousse ces personnes à «essayer autre chose» pour contrer ce sentiment de délaissement et cette situation de déprivation. Ces personnes font alors le choix d’un vote plus radical, pour le Vlaams Belang ou le PTB.
Un deuxième élément vient aussi éclairer cette fracture. En 2024, on voit apparaître que c’est en périphérie que le MR a progressé le plus. Le MR, en Wallonie, a capté des votes protestataires, et c’est assez rare qu’un parti de gouvernement parvienne à se positionner comme un parti de protestation.
AÉ: Comment s’y est-il pris? Il semble que la stratégie ait fonctionné tant parmi les classes privilégiées que parmi les classes populaires. Or, on ne peut pas vraiment dire que les inégalités socio-économiques soient au cœur de leur programme.
ÉVH: Le succès du MR s’inscrit aussi dans une logique de polarisation. Il s’explique surtout par son discours de dénonciation des dérives de la ville en termes de valeurs. On a beaucoup entendu le MR parler du «wokisme», de l’imposition de nouvelles valeurs qu’il associe à la ville. La question des valeurs – la question «identitaire» – est un phénomène nouveau de cette campagne, parmi d’autres thèmes plus récurrents et également connotés «urbains» comme la pauvreté, la criminalité, la mobilité, la migration. Mais le vote protestataire pour le MR a aussi fonctionné, car le parti a fait campagne sur la gouvernance. En montrant les partis au pouvoir du doigt et en critiquant leur mauvaise gouvernance, le MR est aussi parvenu à attirer les personnes touchées par un sentiment de délaissement et de déprivation. Ce qui explique un transfert des votes PS vers le MR. Ce changement n’est pas que conjoncturel, il est aussi lié à la croissance démographique en périphérie.
AÉ: Comment expliquer la montée des Engagés?
ÉVH: Il s’agit d’un comportement électoral différent. Les élections de 2024 ont montré un transfert d’Écolo vers les Engagés, de la part d’électeurs qui ont voulu fuir justement la polarisation. Beaucoup d’électeurs de la campagne n’ont plus voté Écolo considérant que le parti tenait un discours «de la ville» – faisant référence aux questions de genre, de religion, etc. – qui l’éloignait d’un discours plus «historique» relatif à l’écosystème et au climat. Les détracteurs du parti écologiste ont aussi très bien compris qu’ils pouvaient jouer la carte «Écolo est un parti communautariste» pour nuire à leur réputation, ce qui est vraiment saillant dans cette séquence. Plus globalement, Écolo est le parti politique dont le positionnement est le plus éloigné de son électorat. Les électeurs n’ont pas tant changé de positionnement. Mais le parti a davantage creusé l’axe socioculturel que l’axe socio-économique ou environnemental, tant dans sa campagne que dans sa communication en ligne.
En montrant les partis au pouvoir du doigt et en critiquant leur mauvaise gouvernance, le MR est aussi parvenu à attirer les personnes touchées par un sentiment de délaissement et de déprivation. Ce qui explique un transfert des votes PS vers le MR. Ce changement n’est pas que conjoncturel, il est aussi lié à la croissance démographique en périphérie.
AÉ: Et quid de questions comme la politique migratoire qui est souvent au cœur des discours populistes? Observe-t-on aussi des différences entre la ville et la campagne?
ÉVH: La question migratoire s’est invitée avec force dans la campagne. En 2019, cet enjeu était peu prioritaire pour les électeurs wallons. En 2024, la campagne électorale a activé des attitudes existantes, et l’enjeu s’est invité parmi les enjeux prioritaires des électeurs. Le MR s’est emparé de ces questions. Il occupe l’entièreté de l’espace à droite, y compris l’espace plus à droite.
AÉ: C’est donc un mythe que la Wallonie soit épargnée par l’extrême droite?
ÉVH: Absolument. La Wallonie est aussi raciste que la Flandre. Pour vous donner un exemple, aux propositions «Certains pensent que les immigrés non occidentaux doivent pouvoir vivre en Europe tout en conservant leur culture d’origine. D’autres pensent que ces immigrés doivent s’adapter à la culture européenne», 7,6 Flamands sur 10 sont favorables à la deuxième proposition, et, en Wallonie, ce chiffre est de 7 sur 10.
AÉ: Quelle est la responsabilité des partis dans ce grand ressentiment?
ÉVH: Il y a en effet une question à se poser sur la capacité des partis à délivrer des politiques publiques de qualité. La Belgique n’est pas un pays pauvre. Plutôt que de dénoncer les comportements des électeurs qui votent pour les extrêmes, les partis devraient faire l’exercice de comprendre où ils ont fauté eux-mêmes. En Belgique, nous n’avons pas de culture de la redevabilité politique. C’est ce qu’on nomme, en anglais, l’accountability, pour désigner l’obligation de rendre compte de ses actions et décisions, d’être transparent et d’assumer les conséquences de ses actes. Cela n’existe pas en Belgique. Ce séisme politique de 2024 devrait nous permettre d’y réfléchir.
AÉ: Dans une analyse, consacrée au fait que les narratifs de gauche ne touchent plus les classes populaires[2], l’auteur souligne que «le mouvement écologiste reste trop souvent déconnecté des enjeux immédiats plus matériels». Qu’en pensez-vous?
ÉVH: Écolo est un parti politique d’élites urbaines et universitaires. Les électeurs qu’ils ont perdus lors des dernières élections, ce sont ces personnes en périphérie déconnectées des questions socioculturelles dont je vous parlais, mais aussi des élites, plutôt centrées sur les enjeux environnementaux. Le parti pourrait concentrer ses efforts sur ces élites perdues avant de chercher à capter des électeurs des classes populaires, plus proches d’autres partis (PS, PTB).
Écolo est un parti politique d’élites urbaines et universitaires. Les électeurs qu’ils ont perdus lors des dernières élections, ce sont ces personnes en périphérie déconnectées des questions socioculturelles dont je vous parlais, mais aussi des élites, plutôt centrées sur les enjeux environnementaux.
AÉ: Comment la gauche doit s’adresser aux personnes délaissées et comment refaire dialogue?
ÉVH: En articulant le socio-économique et le culturel. Le socio-économique en appelle aux conditions matérielles, le culturel mobilise les affects. Ces derniers peuvent mobiliser, mais aussi opposer. Il faut pouvoir revenir sur des questions socio-économiques en introduisant de l’émotion. Exemple avec les soins de santé: en écrasant les soins de santé, on écrase aussi la diversité socioculturelle qui est forte dans ce milieu professionnel. Il est possible de développer un discours qui unifie autour de cette question. À l’inverse, les partis de droite ont intérêt à segmenter et à diviser. Sur cette dernière campagne électorale, on a observé une moralisation de l’axe socio-économique, avec des divisions entre bons et mauvais travailleurs. Cela oppose les citoyens entre eux, pour éluder l’opposition entre citoyens et élites économiques. Enfin, on peut aussi se demander si toute forme de polarisation est mauvaise. La polarisation politise. Des personnes qui ne savaient pas trop se positionner adoptent des positions claires sur l’axe gauche-droite. Avoir un positionnement clair, quand cela ne mène pas à l’intolérance, n’est pas forcément mauvais en démocratie. La polarisation peut aussi mobiliser. Elle amène davantage de citoyens et citoyennes à voter, à s’engager et à participer à la vie politique. Ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose non plus.
[1] https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/france-culture-va-plus-loin-l-invite-e-des-matins/france-rurale-les-dangers-du-ressentiment-7433838
[2] Jérôme Van Ruychevelt Ebstein, «Pourquoi les narratifs de gauche ne touchent plus les classes populaires. Comprendre les échecs et reconstruire des récits qui gagnent la bataille culturelle», Fondation Ceci n’est pas une crise, 2025.