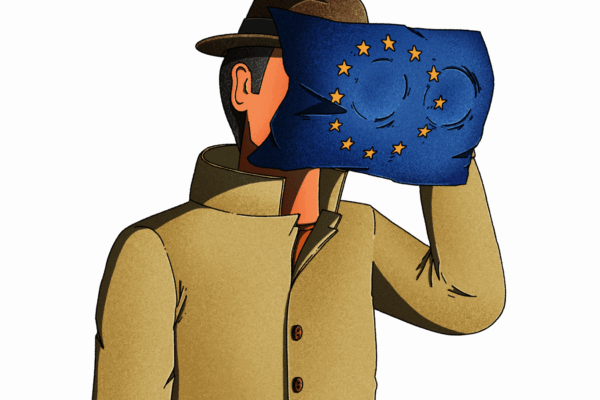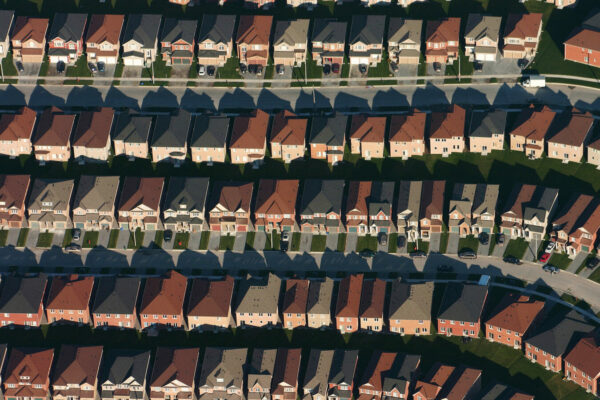Depuis la rentrée de septembre, la vie de Paola Vitali a changé. Cette mère de famille romaine a longtemps affronté, pour son fils porteur d’un handicap moteur, les contradictions du système scolaire italien, qui comptait en 2023-2024, selon l’ISTAT – l’Institut national de statistique –, près de 359.000 élèves reconnus porteurs de handicap, soit 4,5 % de l’ensemble des élèves, avec une majorité dans le primaire et le secondaire de premier degré. Parmi eux, 56 % présentent un handicap multiple, et environ 28 % ont des troubles moteurs les rendant non autonomes. L’Italie figure d’ailleurs parmi les pays pionniers en matière de scolarisation des enfants porteurs de handicap.
«Pour la première fois après tant d’années scolaires traumatisantes, notre rentrée fut douce, raconte Paola. Nous avons cessé de nous sentir des obstacles: nous avons eu le sentiment d’être accueillis à part entière.»
Ce soulagement tranche avec la décennie écoulée grâce à des aménagements matériels et un soutien pédagogique adéquats pour les besoins de son fils. Paola décrit des années où son enfant était officiellement «accepté», mais souvent tenu à distance. Elle évoque «un parcours semé d’obstacles», où «les élèves handicapés finissent par être une gêne pour une école qui promet beaucoup, mais accomplit peu».
En 2023-2024, selon l’ISTAT – l’Institut national de statistique –, près de 359.000 élèves étaient reconnus porteurs de handicap, soit 4,5 % de l’ensemble des élèves, avec une majorité dans le primaire et le secondaire de premier degré.
Dès la maternelle, les enseignants se disaient démunis: la bienveillance ne suffisait pas à assurer une intégration réelle. «Au fond, mon enfant n’a jamais pleinement appartenu à la classe», constate-t-elle.
Les adaptations matérielles, comme l’accessibilité des locaux ou l’organisation des sorties, restaient très insuffisantes. Lors d’une visite dans un site historique impraticable en fauteuil, la sortie lui fut interdite. «Mon fils est resté à la maison alors que ses camarades profitaient de leur dernière année ensemble.»
Pour obtenir un soutien adapté comme c’est le cas cette année, la famille Vitali a dû se battre. «Sans cela, mon fils n’aurait jamais pu intégrer une école ordinaire.» Les parents ont souvent compensé eux-mêmes financièrement les carences d’aménagements par le passé.
Pour Paola, «l’inclusion telle qu’elle existe aujourd’hui est encore un leurre», portée par «un système incapable d’adapter les infrastructures et les projets pédagogiques, et qui s’autocélèbre sur un modèle inclusif pourtant inabouti». Résignation et amertume restent, dit-elle, le lot de nombreuses familles.
Manque de moyens
Autre témoignage, celui de Patrizia Compagnucci, mère de Valerio, un garçon autiste, et enseignante de soutien dans la région des Marches. En Italie, un enseignant de soutien est prévu dès qu’un élève dispose d’une reconnaissance officielle de handicap.
Le système italien s’appuie d’ailleurs sur près de 246.000 enseignants de soutien, même si 27 % d’entre eux ne possèdent pas de formation spécialisée. Cette figure clef reste en outre fragilisée par la précarité des contrats.
En tant qu’enseignante de soutien, Patrizia vit cette précarité comme une atteinte directe à la qualité de l’inclusion. Chaque année, elle change d’école, de collègues, et d’élèves. «En septembre, je dois recommencer mon propre processus d’inclusion.» Près de 57 % des élèves changent d’enseignant spécialisé chaque année, ce qui empêche la continuité pédagogique réclamée par les familles comme les professionnels.
Alice Carletti, enseignante de soutien, pointe elle aussi plusieurs difficultés qui fragilisent cette fonction, malgré son rôle central. «L’enseignant de soutien est encore trop souvent perçu comme quelqu’un d’accessoire, un soutien ‘en plus’ plutôt qu’un cotitulaire de la classe», regrette-t-elle. Cette représentation dévalorise la fonction et complique la collaboration entre enseignants.
Le système italien s’appuie d’ailleurs sur près de 246.000 enseignants de soutien, même si 27 % d’entre eux ne possèdent pas de formation spécialisée. Cette figure clef reste en outre fragilisée par la précarité des contrats.
Les ressources matérielles restent également insuffisantes. Beaucoup d’établissements ne disposent ni d’espaces véritablement accessibles ni d’outils compensatoires adaptés (logiciels, matériels spécifiques, dispositifs sensoriels), ce qui limite concrètement la portée des intentions inclusives. «Un investissement plus stable dans la formation, les ressources et dans la coordination suffirait à transformer une inclusion souvent formelle en inclusion réelle», estime-t-elle, rappelant que l’objectif n’est pas d’ajouter une mission supplémentaire à l’école.
Malgré les obstacles administratifs et le manque de ressources, Patrizia Compagnucci se dit, quant à elle, reconnaissante d’avoir trouvé pour son fils Valerio une école capable de montrer que l’inclusion ne dépend pas seulement des moyens, mais aussi de la continuité et de l’engagement des personnes. Pour elle, le processus d’inclusion se joue également dans les gestes quotidiens des camarades de son fils. «Quand nous arrivons à l’école, le premier compagnon qui le voit lui tend le bras, parce qu’il sait que Valerio ne donne pas la main. Ils avancent ensemble, et mon fils rit. Voilà ce qu’est l’inclusion.»
Un modèle fragile
Sœurs et militantes italiennes pour les droits des personnes handicapées, Elena et Maria Chiara Paolini portent, elles aussi, un regard lucide sur l’inclusion, nourri par leur expérience personnelle et leur travail de formation sur le validisme («Système faisant des personnes valides la norme sociale et, par extension, discrimination envers les personnes en situation de handicap», NDLR). Leur parcours scolaire a globalement été positif, notamment à l’école primaire, grâce à des enseignants attentifs et, pour Elena, à une direction de lycée prête à financer une assistance personnelle lors des voyages scolaires. Mais ces situations restent l’exception plutôt que la règle.
Très tôt, leurs parents ont dû se battre pour obtenir une assistance personnelle sur tout le temps scolaire. «On leur disait que nous retirions des heures aux autres enfants», racontent-elles, alors que cette aide était indispensable, notamment pour l’éducation physique et l’accès aux toilettes.
Au collège, par exemple, les obstacles se sont surtout manifestés sous forme de barrières architecturales. Elena faisait face à de nombreux obstacles physiques, tandis que Chiara devait entrer par une porte secondaire, quand les autres élèves passaient par l’entrée principale équipée d’escaliers. Les deux sœurs fréquentaient des établissements différents, mais les logiques d’exclusion restaient similaires. D’ailleurs, l’inclusion italienne reste un combat, à la lumière de chiffres interpellants fournis par l’ISTAT: seulement 41 % des bâtiments scolaires sont accessibles aux élèves en fauteuil roulant, avec une situation plus critique dans le Sud, par exemple.
Leur parcours scolaire a globalement été positif, notamment à l’école primaire, grâce à des enseignants attentifs et, pour Elena, à une direction de lycée prête à financer une assistance personnelle lors des voyages scolaires. Mais ces situations restent l’exception plutôt que la règle.
Leur réussite scolaire a eu un effet paradoxalement protecteur. «Le fait d’avoir de bons résultats nous a clairement mises à l’abri du validisme», expliquent-elles. Elles disent avoir rarement subi de préjugés explicites de la part des enseignants, ou seulement jusqu’à ce que les bonnes notes les fassent disparaître. «Cette réalité est profondément injuste: elle montre que le regard porté sur les élèves handicapés reste conditionné à leur ‘performance’ et que celles et ceux qui ne correspondent pas à ces attentes risquent un traitement bien plus discriminant.»
Pour les deux sœurs, le modèle italien demeure fragile. «Il y a encore des personnes qui défendent les classes séparées. Une école qui n’exclut pas est un droit, et pas un acquis», insistent celles qui se disent conscientes du caractère relativement privilégié de leur parcours, alors que d’autres personnes handicapées rapportent des expériences bien plus dures.
Aujourd’hui formatrices, Elena et Maria Chiara interviennent dans des écoles, universités et institutions pour sensibiliser au validisme. Elles observent une forte réceptivité, notamment chez les jeunes. «L’inclusion n’est pas une question de bonne volonté individuelle, mais de choix politiques, de moyens et de formation», concluent-elles.
Une conquête de civilisation
Si l’Italie a misé sur un système intégré unique dès les années 70, la Fédération Wallonie-Bruxelles maintient pour sa part la coexistence de l’enseignement ordinaire et spécialisé. Ce cloisonnement, hérité du XIXe siècle, entend répondre aux besoins spécifiques des élèves porteurs de handicap, mais limite de fait leur pleine inclusion en classes ordinaires.
Malgré des avancées législatives et la ratification de la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées (CDPH), la Belgique connaît encore de nombreux refus d’aménagements raisonnables, des discriminations et un manque criant de formation spécialisée initiale et continue des enseignants. Alors que l’Italie impose à tous les futurs enseignants une spécialisation en inclusion ou au moins un module obligatoire, la Belgique reste lacunaire sur ce point, ce qui pèse sur la qualité des parcours éducatifs des enfants handicapés.
L’Anffas (Associazione Nazionale Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale), créée en 1958 à Rome, rappelle l’origine de ce combat pour l’inclusion en Italie. «À l’époque, les personnes présentant une déficience intellectuelle étaient qualifiées de ‘sous-normales’ et souvent cachées à la maison, leur naissance vécue comme une honte ou une punition divine. Des familles, principalement des mères, se sont alors regroupées pour redonner dignité, droits et qualité de vie à leurs enfants, trois valeurs qui restent au cœur de l’association», explique son président, Roberto Speziale.
L’Anffas a joué un rôle décisif dans cette lutte. «Les enfants handicapés étaient alors orientés vers des écoles spéciales ou des classes différenciées. Nous avons milité pour que ces structures soient abolies.» Dès les années 1970, la fermeture progressive des écoles spéciales et l’intégration des élèves en situation de handicap dans les classes ordinaires marquent une rupture majeure, toujours qualifiée de «révolution» par Roberto Speziale.
«À l’époque, les personnes présentant une déficience intellectuelle étaient qualifiées de ‘sous-normales’ et souvent cachées à la maison, leur naissance vécue comme une honte ou une punition divine. Des familles, principalement des mères, se sont alors regroupées pour redonner dignité, droits et qualité de vie à leurs enfants, trois valeurs qui restent au cœur de l’association».
Roberto Speziale, président de l’Anffas
Depuis, la loi de 1971 a été renforcée notamment en 1992, avec l’inscription, dans la Constitution italienne, du droit à l’éducation pour tous les enfants, sans distinction. Ce cadre a été consolidé en 2012 par une directive ministérielle qui élargit l’inclusion au-delà du handicap pour couvrir d’autres besoins éducatifs spécifiques.
«Revenir en arrière serait impensable. L’Italie est l’un des rares pays au monde à avoir aboli la séparation scolaire: c’est une conquête de civilisation, résume Roberto Speziale. Cela dit, il faut améliorer ce qui ne fonctionne pas: les retards dans les affectations, les barrières architecturales, les lacunes de formation.»
L’Italie dispose pour cela d’un outil central: le plan éducatif individualisé (PEI), qui identifie les besoins de chaque élève et planifie les interventions nécessaires. «Quand il est bien fait, l’inclusion fonctionne; quand il est négligé, les difficultés apparaissent. Je dirais que, dans 80 % des cas, le système fonctionne bien, mais, dans les 20 % restants, il faut agir.»
Pour le mouvement associatif italien, la Belgique pourrait s’inspirer de cette expérience tout en évitant ses écueils, car la clef réside moins dans de nouvelles lois que dans une transformation des mentalités. «L’inclusion n’est pas seulement une affaire de droit, mais d’abord une question de culture: elle se joue là où se croisent les lois, les ressources, les pratiques quotidiennes et les gestes – parfois minuscules – qui, chaque jour, disent aux enfants les plus vulnérables: ‘Ici, ta place est évidente’», conclut le président de l’Anffas.