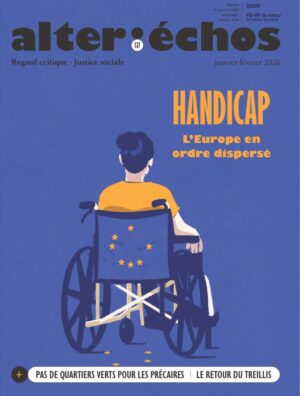«Les personnes en situation de handicap vivent aujourd’hui beaucoup plus longtemps que par le passé. C’est plutôt positif, mais décéder avant son enfant s’il ou elle n’a pas d’autonomie, c’est quelque chose qui inquiète beaucoup les parents», introduit Thomas Dabeux, responsable plaidoyer de l’asbl Inclusion. Créée en 1959 par un groupe de familles, cette association a développé plusieurs projets pour penser l’après-parent. À l’instar du service d’accompagnement psychosocial Madras ou de la Fondation Portray qui se concentre davantage sur les aspects juridiques et financiers. Au cœur des institutions spécialisées aussi, des aménagements sont mis en place pour pouvoir faire face à cette nouvelle problématique liée au vieillissement. Sur le terrain, les travailleuses et travailleurs tentent de pallier les failles de notre système et le manque de moyens.
Entre urgences et prévention
Hélène Delescaille est psychopédagogue et directrice du service Madras en Wallonie. «Nous rencontrons des proches très prévoyants, mais nous sommes aussi régulièrement confrontés à des personnes pour qui la crise est déjà là. Le cas de figure typique: le parent tombe, l’ambulance arrive, les soignants voient qu’une personne handicapée vit sur place, ils cherchent quelqu’un de l’entourage et s’il n’y a personne, ils emportent l’enfant aussi puis l’hôpital nous appelle.» Si, parfois, les équipes de Madras n’ont pas d’autre choix que de procéder à un placement en urgence, l’objectif est néanmoins d’éviter ce genre de situations critiques qui engendrent des deuils multiples: celui du proche, de la maison, et ce, tout en intégrant un nouveau lieu de vie après 50 ans.
Au cœur des institutions spécialisées aussi, des aménagements sont mis en place pour pouvoir faire face à cette nouvelle problématique liée au vieillissement.
Sur le terrain, les travailleuses et travailleurs tentent de pallier les failles de notre système et le manque de moyens.
Particulièrement complexe, la question de l’après-parent est à la croisée du secteur du handicap et du vieillissement. Audrey Clesse est psychologue et coordinatrice de la Cellule mobile de Référence Handicap et Vieillissement (CRHV) dépendant de l’AViQ, qui agit dans les provinces de Liège et de Luxembourg. «Nous intervenons directement auprès des bénéficiaires, des familles, et nous sensibilisons aussi les professionnels.» Pour permettre de trouver les solutions les plus adaptées, ce service tente de travailler en amont et s’inscrit dans un accompagnement à long terme.
Des séparations douloureuses
Derrière chaque situation, une histoire de vie, souvent complexe et révélant des enjeux multiples. C’est le cas de Jacqueline soutenue par Audrey Clesse et son équipe. «Françoise est née avec une trisomie, elle avait neuf ans de moins que moi. Nos parents sont morts jeunes. Elle a vécu avec moi, mon mari et nos trois enfants.»
Au fil des années, les enfants quittent le nid, et le mari de Jacqueline aussi. Françoise et elle mènent leur existence à deux. Un jour, c’est le drame. Jacqueline est retrouvée inerte par le facteur et est alors hospitalisée en urgence pour une embolie pulmonaire. «Qu’est-ce qui allait advenir de Françoise si j’avais un autre accident?»
Poussée par ses proches, elle visite des services résidentiels et inscrit sa sœur sur une liste d’attente. «Six mois après, on m’a annoncé qu’une place se libérait. Je ne pensais pas que ce serait si rapide, mais la place suivante serait peut-être seulement dix ans plus tard… Cette séparation, pour nous deux, a été terrible.» À son arrivée au centre, l’état de Françoise, alors âgée de 59 ans, commence à décliner; elle montre de nombreux signes de démence. «Et puis, tout s’est enchaîné, le directeur m’a appelée pour m’annoncer qu’il fallait qu’elle soit placée en maison de repos. Finalement, on n’a pas eu le temps de chercher un autre lieu. Elle est partie un matin. Depuis, ça ne va pas trop, mais j’essaie de tenir, j’ai sa photo là, et une bougie…»

«Ce serait tellement plus simple s’il partait avant nous»
La complexité de l’interdépendance est également observée par Madras. «Il ne faut pas négliger la question de l’attachement dans la parentalité spécifique liée au handicap», éclaire Hélène Delescaille. Louis Heine est assistant social au sein du service. Au quotidien, il intervient en première ligne auprès des familles: «J’observe un surinvestissement parental, dû notamment à une grande culpabilité. Envisager le placement de leur enfant entraîne une perte de sens pour les proches; aussi, cela met en péril un système construit sur quarante ou cinquante ans de vie commune.» Il pointe également une forme, parfois, de dépendance aux allocations: «Beaucoup de parents, surtout les mères, mettent leur carrière entre parenthèses et ont donc une pension au ras des pâquerettes…»
Les faits divers autour de la question du vieillissement et du handicap ne sont pas rares en Belgique. On se souvient par exemple de ce drame, en octobre dernier à Termonde, relaté par Le Soir: un homme de 77 ans tue son fils handicapé de 52 ans avant de se suicider. Hélène Delescaille ajoute: «Ce sont des situations extrêmes, mais ce qu’on entend très souvent c’est: ‘Ce serait tellement plus simple s’il partait avant nous… ou si on pouvait tous mourir ensemble.’» Louis Heine souligne: «Il est important de comprendre ce que cette détresse révèle du système actuel…»
Adapter les institutions
Outre la question des liens intrafamiliaux, il y a évidemment l’épineuse problématique du manque de places en institutions. Aussi, même pour celles et ceux qui ont la chance de vivre dans un endroit qui leur convient bien, l’avenir n’est pas forcément toujours rassurant.
C’est le cas, par exemple, de certaines personnes vivant à L’Heureux Abri, un service résidentiel situé à Momignies. «Nous avons dû réorienter des résidents vers des maisons de repos, qui les acceptent ou non au cas par cas, parce que nos infrastructures n’étaient plus adaptées», déplore Émilie Vigneron, éducatrice.
Malgré les obstacles et le manque de moyens, de nombreux projets d’aménagement voient le jour pour permettre aux personnes de vieillir et mourir dans leur institution devenue leur maison. C’est ce que tente de faire L’Albatros à Couvin. «Nous mettons en place des projets pour personnes vieillissantes en fonction de leurs besoins. Je pense notamment à l’adaptation des horaires et des activités ou des aménagements plus techniques dans les douches, avec des déambulateurs accessibles…», commente Olivier Ruelle, orthopédagogue clinicien.
Anticiper l’avenir
Penser l’après, c’est aussi une question financière! «De nombreuses familles se privent pour garder l’argent pour leurs enfants, constate Marie-Luce Verbist, directrice de la Fondation Portray. Mais il ne suffit pas d’avoir de l’argent, il faut que cet argent soit utilisé à bon escient.» L’un des outils proposés: le Fonds nominatif, sorte de coffre-fort affectif et financier. Les familles y déposent une somme d’argent, assortie de directives précises, qui seront respectées même après leur décès.
«Ce sont des situations extrêmes, mais ce qu’on entend très souvent c’est : ‘Ce serait tellement plus simple s’il partait avant nous… ou si on pouvait tous mourir ensemble.’ »
Hélène Delescaille, psychopédagogue et directrice du service Madras en Wallonie.
Danielle, 80 ans, et Marianne, 70 ans, ont pour point commun d’avoir fait le choix de l’anticipation. La première est la mère de Quentin, quinquagénaire polyhandicapé. «Grâce au soutien d’un donateur, ami de la famille, j’ai pu (et peux encore) subvenir à tous les besoins médicaux de mon fils.» Pour l’après, Danielle, veuve, a décidé de s’en remettre à la Fondation Portray, qui gère déjà pour elle tous les aspects financiers et juridiques concernant Quentin. «À travers la Fondation, nous participons au financement des travaux d’aménagement pour les résidents vieillissants menés par le centre Les Aubépines à Incourt, où vit mon fils depuis près de 30 ans. Il faut avoir la rage de trouver des solutions, mais désormais, moi, je peux disparaître demain…»
Marianne, elle, a fait appel à Madras pour accompagner ses deux fils atteints de trisomie 21. «Je commence à avoir des problèmes de mémoire. Jusqu’à présent, je m’occupais de leur suivi administratif, mais avec Madras et en famille, nous avons décidé de mandater un administrateur extérieur pour que la charge ne repose pas sur leurs sœurs. Mon conseil aux parents: ne pas rester dans son coin face aux obstacles; en partageant avec d’autres, la montagne devient une taupinière…»
Tout le secteur mobilisé
La Fondation Portray organise le 27 novembre prochain à Louvain-la-Neuve un grand colloque autour du vieillissement des personnes en situation de handicap et de leurs aidants.
L’occasion de faire remonter les réalités de terrain et de rappeler l’urgence politique de s’emparer de cette problématique.
Le manque de chiffres officiels invisibilise le manque de solutions adaptées. Le Gamp dénombre au moins 35.000 personnes en situation de grande dépendance en Belgique francophone. Or Bruxelles et la Wallonie ne comptent environ que 13.000 places d’accueil agréées et subsidiées en centres d’hébergement. À savoir, en plus des listes d’attente, il existe des listes de cas prioritaires (parmi lesquels des «vieux enfants») qui bénéficient d’un incitant financier permettant de faciliter la recherche d’une place dans une institution.