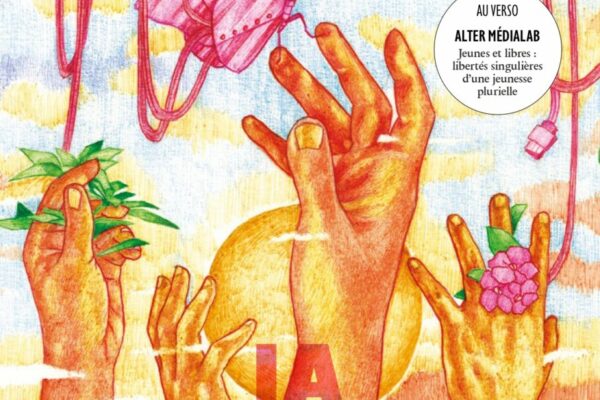Fin décembre à Anderlecht, plusieurs activistes investissent la poissonnerie d’un supermarché. L’un d’eux est déguisé en homard. Objectif: dénoncer la souffrance animale en période de fêtes, période pendant laquelle l’animal se retrouve sur de nombreuses tables (lire aussi dans l’Alter Échos 504 «Dis-moi quelle quantité de viande tu manges, je te dirai qui tu es», juillet 2022). L’action est signée par Extinction Rebellion Animal (XR Animal). Le collectif n’en est pas à sa première action. Quelques mois plus tôt, en juin 2022, il bloquait les entrées de la boucherie industrielle Viangro. Des actions similaires avaient été aussi menées dans une ferme industrielle et dans un abattoir en Flandre quelques jours avant ce blocage. Une manière de réclamer l’arrêt des subventions publiques pour l’industrie de la viande, en réorientant les investissements dans l’agriculture végétale.
La cinquantaine, Grégory est militant au sein de ce collectif. «La cause animale est entrée très vite dans ma vie: à 18 ans, je faisais partie d’une association qui traquait les vétérinaires véreux faisant du trafic de chiens. Puis je suis entré dans la vie active. Le militantisme a été mis de côté», se souvient-il.
Le militantisme est revenu chez Grégory non pas par le biais de la cause animale, mais par celui de la cause écologique et des actions menées par Extinction Rebellion en Belgique. C’était en 2019. «Je suivais ce mouvement sur les réseaux sociaux depuis un an. J’étais assez proche de ses idées, de ses tactiques en matière de désobéissance civile. C’est comme cela que j’ai replongé dans l’activisme.»
Dès les premiers moments, Grégory se rend compte que le collectif compte plusieurs végans en son sein. «On s’est dit qu’on pourrait combiner causes animale et climatique. XR Animal a été lancé, en ayant un collectif centré sur la justice animale, le dérèglement climatique et le système oppressif humain, en considérant l’animal comme le chaînon manquant de toutes les luttes.»
Si Grégory a rejoint XR Animal, plutôt que d’autres mouvements, c’est parce que le collectif ne se veut pas hiérarchique. «Il n’y a pas de responsable du collectif en tant que tel comme chez Gaïa, qui a plus une structure pyramidale. Ce qui m’a plu aussi, c’est le système d’auto-organisation. Ce n’est pas une asbl ni une ONG. Dès lors, n’importe quel citoyen peut à un moment donné, de sa propre responsabilité, mener une action.»
Des modes d’action différents
Si l’antispécisme existe depuis les années 60, bien que le mouvement soit récent en Belgique, notamment côté francophone, il est de plus en plus médiatisé ces dernières années au travers d’actions spectaculaires – comme la libération d’animaux dans des élevages – ou de vidéos sensationnelles prises en caméra cachée dans différents abattoirs du pays révélant des pratiques cruelles en leur sein.
C’est d’ailleurs comme cela qu’Animal Rights, une organisation internationale, présente en Belgique depuis 2015, s’est fait connaître en se concentrant sur la mise en lumière de la souffrance animale derrière les portes closes de l’industrie de l’abattage, de la chasse, de l’expérimentation animale et de la fourrure. «En enquêtant sur les abus, nous informons les citoyens sur l’énorme souffrance animale. En parallèle, nous entamons des discussions avec des politiques et des supermarchés pour proposer des alternatives», explique Els Van Campenhout.
«Lorsque nous faisons des images d’infiltration dans les abattoirs, nous constatons à plusieurs reprises des violations de la loi sur la protection des animaux et des réglementations européennes. Nous traduisons ces abattoirs en justice afin qu’ils soient jugés pour la maltraitance animale que nous enregistrons en vidéo», poursuit-elle.
Animal Rights a obtenu une victoire historique avec la condamnation de l’abattoir de Tielt en 2019. «C’était la première fois dans l’histoire belge qu’un abattoir comparaissait devant un tribunal et était condamné.»
L’organisation a réalisé des films dans six autres abattoirs flamands et porté plainte contre cinq d’entre eux. «Quatre autres procédures judiciaires contre les abattoirs de Hasselt, Moerbeke, Izegem et Torhout sont toujours en cours. Nous espérons également obtenir des condamnations pour les abuseurs d’animaux là-bas.» Un travail d’infiltration qui a permis à l’organisation d’être prise au sérieux par l’opinion publique. «Nos images d’infiltration ont un impact majeur et font toujours la une des journaux nationaux et même internationaux.»
De son côté, XR Animal se présente comme un collectif «créatif», voire «artistique». «Lors de nos actions, il y a de véritables mises en scène. C’est une manière de travailler sur le changement de système plutôt que sur le changement individuel», témoigne Grégory. Le collectif a mené diverses actions devant des McDonald’s, avec des militants s’asseyant à toutes les tables des terrasses du fast-food en prenant un repas végétalien pendant que quelqu’un mimait une vache morte. «On représente une scène d’écocide pour montrer toute la destruction qu’engendre la multinationale. On se centre plus sur les politiques ou les entreprises à travers des blocages d’abattoirs ou des éléments un peu spectaculaires comme des sittings, plutôt que sur des vidéos dans des abattoirs ou du sauvetage d’animaux, ce qui ne veut pas dire qu’on n’en fera pas. Pour l’instant, ce n’est pas notre tactique.»
XR Animal s’inscrit pleinement dans la désobéissance civile. «Il n’y a dans notre chef aucune violence, même si cela peut être perçu comme de la violence par d’autres. Toute notre action cherche à entrer dans la relation, le dialogue.» Un des objectifs est de porter en outre ce combat devant les tribunaux, à l’instar d’Animal Rights, sachant qu’à chaque action, il y a le risque de l’arrestation. «On le mesure à chaque fois et on décide si on va ou pas jusqu’à l’arrestation. Généralement, dans la lutte antispéciste, lorsqu’il y a des opérations chocs pour sortir des animaux d’élevages ou d’abattoirs, il ne faut surtout pas se faire prendre alors que si XR Animal devait en faire, on se ferait arrêter pour pouvoir aller en justice. Bien évidemment, il faut les finances suffisantes pour mener ce type d’action.»
Pour sa part, Animal Rights considère la désobéissance civile comme un outil important dans le mouvement pour la justice animale. «Cependant, notre objectif est de diffuser des informations par le biais d’images d’infiltration et de créer des précédents devant les tribunaux, en faisant condamner les auteurs d’abus d’animaux. Dans une action où la désobéissance civile est primordiale, le cœur de l’attention médiatique est rapidement déplacé vers la manière de faire campagne, moins sur la souffrance animale et ses abus. Nous essayons toujours de faire passer les animaux en premier, en privilégiant les campagnes d’informations», indique Els Van Campenhout.
Chez Bite Back, autre organisation de défense des droits des animaux comptant un millier de militants, surtout active en Flandre et à Bruxelles, Sara Surinx précise agir de manière pacifique. «Nos protestations ont toujours un objectif clair: la fin de la souffrance animale, un mouvement vers les droits des animaux. Nous organisons des pétitions, descendons dans la rue pour soulever des problèmes, parlons aux citoyens, essayons de faire changer les entreprises et les politiques.»
Concernant l’usage de la désobéissance civile, l’organisation flamande pense qu’il est particulièrement important de peser le pour et le contre d’une telle action. «Si vous êtes arrêté et que vous devez payer de lourdes amendes ou, pire, finir en prison, mais que la cause pour laquelle vous militez s’estompe, alors un autre mode d’action aura sans doute été plus efficace… Malheureusement, vous ne pouvez pas toujours estimer cela très longtemps à l’avance.» Aussi, avant toute action, Bite Back réfléchit à tous les scénarios possibles. Cela dit, l’organisation soutient les militants qui participent à de tels actes de désobéissance civile. «Certains militants antispécistes peuvent subir plus de dommages du fait de leur arrestation ou de poursuites que d’autres en raison de leur engagement social.»
De l’écoterrorisme?
«Notre pays découvre le mot ‘écoterrorisme’», titrait Le Soir en septembre 1998. On y lit: «Le terrorisme écologique s’implante en Belgique. Six attentats contre des fast-foods […] Les écoterroristes frapperont encore.» Des actions situées en région anversoise et revendiquées par l’ALF (Animal Liberation Front), mouvement radical fondé en 1976 et «bien connu dans le monde anglo-saxon depuis 1982 pour l’envoi de lettres piégées ou la mise à sac de laboratoires universitaires», précise Le Soir. Plus loin, le quotidien ajoute: «Les méthodes employées par ALF ne font d’ailleurs pas l’unanimité au sein même des antispécistes.» Et d’en faire «un défi pour le renseignement»: «La confirmation d’une montée en puissance du ‘fondamentalisme écologique’ dans notre pays est désormais une affaire de sécurité d’État.»
Par ailleurs, il y a depuis quelques années une attention accrue en Europe de la part des institutions policières et judiciaires et des services de renseignement pour cette cause, comme le montre l’inscription depuis 2008 par Europol de «l’extrémisme animaliste» comme cinquième plus grande menace terroriste.
Aux yeux des militants, cette étiquette «extrémiste» est surtout un moyen utilisé par les médias ou les autorités pour détourner l’attention sur la véritable violence, celle faite aux animaux.
«C’est une manière très simple de diaboliser tout opposant au système actuel. Si on vient aux fondements de l’antispécisme, à savoir sortir de l’idéologie violente et discriminatoire entre les espèces, il est tout sauf violent. Faire un graffiti sur une vitrine d’une boucherie, cela va être considéré comme violent, alors qu’il suffit de nettoyer, et c’est tout. Par contre, les millions d’animaux qu’on égorge tous les jours, on ne va pas trouver cela violent. Il y a une inversion des normes, en criminalisant ceux qui dénoncent la violence systémique», estime Grégory.
«Dans certains pays d’Europe, les mouvements antispécistes sont en effet injustement criminalisés», continue Els Van Campenhout d’Animal Rights. Et de pointer des «lobbys qui génèrent des millions, voire des milliards de chiffres d’affaires. Ces groupes de pression peuvent exercer une pression politique ou avoir de bons ‘amis’ en politique qui défendent leurs intérêts. Le vrai crime, cependant, réside dans la poursuite d’un système non durable qui ne considère pas les animaux comme des individus vivants et sensibles, les exploite et les tue en masse».
Même constat chez Bite Back: «Ce n’est un secret pour personne que le mouvement des droits des animaux est surveillé et plus durement réprimé que les agriculteurs lors de leurs manifestations, par exemple.»
Une radicalité verbalisée
C’est d’ailleurs un aspect relevé par l’Institut national de criminalistique et de criminologie (INCC) dans une étude consacrée aux personnes qualifiées de «radicalisées», allant des anarchistes aux islamistes, en passant par les antispécistes1.
La nature des actions antispécistes peut en effet avoir un caractère traumatisant: «Non seulement, par le fait de se retrouver dans des élevages, des abattoirs avec des animaux qui vont être abattus, mais aussi dans le vécu de la répression qui peut être très violente. Les antispécistes font l’expérience de la violence étatique, à travers la police qui les évacue, mais aussi de la part d’éleveurs, par exemple. Certains militants racontent des retours d’expérience où ils ont été, eux ou des camarades, violentés. Il y a là un aspect traumatisant qui peut être difficile à vivre», précise Benjamin Mine, un des auteurs de l’analyse.
Dans le panel rencontré – trois militants antispécistes, les chercheurs ont fait la connaissance d’une personne engagée depuis plus d’une décennie, tandis que les deux autres militants l’étaient depuis moins de cinq ans. Pour ces dernières, relève encore Benjamin Mine, l’usage de la violence est un point de divergence: «Une personne ne privilégie pas du tout des modes d’action violents parce qu’elle trouvait que l’usage de la violence desservait la cause, tandis que l’autre trouvait qu’il n’y avait pas moyen de faire autrement, que la fin justifiait les moyens, que c’était une forme de rééquilibrage des forces, vu qu’elle était confrontée à une violence obscène de la part de ce qu’elle nomme le ‘système’ industriel, économique, capitaliste.»
Quant au militant engagé depuis plus longtemps, il désavouait cette «violence», ajoute Benjamin Mine: «À ses yeux, le rapport de force est certes inéquitable, mais on ne peut pas gagner en usant de la force, car, ce qui compte, c’est de perdurer dans le temps et dès lors de pouvoir s’adapter, en ayant des modes d’action plus résilients. En outre, il faut sensibiliser les gens au maximum pour qu’il y ait toujours plus de personnes qui soient conscientes de ces enjeux-là et qui adhèrent à la cause.»
Au-delà de ce recours ou non à la violence, ce qui interpelle dans cette enquête, c’est le poids psychologique et émotionnel important par rapport à cet engagement.
«Ce poids est plus explicite chez les antispécistes. Je ne dirais pas qu’il est absent des autres militants rencontrés. Ils en ont simplement davantage parlé, constate Benjamin Mine. C’est lié, selon moi, à l’important contraste qu’ils vivent entre le narratif qu’ils privilégient, l’idéologie qu’ils défendent et la société globale à laquelle ils sont confrontés. Pour les militants, le fait d’être confrontés à des personnes qui ne sont pas conscientes de la violence animale, qui continuent à consommer à outrance, ou à des politiques qui n’avancent pas suffisamment vite, cela développe une charge mentale importante. Ils sont une goutte d’eau dans un océan qui n’a pas du tout conscience du sort d’animaux, lesquels sont considérés comme des objets, et non comme des êtres sensibles.» Ce contraste, et le fait d’y être constamment confrontés, leur donne l’impression de vivre dans «une forme de dystopie», commente Benjamin Mine, générant une charge mentale, une pression émotionnelle importante.
Une pression d’autant plus forte que l’engagement militant bouleverse les réseaux relationnels. «Certains parviennent à concilier leur engagement avec leur vie sociale, d’autres font l’expérience de la rupture ou du renouvellement complet de leur réseau.» Et le chercheur de pointer les réseaux sociaux qui «interviennent tant dans l’élaboration d’un narratif, en étant confrontés en permanence à un même discours, mais aussi dans la manière de recréer des liens avec différentes personnes qui partagent des points de vue identiques, créant de la sorte une forme d’entre-soi.»
1. La radicalité verbalisée, Analyse du discours de personnes radicales à propos de leur engagement et de leur(s) expérience(s) avec les autorités, B. Mine, P. Jeuniaux et I. Detry, INCC, septembre 2022.