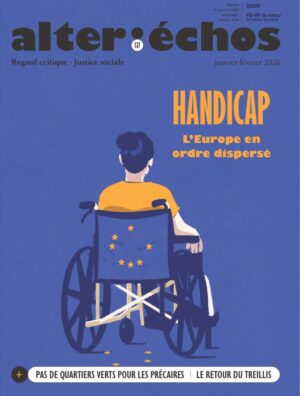C’est une vraie levée de boucliers qui se dresse, depuis mars dernier, contre la proposition de loi modifiant le secret professionnel. Celle-ci poursuit malgré tout son bonhomme de chemin au Parlement, actuellement examinée en commission Justice. Inscrite dans l’accord de gouvernement et introduite par trois députés N-VA, la proposition vise à remplacer la «possibilité» de lever le secret professionnel face à des situations de danger exposant des personnes vulnérables (notamment des enfants) en une «obligation» de signalement.
Professionnels de l’aide à l’enfance, travailleurs sociaux, chercheurs, personnel soignant, etc., font depuis savoir leur rejet sans équivoque de cette proposition, dont ils estiment qu’elle produira l’effet inverse à celui recherché: une baisse des signalements des violences sur mineurs, due à la perte de confiance des victimes ou témoins qui oseront moins parler.
Depuis son bureau avec vue sur le palais de justice de Bruxelles, la juge de la jeunesse Michèle Meganck livre un avis moins tranché. Elle dit comprendre «l’inquiétude du monde psychosocial», mais elle fait part aussi de sa «colère» quand elle reçoit des dossiers de maltraitance qui auraient dû être pris en main bien plus tôt: «Il y a des gens qui savaient, qui se sont tus ou qui ont parlé à très bas bruit. Et finalement l’enfant a perdu un morceau de sa vie, et c’est parfois irréparable. Cela me fâche, et là, je soutiens plutôt l’idée que, quand on sait, on parle.»
Au-delà des questions de pertinence et d’efficacité, la proposition de loi sur le secret professionnel est en tout cas le symptôme d’un phénomène: l’intensification de la maltraitance infantile. «En 22 ans que je fais ce métier, la maltraitance s’est durcie, les parents sont beaucoup plus abîmés… poursuit la juge bruxelloise. Quand j’ai commencé, on ouvrait parfois des dossiers parce qu’un enfant n’allait plus à l’école depuis quelques mois. Aujourd’hui, c’est le dixième problème et il y en a neuf bien plus graves avant. Il y a eu une aggravation de la situation de danger de manière générale.»
Une aggravation encore renforcée il y a cinq ans, au passage du Covid et de ses confinements. La pédiatre Sandra Pannizzotto, cheffe de la cellule «maltraitance» au CHR de Liège, créée il y a 20 ans et unique en son genre en Wallonie, en a fait l’amer constat: «À la sortie du premier confinement, on a observé une augmentation des cas de 40%. Et parmi ces 40%, deux choses ont émergé: les violences physiques graves sur les tout-petits (fractures du crâne complexes, bébés secoués, brûlures…) et les abus sexuels, surtout sur les petites filles d’environ 8 ans. Aujourd’hui encore, on a des situations de plus en plus nombreuses et de plus en plus graves au niveau des faits commis.»
De l’intervention à la déjudiciarisation
Couplée au manque de moyens endémique de l’aide à la jeunesse et de la justice, cette augmentation des faits de maltraitance donne lieu à des situations régulièrement relayées dans les médias: listes d’attente kilométriques pour les institutions d’hébergement, manque de places dans les familles d’accueil, enfants logés à l’hôpital faute de mieux. Les services de prévention sont eux aussi saturés, ce qui implique une prise en charge tardive des situations, qui, entre-temps, se sont aggravées et cristallisées.
Les choses n’avaient pourtant pas si mal commencé. Pour prendre en main les maltraitances infantiles, la Communauté française a fait, en 1991, un choix original: celui de la «déjudiciarisation». Le décret de l’Aide à la jeunesse a ainsi consacré le principe d’«aide consentie» pour toute situation où un mineur est en danger ou en difficulté, principe qui repose sur l’accord et l’adhésion des parents à l’aide qui leur est proposée. Contrairement à d’autres pays voisins, les violences infligées aux enfants ne passent donc pas d’office et directement par la case tribunal. Le nouveau code de l’Aide à la jeunesse de 2018 rappelle en outre que le placement d’un mineur, en institution ou en famille d’accueil, doit être envisagé comme solution de dernier recours.
Pour prendre en main les maltraitances infantiles, la Communauté française a fait, en 1991, un choix original: celui de la «déjudiciarisation» […] Contrairement à d’autres pays voisins, les violences infligées aux enfants ne passent donc pas d’office et directement par la case tribunal.
C’est loin d’avoir été toujours le cas. Cette déjudiciarisation est en fait la réponse à des décennies d’intervention étatique dans les familles tout au long du XXe siècle, qui a conduit à de nombreux placements d’enfants en institution ou dans des familles d’adoption, souvent pour des raisons de pauvreté. Attablée à la terrasse de l’UCLouvain Saint-Louis où elle exerce en tant que maîtresse de conférences invitée et chercheuse postdoctorante, Anne-Catherine Rasson explique comment, à partir de la fin du XXe siècle, une jurisprudence met en évidence la nécessité de maintenir les liens entre un enfant et ses deux parents d’origine. «Les organes de protection des droits humains, comme la Cour européenne des droits de l’homme, ont rappelé que briser le lien entre un enfant et un parent portait atteinte à la vie familiale. Plus généralement, il y a eu cette idée très forte que, pour qu’un enfant grandisse bien, il avait besoin de ses deux parents», retrace la docteure en sciences juridiques, spécialiste des droits de l’enfant.
Parallèlement, en 1989, l’adoption de la Convention des droits de l’enfant fait de ce dernier un sujet de droit, nécessitant une protection renforcée en raison de sa vulnérabilité. Commence alors une quête infiniment complexe: où et comment bien placer le curseur entre le droit à la protection de l’enfant d’un côté et le droit à la vie familiale de l’autre?
«Éviter que ça se répète»
Sur le terrain, deux acteurs se partagent la prise en charge de la maltraitance infantile: SOS Enfants et le Service d’aide à la jeunesse (SAJ). Tous deux appliquent cette approche collaborative axée sur le consentement des parents soupçonnés de maltraitance à entrer dans un processus d’aide.
Il existe 15 équipes SOS Enfants en Fédération Wallonie-Bruxelles; elles interviennent à la demande de toute personne ou tout organisme suspectant des faits de maltraitance à l’égard d’un enfant. En 2023, 6.183 faits leur ont été signalés – un chiffre probablement bien en deçà des cas réels, dont beaucoup passent sous les radars. Les cas de maltraitance recensés recouvrent les violences physiques, les violences sexuelles, la maltraitance psychologique, un climat conflictuel entre adultes et la négligence. À elles deux, les violences physiques et sexuelles représentent plus de 50% des signalements aux équipes SOS Enfants.
Les cas de maltraitance recensés recouvrent les violences physiques, les violences sexuelles, la maltraitance psychologique, un climat conflictuel entre adultes et la négligence. À elles deux, les violences physiques et sexuelles représentent plus de 50% des signalements aux équipes SOS Enfants.
L’approche multidisciplinaire et systémique qui y est proposée permet de «comprendre comment la maltraitance infantile a pu émerger au sein de la famille et d’agir pour qu’elle ne se reproduise plus, explique Charlotte Bearelle, directrice administrative de SOS Enfants Namur. La déjudiciarisation permet à toute une partie des situations – pas toutes, mais beaucoup – d’aboutir à un meilleur environnement pour l’enfant».
Consentements de façade
Parmi les convaincus de la déjudiciarisation, il y a Maïté Beague. Juriste et ancienne travailleuse au sein d’une équipe SOS Enfants, elle ne doute pas des atouts de ce système, «assez exceptionnel» et «souvent cité en exemple à l’étranger».
Actuellement collaboratrice à la Commission nationale pour les droits de l’enfant, elle reconnaît toutefois un travers à l’aide consentie: «Lorsque qu’une autorité comme le SAJ propose l’intervention d’une équipe SOS Enfants à des parents suspectés de maltraitance, il est clair que la plupart vont dire oui. On peut donc se retrouver avec des consentements de façade; on passe plusieurs rendez-vous avec des parents qui n’ont aucune envie de collaborer ou de se remettre en question et la judiciarisation finit, de toute façon, par intervenir.»
Face à ces cas de faux consentement, ou à un refus catégorique des parents de collaborer, voire à un déni de maltraitance pourtant évidente, SOS Enfants peut saisir le SAJ et éventuellement le parquet. «On fait partie de certains maillons de la chaîne de la société qui doivent pouvoir alerter: on a essayé de voir ce qu’il y avait de ‘récupérable’, de travailler la parentalité avec ces parents, mais ces derniers s’avèrent beaucoup trop abîmés par leur propre parcours de vie, incapables de pouvoir se centrer sur les besoins (parfois minimaux) de leurs enfants», détaille Charlotte Bearelle.
«Lorsqu’une autorité comme le SAJ propose l’intervention d’une équipe SOS Enfants à des parents suspectés de maltraitance, il est clair que la plupart vont dire oui. On peut donc se retrouver avec des consentements de façade; on passe plusieurs rendez-vous avec des parents qui n’ont aucune envie de collaborer ou de se remettre en question et la judiciarisation finit, de toute façon, par intervenir.»
Maïté Beague, juriste et ancienne travailleuse SOS Enfants
En 2023, le SAJ est intervenu dans 9.181 cas de (suspicion de) maltraitance, soit 17% du total de ses interventions. Au-delà du beau principe qu’elle représente, Joëlle Piquard, conseillère de l’aide à la jeunesse à Liège, voit dans l’aide consentie un intérêt bien concret: «Si on arrive à sensibiliser un parent à un type de fonctionnement inadéquat, à ce qu’il faut faire pour le corriger, il y aura moins de risques de récidive que si on confronte ces mêmes parents à de grands principes de loi.»
Mais tout comme les équipes SOS Enfants, les conseillers de l’aide à la jeunesse peuvent eux aussi être confrontés aux refus, assumés ou non, de collaboration, pouvant induire une situation potentielle de danger pour l’enfant. L’étape suivante? La judiciarisation.
Sceptique face à ce qu’elle nomme l’«idéal du consentement», la juge Michèle Meganck observe, non sans déception, que, «quand le SAJ décide de judiciariser, c’est comme s’ils avaient raté leur coup. Mais la justice, c’est juste une autre aide. Et il faut accepter que tout le monde ne puisse pas décider tout… D’autant plus lorsqu’il s’agit de gens qui sont sous l’emprise, soit de substances, soit d’un partenaire. À un moment donné, je trouve même insensé d’aller chercher le consentement de ces personnes-là».

Une lecture genrée de la maltraitance
En une vingtaine d’années, la notion de maintien du lien a largement infusé la société. Elle se lit par exemple en filigrane de la loi de 2006 sur l’hébergement égalitaire, qui vise à privilégier un partage égal du temps de l’enfant chez ses deux parents après une séparation ou un divorce.
«De cette idée de maintien du lien ont découlé d’autres grandes croyances, qui sont encore fortement ancrées dans la société et qu’il faut déconstruire, comme le fait que la violence conjugale n’affecterait pas l’enfant témoin, qu’un conjoint violent ne serait pas forcément un mauvais parent…», ajoute Anne-Catherine Rasson, qui intervenait justement ce matin-là devant les juges de la Cour constitutionnelle sur les droits de l’enfant.
Depuis peu, une nouvelle grille de lecture s’est ajoutée dans cette recherche complexe d’équilibre entre protection et maintien du lien: celle du genre. Car #MeToo a mis en lumière de nouveaux concepts – le contrôle coercitif, les violences intrafamiliales – qui permettent aujourd’hui une compréhension plus fine des violences subies par les enfants et leurs mères.
Mais le temps des idées avance parfois plus vite que celui des pratiques. «Il faudrait que ces services [le SAJ et SOS Enfants, NDLR] évoluent et tiennent compte de cette nouvelle manière d’appréhender les relations intrafamiliales. Ce qui se passe au sein des foyers, ce ne sont pas uniquement des relations interpersonnelles, ce sont aussi des faits de société, liés à des stéréotypes de genre, à la domination masculine», défend Fatma Karali, fondatrice du collectif «Les mères veilleuses», un réseau d’entraide et de solidarité entre mères monoparentales.
«Mettre toujours les deux parents sur le même pied d’égalité, avec l’idée qu’il faut coopérer même quand il y a des violences, ce n’est pas possible! On continue de surfer sur cette approche ‘familiariste’, en se disant qu’un papa, même s’il abuse de son enfant ou s’il est violent, c’est toujours mieux que pas de papa.»
Fatma Karali, fondatrice du collectif «Les mères veilleuses»
Jusqu’à il y a peu, c’est plutôt une autre lecture des violences intrafamiliales qui était véhiculée au sein de SOS Enfants et du SAJ, à en croire leur recours au syndrome d’aliénation parentale (SAP). Un concept controversé selon lequel une situation de rejet d’un parent (souvent le père) par un enfant est le résultat d’une manipulation par l’autre parent (souvent la mère). Concept notamment invoqué lors d’accusations d’abus sexuels, et qui a pu motiver des décisions de justice de retirer la garde de leur(s) enfant(s) à des mères protectrices.
«Les mères veilleuses» font partie des associations féministes qui ont milité pour sonner le glas de ce «concept fallacieux», dont la légitimité a été déconstruite par plusieurs études scientifiques. «Or, jusqu’en 2021, le SAJ et le SPJ [service de protection de la jeunesse, NDLR] en faisaient encore la promotion sur leur site internet», soupire Fatma Karali. Reconnaissant y avoir eu recours par le passé, SOS Enfants Namur assure ne «quasi plus» s’appuyer sur ce concept «beaucoup trop clivant» et qui «donne accès à une lecture unilatérale».
Un parcours «traumatique»
Pour Fatma Karali, le principe même d’aide consentie pose également problème et empêcherait une réponse satisfaisante aux violences conjugales ou faits d’inceste commis par les pères. Parmi les mamans solos du collectif, beaucoup ont perdu confiance dans le SAJ et SOS Enfants, nous explique-t-elle. «Mettre toujours les deux parents sur le même pied d’égalité, avec l’idée qu’il faut coopérer même quand il y a des violences, ce n’est pas possible! On continue de surfer sur cette approche ‘familiariste’, en se disant qu’un papa, même s’il abuse de son enfant ou s’il est violent, c’est toujours mieux que pas de papa.»
Ces propos trouvent écho dans l’histoire de Vanessa. Cette maman de deux ados nous reçoit au rez-de-chaussée d’une maison ixelloise. Un refuge dont elle a hérité il y a sept ans et qui lui a permis de quitter le père de ses enfants. «À l’époque, j’ai pensé que j’étais enfin libre. Mais je n’étais pas prête pour le tiers de tout ce qui s’est passé ensuite, témoigne-t-elle. Il avait tellement une rage contre moi de l’avoir quitté qu’il a commencé à utiliser les enfants, à les monter contre moi.» Ça a commencé par des changements brusques de comportement chez ses enfants d’alors 6 et 8 ans lorsqu’ils revenaient de chez leur père – «ils m’ignoraient, m’accusaient de mensonges». Ça s’est poursuivi par ce qui, selon le témoignage de Vanessa, s’apparente à une «campagne de dénigrement» à plus large échelle de la part de son ex-conjoint. Convaincue par la psychologue de son fils, Vanessa finit par solliciter le SAJ. «J’ai pensé qu’à partir de ce moment-là, les choses allaient être cadrées, mais pas du tout. Ils ne se sont jamais prononcés, alors qu’il y avait des faits clairs.» Lors d’une hospitalisation de plusieurs mois à l’Hôpital des Enfants (Huderf), elle raconte que son fils «prend conscience de la manipulation qu’il a subie» et dénonce auprès du personnel soignant des faits de violences psychologiques et menaces physiques dans le chef de son père. Un témoignage que l’hôpital signalera au SAJ. «Il y a eu des alertes», insiste Vanessa. Mais pas d’action. En février dernier, le père a infligé des coups à son fils, puis en mai, à sa fille.
Vanessa qualifie son parcours de «traumatique», n’ayant «aucun sens»: «Vous avez vécu onze ans de violences physiques et psychologiques et on vous demande de faire des thérapies familiales, on continue de parler de ‘conflits parentaux’…» Résignée face à «l’inaction» de la juge de la jeunesse, elle espère à présent que le tribunal de la famille lui accordera la garde exclusive de ses enfants.
L’aide à la jeunesse devrait-elle ajuster ses pratiques pour mieux prendre en compte les violences parfois invisibles qui s’exercent au sein d’un couple et d’une famille? Interrogée à ce sujet, Joëlle Piquard rappelle le cadre: les SAJ travaillent sur la base d’un décret, qui leur impose la collaboration avec les deux parents. «Et l’autorité parentale, c’est une loi fédérale qui garantit les droits de chacun des parents. Je ne peux pas, à un moment donné, considérer qu’un parent a moins de droits ou plus de droits qu’un autre.»
Le placement, un «eugénisme social»?
Si selon certains, le SAJ et SOS Enfants pèchent à trop vouloir ménager la chèvre et le chou, un tout autre reproche leur est aussi adressé: un excès de mesures d’éloignement, visant en particulier les familles en situation de précarité.
Avocat de la jeunesse passionné – toujours de service à 71 ans –, Jacques Fierens est un proche de longue date du mouvement ATD Quart Monde. «Pendant 40 ans à leurs côtés, j’ai essayé de découvrir ce qu’était la réalité de la pauvreté en Belgique.» Selon lui, la question des placements abusifs soulevée à la fin du XXe siècle «n’est pas du tout résolue aujourd’hui». Il assure que les équipes SOS Enfants ne sont pas perçues comme une aide possible par les familles à problèmes, «surtout pas les familles pauvres qui vivent dans la hantise du placement». Indigné au franc-parler, l’avocat voit dans de nombreux cas de prise en charge des violences sur enfants un «eugénisme social», consistant à juger de «qui peut être parent et qui ne peut pas l’être».
«Je ne défends pas l’idée de la ‘sainte famille’ et je trouve qu’il faut chaque fois examiner les effets du maintien ou de la rupture du lien sur l’enfant. Ce qui m’importe, c’est son besoin à lui. Quand, dans la balance, il y a les besoins de l’enfant et le droit des parents, pour moi les droits des parents pèsent toujours moins lourd que les besoins de l’enfant.»
Michèle Meganck, juge de la jeunesse à Bruxelles
La pauvreté et des conditions de vie très précaires peuvent indéniablement engendrer une forme «d’empêchement» dans la parentalité. Mais plus qu’un facteur direct de maltraitance, la pauvreté est surtout un «espace de détection et un grand frein au retour en famille, estime Anne-Catherine Rasson. Beaucoup d’enfants arrivent dans le giron de l’aide à la jeunesse pour des problématiques de décrochage scolaire. Ou parce que la visite médicale a identifié un besoin de lunettes et que, deux ans plus tard, l’enfant n’en porte toujours pas. Ce sont des moments de détection. Mais dans les familles aisées, il n’y a pas ces problèmes-là, on dissimule plus facilement les coups, l’inceste…»
Un constat confirmé sur le terrain par la pédiatre Sandra Pannizzotto: «La maltraitance infantile a lieu dans tous les milieux socio-économiques. Être maltraité dans un milieu favorisé, c’est même un facteur de risque en plus, parce que c’est beaucoup plus difficile à voir et à diagnostiquer. C’est plus difficile d’aller dire à un avocat, un ingénieur ou un médecin: ‘Les bleus de votre enfant, ce n’est pas normal, je crois qu’il est peut-être victime de maltraitance.’»
L’enfant comme boussole
Placements abusifs ou mesures de protection insatisfaisantes; maltraitance explicite ou dissimulée; parents de bonne volonté ou malveillants… Les cas de figure sont incalculables. D’où la nécessité, soulevée par nos intervenants, du «cas par cas». «Il n’y a aucun bon diagnostic théorique. Entre protection et lien familial – lien qui peut être pensé de plein de façons différentes –, il faut trouver la meilleure réponse pour le plus grand respect des droits de l’enfant. Et pour y arriver, le guide selon moi, c’est la parole de l’enfant», résume Anne-Catherine Rasson, qui a récemment ajouté à sa caquette de chercheuse celle de responsable d’un service résidentiel général (SRG) à Bruxelles. Une pratique de terrain qui est venue compléter, parfois nuancer, ses analyses théoriques. «Ce qui est par exemple très surprenant sur le terrain, c’est la part de jeunes qui ont grandi dans des contextes familiaux de violences psychologiques ou physiques, parfois extrêmement graves, et qui pourtant sont très demandeurs d’être en lien avec leurs parents ou qui retournent chez eux à la majorité.» «La question du lien est tellement sensible qu’on ne peut pas le traiter de façon globale, confirme Joëlle Picard. Il faut l’envisager à l’aune de chaque situation individuelle.»
C’est ce que tentent également d’accomplir Michèle Meganck et ses collègues juges du tribunal de la jeunesse bruxellois, face aux 3.500 dossiers qu’ils ont à traiter chaque année, toutes problématiques confondues. «Je ne défends pas l’idée de la ‘sainte famille’ et je trouve qu’il faut chaque fois examiner les effets du maintien ou de la rupture du lien sur l’enfant. Ce qui m’importe, c’est son besoin à lui. Quand, dans la balance, il y a les besoins de l’enfant et le droit des parents, pour moi, les droits des parents pèsent toujours moins lourd que les besoins de l’enfant.»
400 jeunes sur liste d’attente
Reste que cette attention aux cas particuliers et aux détails inaperçus, cet effort du sur-mesure, nécessite du temps et des moyens dont l’aide à la jeunesse et la justice manquent cruellement. «On passe notre temps à prendre des décisions qui ne sont pas exécutées. Pour les mineurs en danger, il y a une liste d’attente de 350 à 400 jeunes qui attendent une place en institution», poursuit la juge. Qu’advient-il de ces mineurs? Certains vivent à l’hôpital, d’autres trouvent une sécurité (hors vacances) à l’internat… D’autres sont contraints de rester chez eux, en proie à la violence ou à la négligence. «Ça nous arrache le cœur. Ce qui se passe est gravissime.»
Un tel aveu d’impuissance pourrait-il expliquer le maintien, parfois, de situations pourtant graves dans le giron du SAJ? «Il y a une certaine tendance à vouloir garder les situations au niveau de l’aide consentie, soulève Maïté Beague. C’est selon moi, entre autres, parce que les conseillers du SAJ savent que les juges de la jeunesse sont complètement débordés et bloqués par rapport aux mesures qu’ils souhaiteraient prendre.»
À l’aide consentie et à la judiciarisation s’ajoute une troisième voie, moins tangible et sans doute moins en vogue: celle de la prévention et de la sensibilisation. La Belgique pourrait ainsi doter son Code civil d’une loi condamnant les violences éducatives dites ordinaires (ou «châtiments corporels»). Elle est l’un des derniers pays du Conseil de l’Europe à ne pas avoir légiféré en la matière et a, de ce fait, été l’objet de plusieurs condamnations par le Comité européen des droits sociaux et le Comité des droits de l’enfant des Nations unies.
Une telle loi, contrairement à celle proposée par les députés N-VA, ne viserait pas à renforcer l’arsenal répressif, mais permettrait d’éduquer, de sensibiliser en jetant les bases d’une socialisation commune autour de la non-violence. Un impératif pour Anne-Catherine Rasson, selon qui «une société où il y a une sorte de permission autour des violences éducatives dites ordinaires, où il n’y a pas de norme juridique, symbolique qui dise ‘ici on ne frappe pas, on n’humilie pas pour éduquer’, c’est un terreau fertile pour de plus graves violences au sein de la famille».
Le résumé
– Les cas de maltraitance infantile intrafamiliale se sont intensifiés et aggravés ces dernières années.
– Leur prise en charge se joue (dans un premier temps) loin des tribunaux, en collaboration avec les parents.
– Une approche innovante visant à maintenir les liens familiaux mais qui se heurte certains écueils.