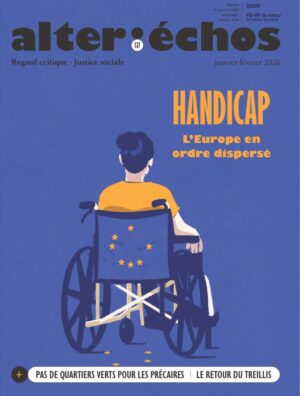Pour «profiter de sa pension», encore faut-il y arriver en bonne santé… et vivant. «Le système de pensions actuel part du principe que l’espérance de vie est la même pour tout le monde, ce qui n’est évidemment pas le cas», rappelle Maarten Gerard, responsable du service d’études de la CSC. Sous couvert d’équité, les réformes actuelles continuent d’ignorer ce que les démographes appellent les «inégalités sociales de mortalité». Rappelons que depuis la révolution industrielle, l’espérance de vie en Belgique est en constante augmentation. En 1885, elle était de 45 ans tandis qu’elle s’élève aujourd’hui à 82,4 ans1. Alors que par le passé, les morts prématurées étaient fréquemment liées aux maladies infectieuses, aujourd’hui, le mode de vie (alimentation, consommation d’alcool et de tabac, exercice physique, exposition aux polluants…) et l’accès aux soins sont devenus les facteurs déterminants dans l’espérance de vie. Or, l’accès à un mode de vie sain et à un suivi médical adapté est directement corrélé au niveau socio-économique des individus. Certains travaux ont ainsi mis en avant la propension des personnes avec une profession intellectuelle à consulter plus souvent des médecins spécialistes, non seulement parce qu’elles sont mieux informées, plus mobiles, plus aisées financièrement, mais aussi parce qu’elles perçoivent rapidement la douleur ou la gêne physique comme inhabituelles2. En revanche, dans les classes ouvrières, où le corps est un outil de travail, ces sensations sont perçues comme normales et retardent souvent le diagnostic de problèmes de santé bien réels.
Des inégalités de mortalité en augmentation
C’est pourquoi l’augmentation de l’espérance de vie s’est accompagnée de l’apparition de fortes inégalités sociales de mortalité. «Aujourd’hui, à 67 ans, 31% des hommes appartenant au décile (ndlr: les 10%) le plus défavorisé seront décédés contre 8% des hommes du décile le plus favorisé, explique Jean-Paul Sanderson, chercheur au sein du Centre de recherches en démographie de l’UCLouvain. Concernant les femmes, 18% des femmes du décile le plus défavorisé sont déjà décédées à 67 ans, contre seulement 5% dans le décile le plus favorisé.» Pour déterminer l’appartenance sociale des personnes, Jean-Paul Sanderson et ses collègues ont mis au point un indice multidimensionnel comprenant plusieurs indicateurs, à savoir le niveau d’instruction, le statut socioprofessionnel, le niveau de revenus et les conditions de logement3.
Alors que par le passé, les morts prématurées étaient fréquemment liées aux maladies infectieuses, aujourd’hui, le mode de vie (alimentation, consommation d’alcool et de tabac, exercice physique, exposition aux polluants…) et l’accès aux soins sont devenus les facteurs déterminants dans l’espérance de vie. Or, l’accès à un mode de vie sain et à un suivi médical adapté est directement corrélé au niveau socio-économique des individus.
«La pauvreté est un phénomène multifactoriel. Si vous n’avez pas des revenus très élevés, c’est souvent lié à votre niveau d’instruction. Cela va impacter votre emploi mais aussi votre logement, ce qui viendra encore ajouter à la précarité.» Selon Marteen Gerard de la CSC, «les travailleurs qui n’atteindront pas l’âge officiel de la retraite sont aussi ceux qui ont des conditions de travail pénibles avec des salaires bas, qui ne leur permettront pas de sortir plus tôt du métier». Une triple peine. Jean-Paul Sanderson, qui a souvent constaté l’indifférence du monde politique concernant les travaux de recherche sur les inégalités sociales de mortalité, souligne quant à lui le «cynisme» de la situation: «Non seulement les personnes les plus défavorisées jouiront moins longtemps de leur pension, mais les années où elles ont cotisé serviront en réalité à payer les pensions des plus riches.» Sans compter que, depuis les années 90, les écarts continuent de se creuser: entre 1992 et 2016, les gains d’espérance de vie ont été de 4,3 ans pour les 25% les plus défavorisés contre 5,1% pour les 25% les plus favorisés chez les hommes et de 2,1 ans pour les plus défavorisées et 3,9 ans pour les plus favorisées chez les femmes4. «Autrement dit, les inégalités se creusent, résume Jean-Paul Sanderson. En grande partie parce que le niveau d’instruction est beaucoup plus déterminant qu’avant dans la place que l’on peut occuper au niveau professionnel.»
Sans compter que, depuis les années 90, les écarts continuent de se creuser: entre 1992 et 2016, les gains d’espérance de vie ont été de 4,3 ans pour les 25% les plus défavorisés contre 5,1% pour les 25% les plus favorisés chez les hommes et de 2,1 ans pour les plus défavorisées et 3,9 ans pour les plus favorisées chez les femmes.
L’espérance de vie en bonne santé – soit le nombre d’années qu’un individu peut s’attendre à vivre en pleine possession de ses moyens physiques ou mentaux et sans incapacité – est elle aussi bien meilleure pour les personnes plus diplômées. Selon Sciensano (Institut de santé publique belge), en 2018, à 65 ans, un homme pouvait s’attendre à vivre encore 12,5 ans en bonne santé, contre 12,4 ans pour une femme5. Mais lorsqu’on regarde les chiffres dans le détail, on constate qu’à 25 ans, les personnes qui n’ont pas dépassé le secondaire inférieur n’ont que 35 années en bonne santé devant elles. Avant 60 ans, leur santé sera déjà très dégradée ou elles seront décédées. Ces personnes ne jouiront donc jamais de cette «carotte» que constitue la retraite pour nombre de travailleurs.
Les effets de la retraite sur la santé
Les tenants d’un recul de l’âge de la retraite s’appuient parfois sur l’argument selon lequel la retraite nuirait à la santé. Pour vivre vieux et aller bien, il faudrait donc continuer à travailler le plus longtemps possible. En réalité, les études à ce sujet sont contradictoires. Certaines concluent à une dégradation de l’état de santé physique ou cognitive après la pension, par exemple au niveau des capacités de mémoire6. D’autres mettent au contraire en évidence un effet positif du passage à la retraite sur la santé, notamment au niveau de la santé mentale7. Les données laissent aussi entendre que les effets sur la santé du passage à la retraite diffèrent selon qu’on est un homme ou une femme. Une recherche a ainsi montré une augmentation de l’obésité chez les hommes pensionnés, mais pas chez les femmes8. Selon une autre étude, les décès prématurés augmentent de 13% chez les ouvriers retraités, tandis que chez les ouvrières, la retraite ne présente aucun impact négatif9.
Les données laissent aussi entendre que les effets sur la santé du passage à la retraite diffèrent selon qu’on est un homme ou une femme. Une recherche a ainsi montré une augmentation de l’obésité chez les hommes pensionnés, mais pas chez les femmes.
Par ailleurs, il apparaît que ce sont les personnes travaillant dans des conditions difficiles qui tirent le plus d’avantages de la retraite sur leur santé physique et mentale10. Retarder l’âge légal de la retraite pour ces travailleurs, c’est donc les priver plus longtemps de ces effets positifs, voire les annuler. «Un métier n’est pas toujours pénible en soi, explique Jean-Paul Sanderson. Il peut parfois le devenir à cause de l’âge et déclencher alors des problèmes de santé.» Dans une synthèse, des chercheurs du Département d’économie appliquée de l’ULB11 estiment donc que «des mesures adaptées à ces groupes doivent être proposées dans les réformes de pension». «Cela est d’autant plus justifié que les personnes issues de milieux défavorisés commencent généralement à travailler plus tôt et ont en moyenne une espérance de vie (en bonne santé) plus faible, ajoutent-ils. En d’autres termes, elles contribuent plus longtemps au système, et en perçoivent moins de bénéfices.»
Une mort sociale?
Beaucoup de personnes arrivent en réalité à l’âge de la retraite dans un état de santé déjà fortement compromis, en particulier si elles ont eu un métier pénible et/ou si ce sont des femmes qui assument par ailleurs un travail de «care». Ainsi, selon une étude de la Mutualité chrétienne de 2023, 43% des travailleurs en incapacité de longue durée ont plus de 55 ans. Ces travailleurs représentent 19% de l’emploi total en Belgique, mais la proportion d’entre eux en incapacité primaire ou en invalidité ne cesse d’augmenter: elle est passée de 11% en 2005 à 15% en 2019, avec une augmentation plus marquée chez les femmes de 50 à 64 ans, où la proportion de salariées absentes pour raisons de santé est passée de 11% en 2005 à 17% en 201912. «Les personnes en fin de carrière cumulent souvent le fait de devoir s’occuper de leurs parents qui sont en fin de vie et de leurs petits-enfants, commente Sylvie Dossin, secrétaire politique d’Eneo, le mouvement social des aînés de la MC. Si en plus, elles ont un travail avec peu de possibilités de conciliation avec la vie privée, les situations peuvent vraiment devenir compliquées.»
Le paradoxe étant que ces situations de surmenage constituent souvent une source de valorisation personnelle et sociale. Dans un contexte d’âgisme généralisé, rester «productif» demeure la condition sine qua non pour ne pas sombrer dans la honte et l’invisibilité. «Les personnes attendent tellement de leur retraite qu’elles l’imaginent parfois un peu comme un paradis, raconte Sylvie Dossin. Or, passée la phase de ‘lune de miel’, ça peut aussi être une perte de repères, un moment où tout s’arrête. On se retrouve alors avec de grands questionnements identitaires et une forme d’isolement qui peut faire rapidement décliner la santé.» Comme l’a récemment rappelé l’OMS, le lien social possède pourtant un effet protecteur sur la santé tout au long de la vie (réduction des phénomènes inflammatoires et du risque de problèmes de santé graves, amélioration de la santé mentale, prévention des décès prématurés), tandis que «la solitude et l’isolement social augmentent le risque d’accident vasculaire cérébral, de maladie cardiaque, de diabète, de déclin cognitif et de décès prématuré»13.
Dans un contexte d’âgisme généralisé, rester «productif» demeure la condition sine qua non pour ne pas sombrer dans la honte et l’invisibilité.
Bien sûr, comme le souligne Jean-Pierre Sanderson, cette perception de la retraite comme «mort sociale» concerne surtout les personnes avec des postes à responsabilité. Celles-là mêmes qui continuent à travailler «volontairement», au-delà de l’âge légal de la pension. «Mais avec les niveaux de pension actuels, il est probable que beaucoup de personnes devront se maintenir dans un emploi complémentaire uniquement pour des raisons financières, analyse le chercheur. Ce qui risque de provoquer de nouveaux problèmes de santé à court et à moyen terme.» Alors, on ne parlera plus seulement d’inégalités sociales de mortalité mais de retour en arrière: aux États-Unis et au Royaume-Uni, où le système de protection sociale n’a cessé de se dégrader, l’espérance de vie a déjà commencé à diminuer pour la première fois depuis la révolution industrielle.
1. Chiffres Statbel.
2. Bihr, R. Pfefferkorn, Le système des inégalités, Paris, La Découverte, 2008.
3. Thierry Eggerickx, Jean-Paul Sanderson et Christophe Vandeschrick, «Les inégalités sociales et spatiales de mortalité en Belgique: 1991-2016», Espace populations sociétés [en ligne], 2018/1-2 | 2018, mis en ligne le 22 juin 2018, consulté le 4 septembre 2025. URL: http://journals.openedition.org/eps/7416; DOI: https://doi.org/10.4000/eps.
4. Thierry Eggerickx, Jean-Paul Sanderson et Christophe Vandeschrick, op. cit.
5. https://www.belgiqueenbonnesante.be/fr/etat-de-sante/esperance-de-vie-et-qualite-de-vie/esperance-de-vie-en-bonne-sante.
6. Rohwedder, S., & Willis, R. J. (2010). «Mental Retirement». Journal of Economic Perspectives, 24 (1), 119‑138.
7. Eibich, P. (2015). «Understanding the effect of retirement on health: Mechanisms and heterogeneity». Journal of Health Economics, 43, 1‑12.
8. Godard, M. (2016). «Gaining weight through retirement? Results from the SHARE survey». Journal of Health Economics, 45, 27‑46.
9. Kuhn, A., Wuellrich, J.-P., & Zweimüller, J. (2010). Fatal attraction? Access to early retirement and mortality. IZA Discussion Papers, 5160, 59.
10. Mazzonna, F., & Peracchi, F. (2017). «Unhealthy retirement?» Journal of Human Resources, 52 (1), 128‑151.
11. https://dulbea.ulb.be/wp-content/uploads/2023/05/FINAL5_DULBEA_PolicyBrief-Solidaris_Pension-et-sante_2022-09-21.pdf.
12. https://cm-mc.bynder.com/m/377baff70196a927/original/Sante-Societe-n-6-bien-etre.pdf.
13. https://www.who.int/fr/news/item/30-06-2025-social-connection-linked-to-improved-heath-and-reduced-risk-of-early-death.