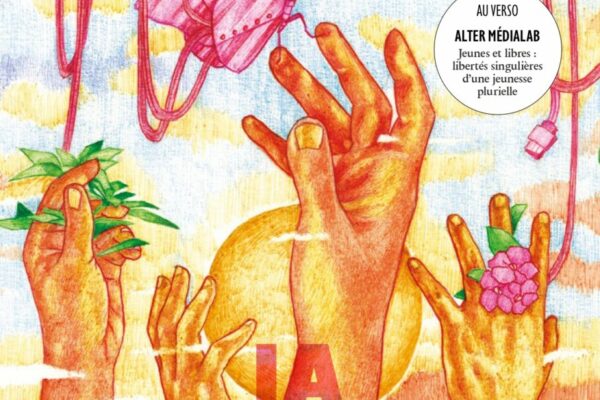Relisez son interview, réalisée il y a un an.
Alter Échos: Il y a quelques jours, le tribunal de première instance de Bruxelles a statué sur le fait que les mesures Covid ne reposent pas sur une base légale suffisante – ces mesures étaient encadrées par des arrêtés ministériels et non par la loi – et a laissé à l’État 30 jours pour mettre un terme à cette situation. Une victoire pour la Ligue des droits humains (LDH)?
Pierre-Arnaud Perrouty: On espérait évidemment cette décision. Cela fait un an qu’on dit dans les médias, au Parlement, qu’il y a un problème. On s’est résolu à cette action en justice pour faire bouger un peu les lignes et cela a sans doute contribué, parmi d’autres choses, à accélérer un peu le calendrier du Gouvernement. Le fait qu’un juge nous conforte dans ce qu’on pense, montre que la séparation des pouvoirs fonctionne encore en Belgique. Or ce n’était pas si évident pour un magistrat de prendre cette décision.
AÉ: Selon vous, à partir de quand peut-on considérer que nous ne sommes plus dans de l’urgence et que des mesures d’exception ne se justifient plus?
P-AP: J’ai envie de dire le moins de temps possible. Dans l’immédiat, pendant quelques semaines, on comprend. Il faut bien sûr prendre en compte le droit à la vie. Puis il faut pouvoir très vite remettre la machine en route et impliquer le Parlement.
«Le fait qu’un juge nous conforte dans ce qu’on pense, montre que la séparation des pouvoirs fonctionne encore en Belgique.»
AÉ: Sur le fond, concernant les mesures prises, estimez-vous que le principe de proportionnalité a été respecté ou au contraire dépassé?
P-AP: Là-dessus, on ne se positionne pas en tant que Ligue. Les mesures doivent être fondées sur une réalité de terrain, sur des constats objectifs, qui doivent être rendus publics. C’est important. Cela crédibilise et ça donne du sens à ces mesures. Si les gens comprennent pourquoi ces mesures sont prises, alors ils seront susceptibles d’y adhérer. Aujourd’hui, c’est assez transparent mais ce n’était pas du tout le cas au début (relire l’ensemble de notre dossier «Imaginer une santé en commun», AÉ 490, janvier 2021).
AÉ: Couvre-feu, limitations de circulation, ce sont tout de même des mesures assez fortes en termes de restrictions de libertés…
P-AP: Nous estimons que nous ne sommes pas compétents pour dire qu’une mesure est plus appropriée qu’une autre en fonction de la situation sanitaire. Par contre, notre rôle consiste à examiner ces mesures avec le prisme de l’État de droit et de dire qu’elles doivent être le moins attentatoires possible aux libertés fondamentales. Ces mesures doivent aussi être prises pour le moins de temps possible et être réévaluées en permanence selon la situation. Il faut un monitoring permanent. Et là effectivement, il y a parfois une sorte de facilité… L’exemple du couvre-feu est le bon: c’est sûr qu’un couvre-feu facilite le contrôle par les services de police. Mais c’est vrai que cela fait longtemps qu’il est instauré. Il y aurait peut-être besoin d’adapter les choses plus finement plutôt que de laisser en place cette mesure, certes très confortable pour les gestionnaires et les autorités de contrôle, mais très restrictive en termes de droits fondamentaux. Le droit d’aller et venir est une des premières libertés.
«Nous ne sommes pas compétents pour dire qu’une mesure est plus appropriée qu’une autre en fonction de la situation sanitaire. Par contre, notre rôle consiste à examiner ces mesures avec le prisme de l’État de droit.»
AÉ: Traçage du testing et aujourd’hui données relatives à la vaccination: vous êtes fort attentifs aux questions de protection des données. Pensez-vous que des limites ont été franchies?
P-AP: Des limites ont clairement été dépassées. Mais l’un des rares bons côtés de cette crise aura été, je pense, une prise de conscience beaucoup plus large des enjeux de protection des données. Je le vois dans la presse. Auparavant, très peu de journalistes s’en souciaient. Il y a vraiment un engouement, une attention plus grande des publics sur ces questions là. Y compris au Parlement, qui s’est rendu compte qu’il ne jouait plus vraiment son rôle de contrôle démocratique sur la manière dont l’État gère les données en sa possession. D’un point de vue gestionnaire, c’est sûr que c’est très pratique de rassembler toutes les données. Mais l’efficacité administrative ne peut pas être le seul critère. On se rend compte que l’administration, avec cette fameuse asbl la Smals (relire «Sécurité sociale : l’échange hors contrôle de nos données» et «La Smals, la vie privée de nos données», AÉ 433, novembre 2016), était un peu en roue libre là-dessus. On a une administration qui fonctionne un peu de manière autonome et un gouvernement qui ne demande pas l’avis de l’Autorité de protection des données. Cette autorité a dû taper sur la table pour demander à être consultée! Or non seulement il faut la consulter, mais aussi s’engager à respecter son avis. Avec le tracing ou les données de vaccination, il faut des analyses d’impact, qui n’ont pas été faites ou pas été rendues publiques. Il y a un vrai besoin de mettre en oeuvre une sorte de cadastre car aujourd’hui, personne n’est vraiment capable de dire de quelles données l’État dispose, où elles sont stockées, qui les gère et sur quelles base légale. On a absolument besoin de savoir ça. La loi sur la vie privée est en cours d’évaluation, cela va être l’occasion d’examiner tout cela (Lire aussi «Transparence et démocratie: les oubliées des données Covid?», AÉ web janvier 2021).
«L’un des rares bons côtés de cette crise aura été, je pense, une prise de conscience beaucoup plus large des enjeux de protection des données.»
AÉ: Que pensez-vous de la place que la police a pu prendre ou qu’on lui a laissé prendre cette année?
P-AP: Il faut reconnaître que les policiers n’ont pas un rôle facile. Personne n’a envie de ces mesures. Il y a clairement un problème de sanctions et de règles qui n’étaient pas claires au départ, surtout à Bruxelles où, d’une commune à l’autre les règles pouvaient varier, alors qu’en tant que citoyen, on n’est pas conscient du moment où on franchit la limite d’une commune. Quand les règles sont floues, on crée évidemment de l’arbitraire. Certains policiers se montrent très compréhensifs et pédagogues, d’autres beaucoup moins, avec les biais habituels qui font que si vous êtes d’une catégorie sociale supérieure et provenant d’un quartier aisé, vous avez beaucoup plus de chance que le contact se passe bien. On a relancé l’Observatoire des violences policières, Police Watch en mars dernier, par hasard le week-end même du premier lockdown. Un des objectifs de cet observatoire était d’informer mais aussi de recueillir des témoignages. Assez rapidement quand les gens ont recommencé à sortir, on a reçu beaucoup de témoignages tournant autour du respect des règles de confinement. On a publié en juin un rapport « Abus policier et confinement » qui faisait le constat de beaucoup de cas de violences et d’insultes injustifiables, et qui confortait ce qui existait déjà précédemment: il y a trois facteurs qui importent très fort la relation avec la police, l’âge, le niveau socio-économique et la perception ou le fait d’être d’origine étrangère. On le savait, ce n’est pas une surprise. Mais cela a été confirmé pendant cette période (lire aussi «Police et jeunes: bilan d‘un confinement sous tension», AÉ 484, mai 2020).
AÉ: Les violences policières sont un phénomène mis en lumière par la crise?
P-AP: Je ne pense pas que cela ait été dû à la crise mais plutôt à quelques affaires fortement médiatisées, à l’étranger (mort de George Floyd, dont le procès du policier est en cours, NDLR) et en Belgique (les cas d’Adil et de Mehdi). Il y avait un contexte qui était prêt et qui s’est un peu emballé. On observe aujourd’hui une position de refus de la société civile des violences policières. Et alors que beaucoup d’acteurs du politique ou de la police continuaient jusqu’il y a peu à contester la dimension systémique de cette problématique, là cela devient difficile d’argumenter le contraire. Il y a une prise de conscience qui gagne du terrain chez les politiques – notamment sur le profilage ethnique à Bruxelles – mais aussi dans le corps policier (lire aussi «Violences policières: pire qu’hier, mieux que demain?», AÉ 486, septembre 2020).
«Concernant les violences policières, il y a une prise de conscience qui gagne du terrain chez les politique – notamment sur le profilage ethnique à Bruxelles – mais aussi dans le corps policier.»
AÉ: Le droit de manifester a aussi été mis à mal depuis un an…
P-AP: Il y a eu pas mal de manifestations soit tolérées soit autorisées à certains conditions. Un des premières a justement été celle du «Black lives matter» (relire notre dossier «Antiracisme, une lutte à fleur de peau», AÉ 486, septembre 2020). Selon les lieux, la police a été plus ou moins tolérante. Mais c’est vrai que certaines manifestations ont totalement dégénéré si on regarde le nombre de personnes arrêtées alors qu’elles n’avaient pas provoqué de troubles à l’ordre public. Des gens ont aussi été arrêté alors qu’ils n’avaient rien à voir avec ces manifestations. Nous avons reçu beaucoup de témoignages, notamment suite à la manifestation du 24 janvier (manifestation contre la justice de classe et raciste, NDLR), concernant des propos sexistes, racistes, des violences, des coups. Encore une fois, ce n’est pas le fait de tous les policiers, mais la persistance de ce phénomène non réglé conduit à dire qu’il y a un problème systémique.
AÉ: Au-delà des «mesures Covid», la crise actuelle a mis en lumière pas mal de problématiques préexistantes. Qu’est-ce qui vous a le plus marqué?
P-AP: On savait qu’il y avait de plus en plus une prédominance de l’exécutif sur le Parlement. Cela s’accentue. Les catégories les plus vulnérables ont aussi assez peu prises en compte. Je pense aux personnes sans logement qui devaient se balader avec une attestation «sans-abri»… Fondamentalement, cette crise a rendu visible une série d’inégalités qu’il était commode de ne pas regarder. C’est notamment le cas des inégalités dans l’enseignement: à partir du moment où les enfants sont confinés et doivent suivre l’école à la maison, ces inégalités deviennent criantes, puisque tous les parents ne sont pas en télétravail et que tous ne peuvent pas suivre cette scolarité, sans parler de la fracture numérique. Je pense aussi au fait que le personnel soignant des maisons de repos a été complètement livré à lui-même. Je trouve ça d’une violence hallucinante. On n’a pas été foutu de protéger ce personnel, de garantir le fait que les ambulances arrivent à temps pour transférer les personnes âgées. Le rapport d’Amnesty International sur les maisons de repos (publié en novembre 2020, NDLR) a quand même été une grosse claque. Ce sont des choses qui existaient déjà mais il n’y avait pas grand monde qui s’y intéressait… (Lire aussi «Maisons de repos, maisons de chaos», AÉ 484, mai 2020).
AÉ: Il y a eu des choses positives selon vous?
P-AP: Pour ce qui est des détenus et des personnes en centres fermés, on a pu voir qu’il y avait moyen d’en libérer et que le monde continuait de tourner: la Belgique n’a pas soudainement été envahie par des hordes de migrants, le taux de criminalité n’a pas explosé. Quand on veut, on peut…
AÉ: Mais ces mesures sont restées de courte durée…
P-AP: Oui, là on est revenu au business as usual. On reparle de masterplan et de nouvelles places en centres fermés. Je ne me fais pas beaucoup d’illusions sur le changement de paradigme que la crise aurait permis de réaliser…
AÉ: Pensez-vous malgré tout que nous allons tirer des enseignements de cette crise?
P-AP: Je me réfère à la fameuse phrase de Gramsci… «Il faut allier le pessimisme de l’intelligence à l’optimisme de la volonté». Je ne crois pas une seconde à une sorte d’effet d’entrainement mécanique qui ferait qu’il y aurait une prise de conscience. Je pense que les mauvaises habitudes reviennent aussi vite qu’elles avaient été chassées. C’est à chacun de nous de changer ce qui ne nous convient pas. Ce qui est vrai par contre, c’est que certaines choses vont rester presque malgré nous. Des choses positives ou négatives. Un exemple qui peut paraitre trivial, ce sont les pistes cyclables mises en place de façon temporaire et qui vont rester. Par contre, il y a peut-être des lignes qui vont bouger par rapport à l’habituation à un couvre-feu ou au partage de données avec la police au nom de la sécurité sanitaire. Cela me parait plus dangereux parce qu’on met en place des dispositifs qui pourraient être réactivés très vite.
«Ce n’est pas pour faire plaisir aux juristes, ni pour faire du droit pour faire du droit, mais bien parce que cela a un sens dans une démocratie.»
AÉ: C’est compliqué pour une structure comme la vôtre de défendre les libertés individuelles et collectives dans un contexte comme celui d’une crise sanitaire?
P-AP: Oui, bien sûr. On marche un peu sur des oeufs. La décision prise il y a quelques jours par le tribunal est un bon exemple. On a reçu beaucoup de messages de félicitations mais aussi beaucoup d’insultes de gens qui nous traitent d’assassins et qui ne comprennent pas la démarche. À nous d’expliquer que nous ne sommes vraiment pas contre les mesures, mais qu’il y a un cadre à respecter. Ce n’est pas pour faire plaisir aux juristes, ni pour faire du droit pour faire du droit, mais bien parce que cela a un sens dans une démocratie. C’est notre rôle de demander que des balises soient mises et que le gouvernement reste encadré par l’État de droit, par la constitution, par des convention de protection des droits fondamentaux, et que ces balises sont là pour le bien de tout le monde. Donc oui, c’est compliqué à faire passer comme message. Mais c’est à nous de le faire. Et aux médias…