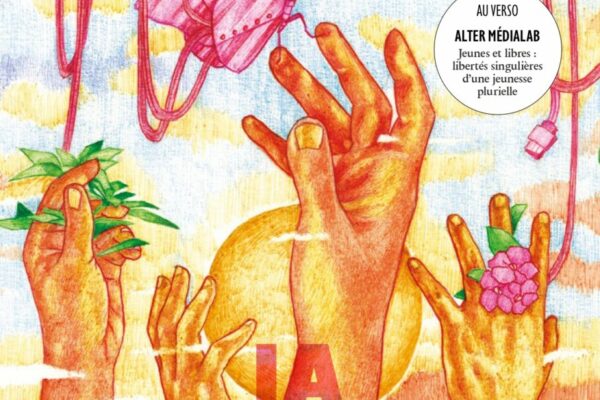Le face-à-face n’est pas neuf et suscite des prises de position enflammées: il oppose les partisans d’une prostitution réglementée, avec la création d’un statut professionnel, à ceux qui militent pour l’abolition de la prostitution1, au motif que les personnes prostituées sont les victimes d’un système de dominations de genre et économiques. Si, au lieu de tenter de prendre position, on reconnaissait que la solution unique n’existait pas? Et que c’est l’ensemble des politiques publiques qui doit être interrogé? Interview de Renaud Maes, sociologue (ULB, Université Saint-Louis).
Alter Échos: Métier librement choisi ou contrainte imposée: la notion de choix est-elle pertinente?
Renaud Maes: Cette question n’a pas vraiment d’intérêt, parce que l’on se retrouve avec deux fictions qui s’opposent: la fiction de la victime absolue et celle de l’entrepreneur libéral. Les personnes qui se prostituent ne sont ni l’une ni l’autre. Selon moi, la marge de liberté individuelle dans le choix de n’importe quelle profession est extrêmement faible puisqu’il y a toujours énormément de déterminants sociaux et économiques à l’œuvre. Est-ce mieux de se prostituer ou d’être caissière au Carrefour? C’est une question entendue 3.000 fois et qui a peu de sens puisqu’il serait mieux de ne faire ni l’un ni l’autre. Ce qui est un peu désagréable dans la manière dont certains abolitionnistes définissent cette question de choix, c’est que les personnes qui se prostituent sont vues comme de pauvres victimes passives, sans aucune prise sur leur situation. Je pense que c’est une erreur. Des mécanismes actifs de résistance et de solidarité existent chez ces personnes, même dans des situations particulièrement difficiles.
AÉ: La frontière entre traite et prostitution «choisie» ne semble elle-même pas évidente…
RM: C’est vrai. Je comprends qu’il y ait besoin de critères clairs pour légiférer, mais je pense qu’on a aussi tendance, parfois, à minimiser les violences subies par des personnes qui sont dans des situations qui ne sont pas considérées comme de la traite, mais où l’on retrouve des formes de coercition, physiques ou psychologiques, que ce soit par un conjoint ou un parent… Le fait de venir à Bruxelles pour se prostituer parce que cela permet à toute une famille de vivre en Roumanie est un choix positif, mais c’est aussi un choix par défaut. Cela peut être organisé par la famille, sans être un réseau de prostitution au sens classique, avec une forme de contrainte et des mécanismes de domination, mais aussi un réseau d’entraide à partir de cette activité. C’est un exemple de situation très difficile à appréhender à l’aune des grandes catégories habituelles.
AÉ: Faut-il aujourd’hui essayer de faire se rencontrer les points de vue entre réglementaristes et abolitionnistes?
RM: Ce clivage idéologique est déconnecté du réel. C’est un positionnement hyper moral, que l’on retrouve dans les deux clans. On se pose toujours la question a priori en vue de trouver une solution générale à LA prostitution. C’est une erreur fondamentale. Il existe une multiplicité de situations. Il faut partir du concret et du quotidien des personnes qui vivent la chose. À partir de là, on peut renoncer à un principe unique de régulation puisque l’on sait qu’aucun ne fonctionne. Il faut aller voir comment cela se passe dans les pays concernés et regarder, concrètement, ce que signifie la mise en place d’un plan abolitionniste ou d’un plan réglementariste. Dans un cas comme dans l’autre, les améliorations que certains en retirent se font au détriment des autres. Il n’y a pas de solution magique.
AÉ: Les hommes prennent-ils aussi part à ce débat, que ce soient les clients, les hommes qui se prostituent ou les hommes en général?
RM: On entend beaucoup les hommes en réalité. Pas tellement les clients: peu d’entre eux osent témoigner. Ce qui n’empêche pas que certaines personnes qui prennent part au débat avec une autre casquette soient clients par ailleurs. Dans les parlements, les hommes sont généralement plutôt réglementaristes. Il y a assez peu d’hommes abolitionnistes. Quant aux hommes prostitués, on les entend aussi. Ils sont même surreprésentés par rapport à ce qu’ils représentent statistiquement, parce que c’est souvent plus facile pour eux de témoigner.
AÉ: Pourquoi?
RM: Pour caricaturer, ils sont en général dans des situations plus faciles. La prostitution masculine dans des situations d’extrême précarité est plus marginale, les hommes génèrent souvent plus de revenus en raison d’une moindre concurrence. Ils bénéficient d’un cadre de vie plus supportable et de davantage de temps qu’ils peuvent consacrer, notamment à la militance. Même dans une association comme Utsopi (Union des travailleur·se·s du sexe organisé.e.s pour l’indépendance), où ils essayent de garantir une représentation assez équilibrée, le coordinateur est un homme. Ces unions de personnes prostituées sont plutôt réglementaristes, car, homme ou femme, pour s’engager, il faut en avoir les moyens. Les situations de prostitution plus dures, de rue ou sous contraintes, ne sont pas vraiment représentées. Il ne faut donc pas nier la représentativité de ces associations, mais celle-ci concerne une partie de l’activité pour laquelle la réglementation pourrait être une piste de solution, sans régler pour autant la situation d’autres personnes.
AÉ: Sur le plan politique, la gauche semble très divisée sur la question…
RM: La gauche est complètement fracturée. Elle a un pendant réglementariste, surtout du côté des gens qui ont, à un moment ou à un autre, travaillé sur les questions de réduction des risques liés à la consommation de drogues, qu’ils transposent à la prostitution. C’est un courant très fort au sein du PS mais aussi d’Écolo. On a aussi au sein de la gauche beaucoup de féministes deuxième vague, issues d’un féminisme matérialiste et radical, qui sont plutôt dans une optique néo-abolitionniste. Il y a donc un affrontement clair au sein de la gauche. Mais c’est le cas aussi au sein de la droite. Cette fracture transcende les frontières politiques.
AÉ: Le politique s’intéresse-t-il à autre chose qu’à la prostitution visible et potentiellement «nuisible»?
RM: L’intérêt pour la condition des personnes prostituées est toujours le cache-sexe d’une politique qui n’a rien à voir. La première source d’intérêt de la part d’une grande majorité de politiques, notamment sur le plan local, c’est de minimiser les nuisances de voisinage et d’augmenter la valeur immobilière ou touristique d’un quartier. C’est une politique de gestion de territoire. C’est assez explicite d’ailleurs. Certains bourgmestres se disent abolitionnistes, mais en fait, ce qu’ils organisent, c’est un flicage, un harcèlement policier des personnes prostituées, sans leur ouvrir la possibilité d’accéder au revenu d’intégration sociale: des femmes se font renvoyer des CPAS où on leur dit: «Vous avez un revenu puisque vous vous prostituez.»
De la même manière, beaucoup se disent réglementaristes quand ils sont en fait dans une optique que j’appelle concentrationnaire, c’est-à-dire qu’ils souhaitent isoler le phénomène afin, encore une fois, de minimiser les «nuisances». Ce type de dispositif est caractérisé par un empilement de cellules, un environnement aseptisé et ultra-fonctionnel, qui est tout sauf agréable à vivre et où les femmes ont l’impression d’être à l’abattoir. Toutes ces politiques ont pour conséquence de rendre la prostitution moins visible, ce qui, du point de vue des personnes, est une catastrophe.
AÉ: À l’échelon bruxellois, les 19 communes ont du mal à s’accorder. La déclaration gouvernementale de la Région promet une coordination. Est-ce possible?
RM: Il n’y a pas de volonté politique à l’heure actuelle. À chaque législature, on fait la même chose. On commandite une étude qui aboutit toujours pratiquement aux mêmes conclusions: il faut arrêter de vouloir implémenter un modèle clef sur porte, il faut mettre autour de la table l’ensemble des acteurs, il faut forcer les bourgmestres à se coordonner… Mais cela ne se fait pas. Le poids des bourgmestres est tel qu’il suffit que l’un d’entre eux dise «Je n’ai pas envie», et cela s’arrête là. On se retrouve dans des situations complètement absurdes: les règlements communaux varient d’une commune à l’autre et les policiers d’une même zone de police se retrouvent avec des injonctions différentes d’une rue à l’autre.
AÉ: On parle souvent des «nouvelles formes de prostitution». Quelles sont-elles et quelle est leur cause?
RM: Ces «nouvelles formes de prostitution» sont en fait extrêmement vieilles. Leur apparition est cyclique et récurrente dans le temps, comme c’est le cas de la prostitution étudiante. À chaque vague de massification de l’accès à l’enseignement supérieur, une prostitution se développe parce que, qui dit massification dit des publics plus précaires qui doivent assumer les frais de leurs études. Ce qui explique l’explosion de la prostitution étudiante, avérée dans certains pays, supposée en Belgique, c’est moins la facilité d’accès des sites internet qu’un phénomène de précarisation important d’une frange de la population étudiante. Quand on précarise des gens, et singulièrement les femmes, on renforce les contingents de personnes qui se prostituent… Et cela, c’est un constat sur lequel tout le monde est d’accord.
AÉ: Mais c’est un constat sur lequel il est plus difficile d’agir…
RM: Oui, et finalement, croire que s’attaquer à la question prostitutionnelle est la solution, c’est soit naïf, soit volontairement stupide. C’est évident que c’est tout le champ des politiques publiques – économiques, migratoires, d’égalité hommes-femmes, d’accès aux études supérieures, à l’emploi… – qui est à interroger. Dans le débat entre néo-abolitionnistes et réglementaristes, on est arrivé à un tel niveau d’absurdité… mais qui arrange tout le monde parce que cela évite de se poser la question, autrement plus fondamentale, du lien entre ces situations et les politiques publiques. Une femme avec deux gosses, si on lui dit «C’est fini le CPAS pendant deux mois, vous êtes suspendue parce que vous n’avez pas respecté le contrat du PIIS», qu’est-ce qu’elle fait? Tout de suite, cela blesse plus, parce que tous les partis sont cogestionnaires des CPAS… Et à l’heure actuelle, dans un contexte de détricotage des acquis sociaux, cela ne risque pas de s’améliorer…
(1) L’abolitionnisme revendique la disparition de la prostitution mais s’oppose à la pénalisation des personnes qui se prostituent. Il ne doit pas être confondu avec le prohibitionnisme, qui postule que la prostitution est immorale et doit être interdite et pénalisée.