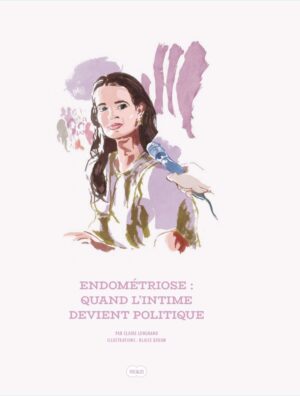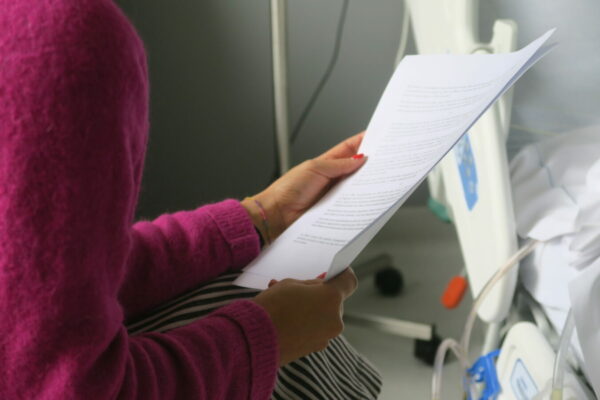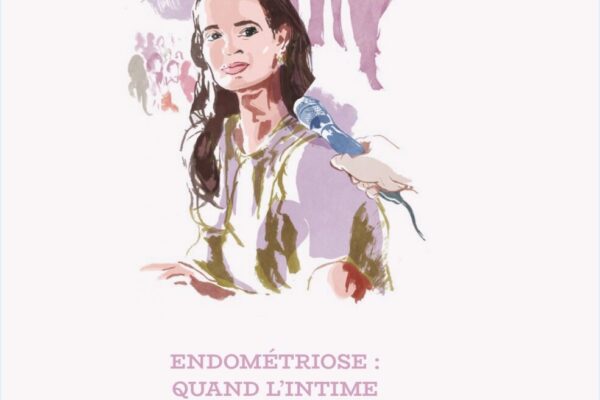BOZAR, 30 avril, 12 h 30. En cette journée ensoleillée, le musée semble déserté au profit des parcs et terrasses. Des conditions idéales pour découvrir au calme l’exposition When We See Us, un siècle de peinture figurative panafricaine. Comme vont en faire l’expérience Anthony, Christelle, Florence, Ben, Adam et Victoria, qui ont rendez-vous pour une visite organisée dans le cadre de leur prise en charge à l’hôpital psychiatrique de jour Paul Sivadon du CHU Brugmann. Une sortie rendue possible par le projet de prescriptions muséales lancé en 2022 par Delphine Houba, alors échevine de la culture à la Ville de Bruxelles, en partenariat avec l’hôpital Brugmann et cinq musées de la capitale. Élargi en 2024 à 18 services de soins et 14 lieux culturels, il permet à une série de patients de bénéficier, en groupe ou individuellement, de visites culturelles gratuites susceptibles d’avoir un effet positif sur leur santé. De fait, dans un rapport publié en 2019 et étayé depuis par diverses études, l’Organisation mondiale de la santé a confirmé ce que l’on soupçonnait depuis la nuit des temps ou presque (Apollon n’était-il pas à la fois le dieu des arts et de la guérison?): l’art peut être bénéfique pour la santé, tant physique que mentale, et ce, tout au long de la vie!
«À Brugmann, nous sommes convaincus de l’importance et des bienfaits de l’art et de la culture dans le processus de rétablissement des patients», déclarent la psychiatre Muriel Candelas et le psychologue Christophe Milecan, qui accompagnent cette sortie à BOZAR. «Pas seulement les ateliers à médiation artistique pratiqués à l’hôpital de jour, mais aussi le fait de se rendre dans des musées. Au contact de l’art, les patients expriment des pensées ou des émotions auxquelles ils n’auraient pas eu accès autrement. Ils recréent du lien avec eux-mêmes et les autres. Se mobiliser pour une sortie en groupe et surmonter les aspects organisationnels constituent aussi un plus pour ces personnes souvent désinsérées et isolées socialement.» Tout comme se confronter au monde extérieur et au regard des autres. D’autant que franchir la porte d’un musée peut représenter une épreuve pour les publics fragilisés. «Notre groupe comptait, initialement, le double de participants, poursuivent les soignants. Tous n’ont pas osé. Ceux qui y sont parvenus devraient voir leur estime d’eux-mêmes et leur confiance en eux renforcées. Et on espère que ça leur donnera envie de recommencer.»
Autonomisation et empouvoirement des patients
Si certains participants semblent intimidés face aux questions de la guide, d’autres, en revanche, rebondissent sur ses commentaires, discutent des techniques employées, font référence à d’autres œuvres ou artistes qu’ils connaissent. Afin d’éviter toute stigmatisation, durant la visite, aucune allusion ne sera faite à des troubles de santé mentale ou à une prise en charge thérapeutique. On notera juste, en plus des explications sur les œuvres observées, une grande attention accordée aux émotions que véhiculent les peintures. «C’est chouette, ça change de la routine», commente Florence, qui se réjouit «de partager ce moment», elle qui d’habitude arpente les expos en solo. «Cette activité vise à renforcer la cohésion du groupe», enchaînent Christelle et Anthony. «C’est une occasion de nous rapprocher dans un contexte différent de l’hôpital et d’entretenir d’autres formes de relations avec les psys.» Et d’en tirer un bienfait pour la santé? «Je ne vois pas de lien entre cette expo et ma thérapie, confie Anthony. Mais je manque sans doute de recul pour en mesurer les effets.»
Dans un rapport publié en 2019 et étayé depuis par diverses études, l’Organisation mondiale de la santé a confirmé que l’art peut être bénéfique pour la santé, tant physique que mentale.
Durant près d’une heure et demie, les participants vont se concentrer sur les œuvres d’art, la variété de styles présentés, les harmonies de couleurs, les messages suggérés… Loin du bruit du monde, entourés de beauté, ils vont prendre le temps de se connecter à leurs ressentis. Une pause précieuse, si l’on se réfère aux résultats de l’enquête qualitative menée par Catherine Hanak, cheffe de clinique du service de psychiatrie du CHU Brugmann, prescriptrice de visites muséales lors de ses consultations individuelles, qui collabore au projet pilote depuis son lancement. «Lorsque je recueille leurs feed-back, mes patients me confient généralement avoir été émerveillés, de bonne humeur, contents pendant la visite et même après, quand ils y repensaient. Et ce, même si certaines peuvent se révéler plus confrontantes que d’autres…» Vu les objectifs d’autonomisation et d’empouvoirement visés par ces sorties au musée, la psychiatre n’influence pas le choix d’expo. Aux patients de décider! D’autant que l’art permet de garder une distance avec les éventuelles émotions négatives suscitées.
Autres points positifs observés par le docteur Hanak: ces visites muséales donnent aux artistes et aux participants à des activités médiées par l’art, le courage et l’envie de continuer. Elles améliorent également l’alliance thérapeutique. «Entre autres parce que la manière dont les patients abordent cette activité culturelle peut se révéler instructive pour les soignants. Les gens que l’on reçoit en consultation ne vont pas bien: ils souffrent de problématiques d’humeur, de traumas, d’addiction. On passe énormément de temps à les inciter à reprendre des activités. Leur remettre une prescription muséale, c’est concret et plus puissant qu’une entrée gratuite. Sans cela, beaucoup ne franchiraient pas le cap.»
Des musées accessibles et inclusifs
Le projet de prescriptions muséales se termine en juin. En l’absence de gouvernement bruxellois, difficile de savoir s’il va être reconduit, même si les autorités en charge de la culture affirment vouloir le poursuivre. Le sujet a le vent en poupe! Une résolution sur le caring museum, adoptée par le Sénat en 2024, demande au gouvernement fédéral de lancer des pistes de réflexion pour, notamment, «sensibiliser le public au potentiel bénéfique de l’art pour la santé et favoriser l’offre de prescriptions à caractère culturel (muséales) en complément d’un traitement». Véronique van Cutsem, membre du Comité belge de l’ICOM, le Conseil international des musées, voit cette reconnaissance du travail social et sociétal fourni par les musées comme une étape importante: «Maintenant que les politiques sont conscients des enjeux du caring museum, il faudrait que des moyens puissent être dégagés afin de poursuivre la sensibilisation du milieu de la santé, accompagner la mise en réseau d’acteurs issus des secteurs muséaux et médicaux, encourager la recherche et les évaluations des pratiques, soutenir le développement de programmes.» Mais selon elle, cette résolution n’a pas encore eu cet effet de levier.
Les musées continuent néanmoins à se montrer très intéressés par le care, réceptifs aux formations et conférences organisées autour de cette thématique et proposent activement des initiatives en ce sens. Il suffit de consulter leurs agendas pour s’en apercevoir: visites sensorielles, à faibles stimuli, slow, en pleine conscience… fleurissent à Bruxelles et en Wallonie. «La tendance au wellbeing et au caring museum, très présente outre-Atlantique et en Asie depuis des années, est en train d’exploser chez nous, suite à la crise Covid qui a démontré le rôle essentiel joué par la culture auprès des citoyens en termes de santé mentale», décrypte Aurélie Cerf, responsable des publics et activités au Musée BELvue, le musée de la Belgique et de son histoire. C’est aussi un centre pour la démocratie, un lieu où vivre l’histoire et la démocratie.
Le projet de prescriptions muséales se termine en juin. En l’absence de gouvernement bruxellois, difficile de savoir s’il va être reconduit, même si les autorités en charge de la culture affirment vouloir le poursuivre.
De plus, être un musée accessible et inclusif, qui encourage la diversité et la durabilité, conformément à la définition de l’ICOM, implique d’accueillir tous les publics en répondant le mieux possible à leurs besoins spécifiques. «C’est pourquoi nous avons cocréé, avec des médiateurs spécialisés, des visites médiées à destination des personnes en revalidation après un burn-out, en rémission d’un cancer, qui luttent contre des addictions, qui rencontrent des problèmes relevant de la psychiatrie ou qui souffrent de maladies neurodégénératives.» Une offre qui n’est pas seulement réservée aux partenaires du projet de prescriptions muséales puisqu’elle s’adresse à toutes les structures médicales.
Une activité adjuvante au reste de la thérapie
Chaque premier mercredi matin du mois, le BELvue propose aussi des moments à faibles stimuli visuels et sonores. «L’entrée est gratuite et nous limitons l’affluence afin de créer un environnement ressourçant qu’apprécient particulièrement les profils neurodivergents ainsi que les seniors, reprend Aurélie Cerf. Nous nous sommes également lancés dans les relax & slow visites: une activité expérientielle permettant de (re)découvrir notre expo permanente au rythme de résonances (sonores, olfactives, etc.) contribuant au bien-être.» Au Musée de la Photo, à Charleroi, des visites sensibles sont régulièrement délivrées à des groupes de personnes atteintes de maladies neurodégénératives (de type Alzheimer). Mi-avril, America Parra Smart, la responsable du service de médiation y avait rendez-vous avec six pensionnaires d’une maison de retraite, toutes atteintes de troubles cognitifs modérés. En leur présentant une sélection d’œuvres réparties dans les différents espaces muséaux, elle les a embarquées dans un voyage mêlant images, récits, chants, musiques. Durant ces moments d’échanges, ancrés dans le présent, des rires ont fusé, quelques larmes ont aussi coulé… face au trop-plein d’émotions.
Être un musée accessible et inclusif, qui encourage la diversité et la durabilité, conformément à la définition du Conseil international des musées (ICOM), implique d’accueillir tous les publics en répondant le mieux possible à leurs besoins spécifiques.
«Les visites sensibles ne s’adressent pas à tout le monde, remarque America Parra Smart. Les personnes doivent être en mesure d’apprécier cette bulle d’oxygène offerte par l’art dans un lieu qui cultive le bien-être. Parce qu’elles sont réceptives à la culture. Et parce que leur état de santé le leur permet; ce qui ne sera pas le cas si leur dépression se révèle trop sévère ou leur stade de démence, avancé. Parfois, ce sont les aidants qui ont le plus besoin de cette respiration.» Partager un moment de qualité, dans un lieu culturel, offre au patient et à ses proches une échappée d’un quotidien impacté par la maladie. Le bénéfice que cela apporte n’est pas feint ni négligeable. «Contempler des œuvres d’art, marcher et partager une activité procurent du bien-être, à la suite de la libération de dopamine, précise le docteur Hanak. Parfois, ce que les personnes vivent dans les musées modifie leur signification du sens de la vie et leur santé psychique. Elles retrouvent l’espoir et se montrent plus optimistes quant à leur situation. La muséothérapie est clairement une activité qui facilite, complète, voire renforce la prise en charge thérapeutique, sans effets secondaires négatifs. Donc, à consommer sans modération!»