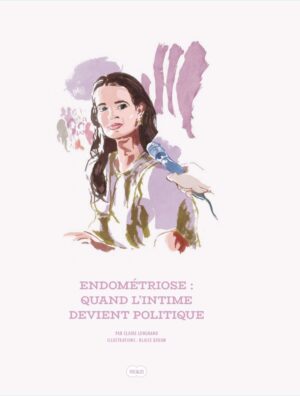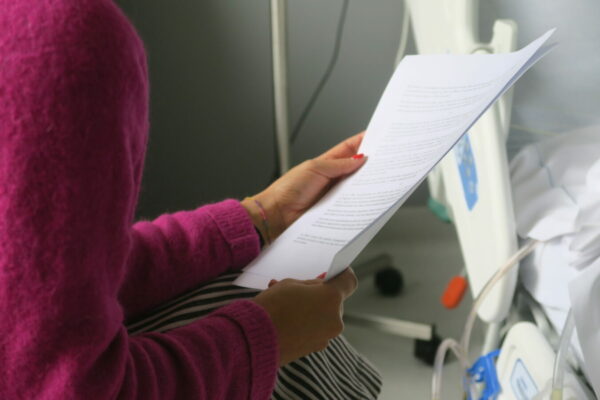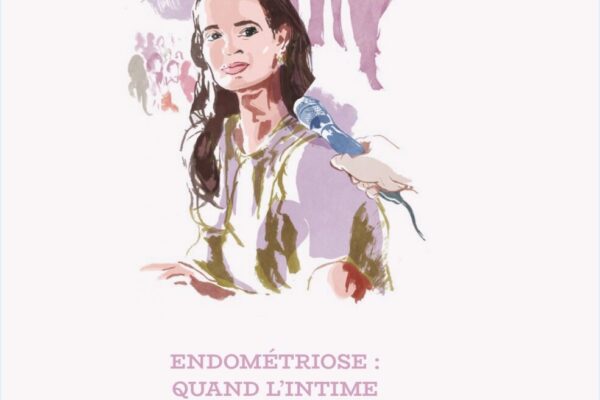Alter Échos: Comment est née cette étude-action à laquelle vous avez toutes deux participé?
Louise Paquot: L’étude s’est imposée à l’été 2023, dans un contexte de forte médiatisation des violences, notamment autour de la gare du Midi à Bruxelles. Les institutions étaient sous pression, parfois sommées de gérer des situations jugées inacceptables, mais elles étaient convaincues que la réponse sécuritaire ne conviendrait pas. Face à la montée des tensions, plusieurs acteurs du secteur se sont réunis pour réfléchir à d’autres alternatives et ont lancé une recherche-action à Bruxelles, soutenue par la Cocof. Un projet de plus petite ampleur a également été mené en Wallonie.
Christine Vanhessen: Tout à fait. En Wallonie aussi, la situation était tendue. Plusieurs services ont dû fermer temporairement face à des faits de violence, ce qui a poussé les équipes à faire une pause pour rebondir. Nous avons mené une enquête plus modeste qu’à Bruxelles, mais qui a permis de comparer les réalités des deux régions. Ce qui frappe, c’est la simultanéité des difficultés, signe d’une crise structurelle du secteur.
Alter Échos: Quels sont les principaux résultats de l’étude concernant les formes et la fréquence des violences?
L.P.: La violence fait partie du quotidien des travailleurs. À Bruxelles, plus de 95% des professionnels interrogés ont déjà été confrontés à une ou plusieurs formes de violence dans leur travail. Les violences verbales sont les plus courantes: 82,7% des travailleurs en ont été victimes de la part d’usagers, et 88% en ont été témoins entre usagers. Les violences physiques sont moins fréquentes, mais restent marquantes: 37,2% des professionnels en ont été victimes, 69,6% en ont été témoins. Les violences psychologiques touchent 43,5% des travailleurs, et elles sont souvent plus insidieuses et difficiles à identifier. Les violences sexuelles, enfin, sont moins signalées mais particulièrement déstabilisantes: 9,9% des professionnels en ont été victimes, 14,7% en ont été témoins. Il faut préciser que ces chiffres reflètent la perception des travailleurs, car il n’a pas été possible d’interroger directement les usagers dans le temps imparti. Or, eux aussi sont parfois victimes de violences institutionnelles ou interpersonnelles. Ce qui ressort, c’est que la violence prend racine dans des situations d’exclusion sociale et de non-accès aux droits fondamentaux, qui se durcissent avec le temps.
L’étude s’est imposée à l’été 2023, dans un contexte de forte médiatisation des violences, notamment autour de la gare du Midi à Bruxelles. Les institutions étaient sous pression, parfois sommées de gérer des situations jugées inacceptables, mais elles étaient convaincues que la réponse sécuritaire ne conviendrait pas.
Alter Échos: Quels sont les impacts de cette violence sur les équipes et la relation avec les usagers?
L.P.: L’impact est multiple. D’abord, il y a des arrêts de service ponctuels pour gérer des faits de violence, ce qui use les équipes à la longue. Les violences physiques sont les plus déstabilisantes, pouvant entraîner des fermetures de service ou des exclusions temporaires. Les violences verbales, bien que moins graves, génèrent une charge émotionnelle importante et un risque d’habituation. Les violences psychologiques, souvent invisibles, ont des effets cumulatifs sur la santé mentale des équipes. Un professionnel sur cinq a déjà dû s’arrêter pour raison médicale à la suite de violences subies dans son travail. Fatigue, usure, sentiment d’insécurité et perte de motivation sont fréquents, aggravés par le manque de moyens et la surcharge de travail. Les institutions se retrouvent dans une impasse: protéger les travailleurs, c’est risquer d’exclure des usagers et d’alimenter la spirale de la violence et de la stigmatisation; protéger les usagers, c’est parfois exposer davantage les équipes. Ce dilemme est accentué par des réponses politiques souvent axées sur la sécurité, qui ne règlent rien sur le fond et peuvent même aggraver le sentiment d’exclusion des publics les plus fragiles.
À Bruxelles, plus de 95% des professionnels interrogés ont déjà été confrontés à une ou plusieurs formes de violence dans leur travail. Les violences verbales sont les plus courantes: 82,7% des travailleurs en ont été victimes de la part d’usagers, et 88% en ont été témoins entre usagers.
Alter Échos: Quelles pistes d’amélioration émergent de l’étude?
C.V.: L’étude a permis de mettre en lumière l’existence de dispositifs internes, comme la supervision, la formation ou des espaces de parole pour les équipes. Mais il reste beaucoup à faire, notamment pour renforcer les effectifs et les compétences. Le secteur ne part pas de rien, mais il manque cruellement de moyens pour garantir un environnement de travail sécurisé et un accompagnement de qualité. Au-delà de l’action au sein des équipes, il y a un enjeu politique majeur. Le secteur a bénéficié d’investissements inédits ces dernières années, mais la société va de plus en plus mal et les besoins explosent.
L.P.: En ce qui concerne la formation, il est évidemment idéal que les travailleurs soient formés à la gestion des situations de tension, tout comme à d’autres sujets qui touchent une partie des publics accompagnés (santé mentale, assuétudes ou autre). Tout d’abord, parce que les travailleurs restent parfois réellement impuissants face à un passage à l’acte, malgré ces formations. Ensuite, parce que le plus souvent, les faits de violence sont générés par l’accumulation de violences beaucoup plus insidieuses qui précèdent le passage à l’acte. Il est donc essentiel d’apporter des changements systémiques sur tout ce qui pousse et renforce l’extrême précarité, et non de renvoyer l’idée selon laquelle ce qui touche aux violences «visibles», de la part des usagers, puisse se résoudre dans les services. Certains travailleurs pensent d’ailleurs que s’agissant de leur formation, il serait d’abord pertinent de les informer et les sensibiliser au contexte (politique, social et économique) qui définit leur travail et leurs missions, de manière à développer une posture d’alliance plus forte avec les usagers et de les accompagner en cohérence avec les réalités structurelles auxquelles ces derniers se heurtent quotidiennement. Ces points font aussi l’objet de recommandations dans l’étude.
Mais il reste beaucoup à faire, notamment pour renforcer les effectifs et les compétences. Le secteur ne part pas de rien, mais il manque cruellement de moyens pour garantir un environnement de travail sécurisé et un accompagnement de qualité.
Alter Échos: Le contexte est-il plus explosif aujourd’hui qu’hier?
C.V.: Oui, le contexte est potentiellement explosif. Les politiques de réduction des coûts et la logique d’activation poussent la précarisation à l’extrême, aussi bien des publics que des travailleurs. Les risques sont réels de voir arriver dans le secteur un public qui, jusqu’ici, était épargné par la grande précarité, notamment à cause de la limitation des allocations de chômage. Si les moyens ne suivent pas, le secteur risque d’être submergé sans pouvoir garantir un accompagnement digne. Cela pose la question de la place du travail social dans une société qui se sécurise et se droitise. Il est essentiel de sanctuariser le travail social, de préserver sa mission d’accompagnement, et de lutter contre la banalisation de la violence sous toutes ses formes. Si on ne peut pas garantir un lieu de travail sécurisant, comment accueillir les plus vulnérables dans de bonnes conditions? Il est urgent de repenser les politiques publiques pour éviter que la spirale de l’exclusion et de la violence ne devienne la norme.