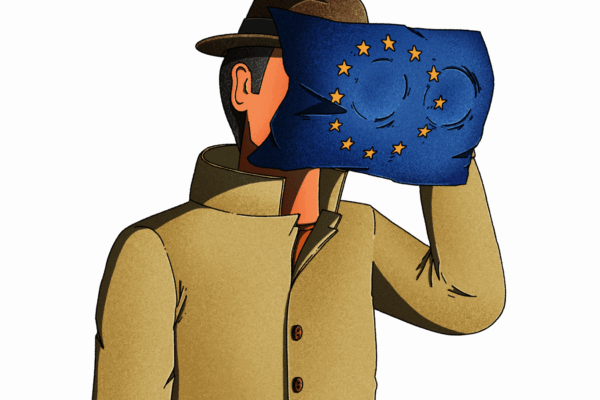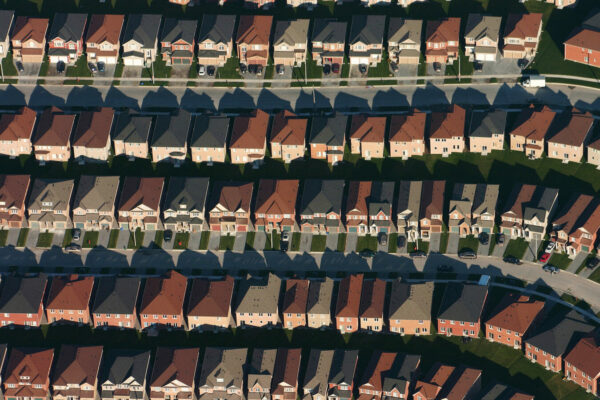David Ledelay gare son monospace allemand dans l’allée d’un quartier résidentiel de banlieue parisienne. «C’est mon cinquième: avec mon fils, je roule jusqu’à 40.000 kilomètres par an», soupire-t-il. Dans le salon, les photos d’un jeune homme souriant jouxtent quelques paquets de langes grande taille. Face au jardin, David Ledelay se fend d’un sourire. «On a installé un trampoline et de l’herbe synthétique pour Louis. Il aime bien marcher pieds nus, c’est quand même plus agréable que le ciment.»
Louis est la priorité absolue de son père. Né en 2009, il convulse dès son troisième jour et multiplie les crises d’épilepsie. «On ne pensait pas au handicap. On a suivi beaucoup d’examens avant qu’un traitement ne soit défini», se remémore David Ledelay. Le diagnostic est posé en 2011: «Louis est épileptique et autiste. On nous a expliqué que la maternelle, ce ne serait pas possible. Nous ne pouvions pas le laisser sans surveillance.»
«De la colère vis-à-vis de la France»
Commence alors un long parcours du combattant pour les parents du jeune Louis. Face au monde médical et à l’administration française, «la bonne volonté et les neurones ne suffisent pas toujours». Orienté de spécialiste en spécialiste, Louis ne voit aucune place disponible pour l’accueillir en Institut médico-éducatif (IME). Les Ledelay sont relégués en liste d’attente et les établissements proposés par la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) ne correspondent pas toujours aux besoins de Louis. «Tous les IME ne prennent pas en charge les mêmes handicaps. Je ne compte pas le nombre de dossiers ou de rendez-vous pour rien», peste le père.
Un centre d’accueil médico-social évoque la Belgique aux parents. Le contact est pris avec l’Association pour les Français en situation de handicap en Belgique (AFrESHEB) pour connaître les établissements et leurs spécialités. Un rendez-vous est obtenu en novembre 2013 à Lessines, dans la province de Hainaut, dans un institut proposant école et internat pour enfants en situation de handicap. «C’était le tapis rouge, on nous a fait la visite pendant deux heures. Par rapport aux établissements en région parisienne, ça n’avait rien à voir.» Et surprise: alors que le centre affichait complet lors de la prise de contact, une place est libre le jour J. «On était emballés, on a foncé», s’enthousiasme David Ledelay.
Un centre d’accueil médico-social évoque la Belgique aux parents. Le contact est pris avec l’Association pour les Français en situation de handicap en Belgique (AFrESHEB) pour connaître les établissements et leurs spécialités. Un rendez-vous est obtenu en novembre 2013 à Lessines, dans la province de Hainaut, dans un institut proposant école et internat pour enfants en situation de handicap.
Le dossier est accepté par la maison départementale des personnes handicapées. Louis a 4 ans et demi lorsqu’il passe la frontière. «La première fois, c’était un déchirement et de la colère vis-à-vis de la France. Aujourd’hui, c’est de l’amertume. On est désabusés.» Depuis, le parcours n’est pas resté un long fleuve tranquille. Le transport, au départ remboursé par la Sécurité sociale et pris en charge par une société, a été interrompu en 2016 et assumé par la famille, puis de nouveau pris en charge. Louis reste en Belgique une à deux semaines, puis revient pour le week-end. Depuis deux ans, la famille parvient à partir en vacances: «Nous avons trouvé un lieu, en Vendée, où des éducatrices prennent en charge Louis quelques heures par jour. On souffle un peu, parce qu’on peut vite s’enfermer dans le handicap. Cela prend toute la vie.» Adulte, Louis intégrera probablement un centre de jour permanent en Belgique. Ses parents envisagent de déménager de l’autre côté de la frontière. «On aurait préféré du soleil et de la mer, mais bon. C’est Louis avant tout.»
Les raisons du départ
À Brugelette, dans le Hainaut, l’école de Sainte-Gertrude accueille près de 500 enfants dans un enseignement spécialisé. Séverine Sautriaux, directrice de l’Institut secondaire, décrit la pédagogie de l’école: quatre formes d’enseignement, déterminées selon la nature et l’intensité du trouble. Si certaines formes se rapprochent de l’enseignement ordinaire, la première est consacrée aux handicaps les plus lourds.
«Nous accueillons des jeunes avec un retard très important: des autistes avec déficience, des personnes non verbales, dépendantes…», énonce Séverine Sautriaux. Pour ces 92 élèves, le travail se concentre sur la communication, la socialisation et l’autonomie de l’enfant, avec deux professeurs pour un effectif maximal de onze jeunes par groupe. «On fixe des objectifs pour chaque enfant et les professionnels travaillent de concert dans cette direction. Pas à pas, on voit une vraie évolution, des enfants qui apprennent à se laver les dents, qui étaient langés et ne le sont plus…», s’enthousiasme la directrice.
Pour la géographe française Elise Martin, «les départs en Belgique concernent un segment particulier: ce sont les handicaps complexes, poly- ou pluri-handicaps, ou les troubles importants du comportement». Des individus très dépendants, dont la prise en charge en France est souvent décriée par les familles. Isabelle Resplendino, fondatrice et directrice de l’AFrESHEB, en a l’habitude. Motivée par «les énormes progrès» de son fils dans l’enseignement belge spécialisé, elle aide depuis vingt ans les familles françaises touchées par le handicap, notamment dans le contact avec les établissements belges et le parcours administratif permettant la prise en charge financière par les départements et la Sécurité sociale française.
Pour la géographe française Elise Martin, «les départs en Belgique concernent un segment particulier: ce sont les handicaps complexes, poly- ou pluri-handicaps, ou les troubles importants du comportement». Des individus très dépendants, dont la prise en charge en France est souvent décriée par les familles.
Pour elle, la dynamique repose sur deux phénomènes. «D’abord, il y a une cruelle absence de places en France. Certaines régions, comme l’Île-de-France, sont sinistrées, mais j’accompagne aussi des familles corses ou d’outre-mer.» Ensuite, c’est la recherche d’une pédagogie différente. «En France, la prise en charge est très médicalisée. J’ai aidé des enfants assommés de médicaments, attachés avec les mains dans le dos, ou des adultes enfermés dans des unités pour malades difficiles avec des tueurs en série. Mais une autre prise en charge est possible avec des professionnels formés aux bonnes pratiques.» Isabelle Resplendino constate en Belgique une approche du handicap basée sur les possibilités, les besoins et les spécificités de l’individu plutôt que ses déficiences.
Aujourd’hui, ce sont près de 1.500 enfants et 7.500 adultes français qui fréquentent les structures belges. Familles installées à la frontière, à l’autre bout de la France, ou qui ont quitté travail et maison pour déménager en Belgique. La plupart des établissements sont situés dans le Hainaut, proche de la France. «Il y a eu un effet d’opportunité du côté belge, notamment dans d’anciennes régions minières marquées par un taux de chômage élevé, dans lesquelles l’accueil d’étrangers en situation de handicap, et plus globalement le médico-social, apparaît être une source de revenus importante», analyse Elise Martin.
Un moratoire sans solution
Contre ce système, des colères grondent. «Certaines associations estiment que les Français prennent la place des Belges dans les établissements, mais c’est complètement faux. Ce public motive des ouvertures d’établissement, crée de l’emploi et dynamise la région», argue Isabelle Resplendino. Séverine Sautriaux observe une saturation des capacités d’accueil, surtout pour le handicap lourd. Mais pour la directrice, ce sont d’abord les moyens qui manquent: «Les cas d’autisme augmentent chaque année, c’est une population qui existera toujours et qui doit être accueillie convenablement.»
Mais c’est du côté français que la situation est la plus préoccupante. En 2021, un moratoire entre en vigueur pour limiter le nombre de places dans les établissements belges. «200 places annuelles sont libérées pour environ 550 demandes. Que fait-on des 350 restants? S’il y avait suffisamment de places disponibles en France, il n’y aurait pas besoin de moratoire», accuse Isabelle Resplendino, identifiant un «acte de communication politique» plutôt qu’une vraie mesure d’aide au monde du handicap.
Aujourd’hui, ce sont près de 1.500 enfants et 7.500 adultes français qui fréquentent les structures belges. Familles installées à la frontière, à l’autre bout de la France, ou qui ont quitté travail et maison pour déménager en Belgique. La plupart des établissements sont situés dans le Hainaut, proche de la France.
Elise Martin note des solutions insuffisantes proposées aux familles. «Les maisons départementales des personnes handicapées proposent des hébergements temporaires sur demande, mais ce sont quelques jours sur une année», insuffisant donc pour une population exigeant une prise en charge complète. «Un rapport de 2024 de la Cour des comptes montre que les personnes qui auraient pu être concernées par un départ en Belgique ne se voient pas proposer de solution concrète et adaptée en France. Cela relève de la survie.»
Dans de nombreux cas, les adultes sont maintenus dans des établissements pour mineurs en attente d’une place en France, bloquant ainsi l’entrée d’un enfant dans le même institut. «Et quand une place est libérée, la personne est contrainte d’y aller, même si l’établissement n’est pas adapté à son handicap», relève Isabelle Resplendino. «J’ai vu un adulte polyhandicapé rapatrié en France, dans un établissement qui ne pouvait pas le prendre en charge correctement. Au bout de quinze jours sans parvenir à l’alimenter, il a été renvoyé en Belgique et par syndrome de glissement, il est décédé peu de temps après. Chaque année, des gens meurent parce qu’ils sont rapatriés de force, choqués et bouleversés dans leurs repères», déplore Isabelle Resplendino.
Pour les familles, le combat permanent
Pour d’autres familles, la prise en charge à domicile est inévitable. Pour Brigitte, désireuse de rester anonyme, «c’est indécent, c’est une impasse pour des gens qui sont déjà en difficulté: garder au domicile un jeune handicapé, c’est un travail 24 h/24». Brigitte est parvenue à placer son fils en Belgique «un mois avant que le moratoire ne tombe; c’était juste, mais on était dans les clous». Mère célibataire, elle a cumulé pendant dix ans un travail à temps plein et la prise en charge de son fils en dehors de ses journées à l’Institut médico-éducatif. La gestion des rendez-vous auprès des spécialistes ou des auxiliaires de vie lui fait l’effet d’un «mi-temps de secrétariat». Les dernières années l’épuisent: «Il devenait physiquement lourd à lever et habiller, parfois violent, et j’ai vu une régression dans ses capacités: le personnel de l’IME était toxique, et la pédagogie très verticale.»
Après 34 dossiers déposés en Île-de-France, Brigitte a vent de la Belgique via un groupe Facebook. Son fils est intégré à un établissement dans la province de Liège, à 360 kilomètres, une logistique onéreuse et éprouvante, qu’elle assume seule. «J’avais peur, je me demandais s’ils s’occupaient bien de lui, si quelqu’un lui faisait un bisou avant qu’il ne s’endorme. Ce sont des craintes de maman, je pleurais tous les soirs, je ne dormais plus.»
En 2023, l’établissement ferme ses portes. Brigitte l’appréciait pour sa pédagogie familiale et son petit effectif, mais le nouvel établissement belge, «trouvé via mon réseau personnel et dans l’urgence», laisse à désirer. Son fils revient avec des vêtements qui ne sont pas les siens, des médicaments manquants… lorsqu’il a été hospitalisé en urgence, elle n’en a été informée que neuf jours plus tard. «Il y a des choses que je ne peux pas laisser passer. Mais il va bien, il est souriant, ça pourrait être pire.» Aujourd’hui, Brigitte n’est jamais vraiment sereine. «Tout doit être prêt tout le temps, c’est toujours à la famille de rattraper les imprévus et de garder le cap. Notre vie, c’est un combat permanent.»