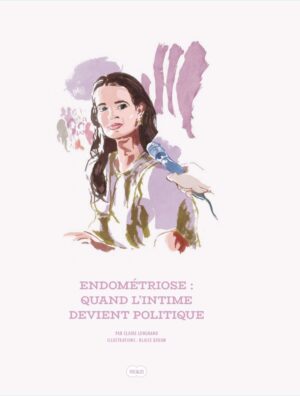Chaque jour depuis le 28 février, ils se rassemblent sur la petite place boisée devant l’hôtel de ville. Chaque jour, microphone en main et ventres creux, les mineurs dénoncent le non-paiement de leurs salaires et le licenciement abusif de 3.620 travailleurs de Georgian Manganese. Dans cette ville mono-industrielle, d’où sont extraites 1,3 million de tonnes de manganèse par an et où une personne sur quatre doit sa survie à une allocation de subsistance, la nouvelle a fait l’effet d’une bombe.
Ce mouvement de protestation n’est pourtant pas nouveau. Il fait suite à une série d’actions qui durent depuis une décennie à l’encontre de l’entreprise privée Georgian Manganese LLC. Cette dernière est détentrice de la licence d’exploitation du manganèse dans la région d’Iméréthie. Elle l’a obtenue à un moment où, dans une frénésie de privatisations portées par le parti libéral Mouvement national uni (dans l’opposition aujourd’hui), plusieurs actifs stratégiques ont été vendus pour des broutilles, l’évaluation de l’impact environnemental des activités minières est passée à la trappe et l’inspection du travail a été abolie.
Une exploitation intensive et dérégulée des ressources
Le 15 mars, une manifestation est organisée au cœur de la ville. Elle rassemble syndicats indépendants, structures de gauche, mouvements étudiants et villageois des alentours. Des travailleurs d’autres régions, eux aussi en lutte, ont également fait le trajet. Le combat des mineurs de Chiatura cristallise le mal-être qui traverse le pays.
Face à une foule de visages cramoisis par le soleil, les mineurs déroulent leurs revendications. Parmi celles-ci figure la création d’un fonds qui reviendra aux habitants de Chiatura. «Sur chaque vente de manganèse, 5% devront être versés au fonds qui permettra de financer l’éducation des générations futures», exige Tariel Mikatsadze, mineur depuis 15 ans et l’un des leaders du mouvement. Il craint la finitude des ressources et le déclin de sa ville. Les problèmes environnementaux causés par l’exploitation débridée des mines (souterraines et à ciel ouvert) s’érigent, quant à eux, en toile de fond. Dans cette ville qualifiée à l’époque de Venise «aérienne», en référence à sa beauté et à ses téléphériques suspendus d’un versant à l’autre des falaises, la rivière Kvirila, noire par endroits, dépasse de 42 fois la concentration admise en manganèse. Sur les hauteurs, dans les villages, il est déconseillé de boire le lait des vaches qui paissent. À Shukruti, un village de presque 300 familles situé à 150 mètres au-dessus d’une des mines, les maisons sont balafrées de larges fissures horizontales. «On a peur de dormir», confie Nargiz Kapanadze, septuagénaire, qui a déjà dû reconstruire deux fois sa maison. Les glissements de terrain rendront bientôt Itkhvisi, le village voisin, inhabitable.
Chaque jour, microphone en main et ventres creux, les mineurs dénoncent le non-paiement de leurs salaires et le licenciement abusif de 3.620 travailleurs de Georgian Manganese. Dans cette ville mono-industrielle, d’où sont extraites 1,3 million de tonnes de manganèse par an et où une personne sur quatre doit sa survie à une allocation de subsistance, la nouvelle a fait l’effet d’une bombe.
Au 25e jour de leur mobilisation, les mineurs de Chiatura ont décidé de descendre à la capitale, Tbilissi, pour manifester, cinq jours durant, devant les établissements de ceux qui régissent le pays: le gouvernement, le service public audiovisuel, la banque nationale et le bureau de la confédération des syndicats de Géorgie (GTUC). Le 24 mars, au pied du siège administratif du gouvernement gardé par un rideau de policiers, les mineurs réitèrent leurs demandes. «La société Georgian Manganese doit quitter la Géorgie et nous pensons que l’État doit prendre la responsabilité du manganèse de Chiatura et gérer cette entreprise avec nous, le personnel technique, la classe ouvrière », insiste Tariel Mikatsadze. Le souhait d’une nationalisation, formulé publiquement depuis 2023, s’inscrit dans une volonté de responsabiliser l’État géorgien.
Quelques semaines plus tard, un contractant de Georgian Manganèse annonce la reprise des activités et diffuse son plan de restructuration; priorité à l’exploitation des mines à ciel ouvert, qui requièrent moins de main-d’œuvre, mais ravagent les sols. Seuls 1.500 employés seront réembauchés. Depuis, une tente s’est dressée face à l’ancien siège de Georgian Manganèse à Chiatura. Elle abrite, entre autres, six mineurs en grève de la faim.
Territoires protégés aux allures de Disneyland
Les villageois de Balda, une bourgade subtropicale de la Mingrélie, découvrent en juillet 2023 qu’un certain périmètre de leur canyon est délimité par des grillages verts. 24.000 m2 du monument naturel, alors sous la protection de l’Agence des Aires protégées (une agence étatique de gestion de l’environnement) ont été «prêtés» à une entreprise, Kanioni 350, pour une durée de 40 ans. La vente aux enchères conditionnelle, remportée par la seule entreprise candidate, prévoit la construction d’infrastructures touristiques et d’une attraction à roulettes longue de 350 mètres sur les flancs du canyon, endéans les trois ans. Seul problème : le projet s’affranchit de certaines obligations et considérations. Les locaux n’ont pas été consultés au préalable ; or, «l’État géorgien a ratifié la convention d’Aarhus sur la participation aux décisions environnementales, l’accès à la justice et l’accès à l’information environnementale», explique Salomé Shubladze, avocate et défenseure des droits humains auprès de l’ONG Social Justice Center, qui estime qu’il s’agit d’une «situation claire de violation de leurs droits». De plus, comme le déplore Sabuko, une ONG de conservation de la nature, aucune étude concernant l’impact potentiel du projet sur la biodiversité n’a été menée; le comble pour un territoire censé jouir d’un statut spécial de protection.
La résistance s’est organisée progressivement. Une vingtaine de jeunes au départ, puis septante familles sur les 300 résidentes. Si la résistance des premiers jours consistait à s’informer et à bétonner leurs arguments face au responsable du canyon au sein de l’Agence des Aires protégées, à l’investisseur et au maire de Martvili (la municipalité où se trouve Balda), elle a rapidement évolué. Constatant le mépris des institutions à leur égard et la détermination aveugle de l’entreprise à construire malgré les objections émises, ils ont entrepris le blocage de la route à tous les véhicules liés de près ou de loin au projet. Dès le 23 octobre 2023, ils ont par ailleurs monté une tente en bord de route, sur la parcelle d’un voisin, d’où ils surveillent, se relayant 24/24 h, les moindres déplacements suspects dans la rue. Depuis lors, pas un seul mètre cube de béton n’a coulé dans la gorge du canyon.
La résistance s’est organisée progressivement. Une vingtaine de jeunes au départ, puis septante familles sur les 300 résidentes. Si la résistance des premiers jours consistait à s’informer et à bétonner leurs arguments face au responsable du canyon au sein de l’Agence des Aires protégées, à l’investisseur et au maire de Martvili (la municipalité où se trouve Balda), elle a rapidement évolué.
«Heureusement que les habitants de Balda sont intelligents, qu’ils ont une véritable conscience écologique et qu’on n’est pas face à des braconniers qui profiteraient des dysfonctionnements de l’Agence des Aires protégées», commente Irakli Macharashvili, directeur de Sabuko. Les activistes ne sont pas contre le principe même d’aires protégées, ils s’opposent en revanche à la manière dont elles sont gérées en Géorgie. En avril 2024, le média Mtis Ambebi publie une enquête qui met au jour tout un schéma de corruption au sein de l’Agence des Aires protégées et qui concerne directement la vente du canyon de Balda.
Plus de 500 jours après avoir établi leur campement, les Baldiens ont fini par complètement perdre confiance en l’Agence des Aires protégées qui, malgré les révélations et les faux pas, n’annule pas le contrat. Alors quand en janvier 2025 elle vient leur annoncer qu’elle envisage d’octroyer aux territoires au nord de Balda, y compris au mont Askhi, le statut d’aire protégée, la proposition est vécue comme un véritable pied de nez à la souffrance qu’ils endurent depuis deux hivers.
S’il est encore possible aujourd’hui pour des mouvements comme ceux de Chiatura et de Balda de faire entendre leur voix, rien n’est à l’avenir moins certain. Depuis plus d’un an, la Géorgie est le théâtre de manifestations pro-européennes devenues, fin novembre, quotidiennes. La répression des manifestants par le Rêve géorgien s’est graduellement faite plus dure et insidieuse. Le tournant autoritaire se marque par un arsenal législatif qui ne cesse de se parfaire et qui pourrait, à terme, signer la fin de tout mouvement contestataire.
Avec le soutien du Fonds pour le journalisme en Fédération Wallonie-Bruxelles