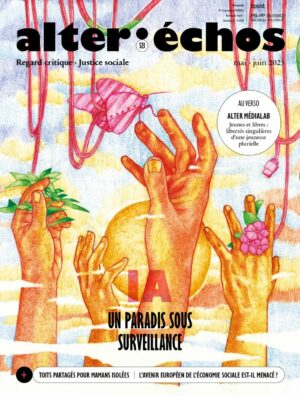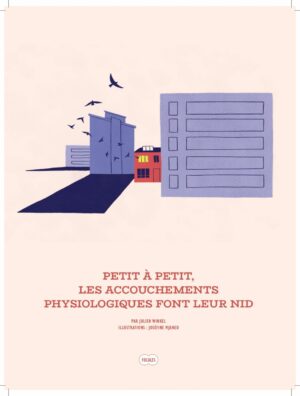De Bruxelles à la province de Luxembourg, l’aide aux migrants se structure, le long des autoroutes; non loin des lieux où s’organisent les passages vers le Royaume-Uni. Des citoyens hébergeurs s’interrogent. À partir de quel moment l’aide sort-elle de l’humanitaire et se mue en coup de main aux passeurs? Ces derniers instrumentalisent-ils l’hébergement? Et puis, au juste, quand devient-on passeur? Certaines de ces questions devaient être tranchées par le procès des «hébergeurs». Elles ne l’ont pas été. Pour l’instant.
Collés à la paroi de l’église de Villers-sur-Lesse, un petit groupe de migrants s’agglutinent autour d’une prise électrique et de quelques rallonges. Ils chargent leur téléphone portable avant la nuit. Devant le petit cimetière de la ville, ils attendent patiemment que leur linge sèche, dans les premiers frimas de l’automne. Derrière l’église, une cabine de douche rudimentaire a été installée.
Devant l’édifice du XIXe siècle – fac-similé de style néogothique –, quelques bénévoles de la Cantine famennoise distribuent des boissons chaudes et des sandwiches à ces migrants en errance. Certains sont coincés en Europe, sans titre de séjour, depuis 2016. Ils sont tchadiens ou érythréens et tous attendent leur tour pour passer au Royaume-Uni. C’est d’ailleurs la proximité de l’E411 et du parking de Wanlin qui explique la présence de ces exilés en ce lieu reculé de l’Ardenne. La semaine, ils dorment dans des abris de fortune collés à la longue bande de goudron et attendent la nuit pour se glisser dans un camion à destination du Royaume-Uni. Le week-end, ils sont souvent accueillis chez des hébergeurs du cru.
Ali a les tempes grisonnantes. Il est exténué. Sa dernière tentative a échoué. Il a dû descendre du camion à Calais, puis revenir à sa base, à Villers-sur-Lesse. «J’ai fait en train Calais-Lille, Lille-Tournai, Tournai-Namur, Namur-Rochefort.» Il est prêt à retenter le coup ce soir. Certains évoquent les nouveaux moyens de passage «à la mode». Le bateau à partir des plages françaises. Le kayak gonflable. La barque. Tout est possible. Et les passages – réputés onéreux – s’enchaînent. Chaque jour, ils bravent le danger, échouent mais n’abandonnent pas.
Pour passer, ce groupe de Tchadiens dit s’organiser lui-même, sans faire appel à un professionnel. «Même si nous voulions un passeur, nous n’avons plus un sou», dit un jeune homme. Une chose est sûre, le groupe, sur ses gardes, préfère ne pas trop évoquer cette question sensible. Une bénévole pense pourtant avoir reconnu un «passeur» dans le groupe, qui serait arrivé avec un nouvel arrivant et qu’elle préférerait ne pas voir traîner dans les parages.
La présence de passeurs dans les initiatives citoyennes d’aide aux migrants en transit est source d’embarras dans certains des collectifs d’aide qui se sont multipliés le long des autoroutes wallonnes. «Je me demande parfois comment on peut rester dans l’humanitaire et se préserver des réseaux», s’interroge une membre du collectif Gembloux hospitalière. Un groupe qui, depuis le confinement, offre un accueil de jour et de nuit permettant à des migrants de poser leurs bagages, sans durée limite de séjour. Gérer cet hébergement avec un nombre restreint de bénévoles ne facilite pas la supervision. «Certains migrants vont à Bruxelles, au parc Maximilien, trouvent des personnes pour organiser des passages et les mettent chez nous en attendant, ajoute la bénévole. Cela m’inquiète car, en offrant l’hospitalité, on pourrait soutenir le jeu des réseaux.» Dans un autre collectif, un bénévole s’inquiète que les services offerts ne figurent au «guide du routard des passeurs».
Passeurs amateurs et passeurs pros
Bien sûr, il y a passeur et passeur. À Bruxelles, Mehdi Kassou, coordinateur de la Plateforme citoyenne de soutien aux réfugiés, a repéré que des migrants improvisent et font dans l’amateurisme, «un peu pathétique». «On est loin des groupes organisés de Calais par exemple», affirme-t-il. Certains négocient un coup de main contre une paire de chaussures. D’autres s’organisent par petits groupes pour passer ensemble. Et d’autres encore montent de petits business improvisés autour du parc Maximilien.
Dans un dossier jugé par le tribunal correctionnel néerlandophone de Bruxelles du 5 septembre 2019, deux Irakiens et un Iranien ont demandé 3.000 euros à des migrants pour organiser leur passage vers le Royaume-Uni. Ils ont embrouillé leurs victimes en les mettant dans des camions à destination… de l’Allemagne. Lors de son audition, un prévenu avouait avoir eu peur d’amener ses victimes sur le «bon» parking… car celui-ci était tenu par des Soudanais, qu’il craignait.
Car en matière de passage, l’amateurisme côtoie le professionnalisme. Des groupes organisés de Kurdes, d’Albanais ou d’autres nationalités façonnent la vie de certains parkings en proie à la violence, parfois aux bagarres entre groupes de passeurs. «Les parkings deviennent de véritables territoires criminels qui appartiennent à des bandes», décrit Patricia Le Cocq, experte chez Myria, le Centre fédéral Migration.
Les réseaux qui agissent en Belgique sont parfois très vastes et déploient des ramifications internationales. Les têtes sont au Royaume-Uni, à Calais ou même dans le pays d’origine. Le célèbre réseau de passeurs «delocation», dont les membres ont été condamnés en 2017, faisait passer des Syriens et des Kurdes en 2014 et 2015. Ils n’hésitaient pas à user de la violence – et de viols à l’encontre de migrantes – sur le territoire belge. Les sommes énormes amassées – plus de trois millions d’euros en neuf mois recensés par la justice, et probablement beaucoup plus – remontaient au Royaume-Uni, où le sommet de la hiérarchie, tenu par des Syriens proches de l’État islamique, bâtissait un petit empire de car wash et de restaurants. «Certains réseaux fonctionnent comme de véritables petites entreprises, résume Ann Lukowiak, magistrate pour le parquet fédéral, référente pour la traite et le trafic des êtres humains. Avec un manager logistique, des gestionnaires de logements – hôtels ou ‘safe houses’ à Bruxelles avant l’étape ‘parking’ –, des recruteurs au parc Maximilien, des gérants de parkings.» Certaines organisations ont même des coiffeurs chargés de faire ressembler au maximum le candidat au passage à la photo d’un document volé.
En bas de la pyramide, on trouve des «petites mains». Il s’agit souvent de migrants sans le sou, vivant dans le dénuement le plus total, et qui monnayent leur propre passage contre quelques coups de main aux passeurs – fermeture des portes d’un camion par exemple. En cas de condamnation, les migrants qui triment en bas de l’échelle reçoivent généralement des peines plus faibles que ceux qui sont aux commandes, lorsque ceux-ci ont été coincés. Ces petites mains sont généralement l’objet des arrestations sur les parkings et, parfois, de condamnations. Pour Alexis Deswaef, avocat, c’est une illustration des «dérives du parquet. Plutôt que s’attaquer à celui qui ferme la porte, on devrait plutôt monter plus haut dans le réseau. C’est le symptôme d’une lutte contre les trafiquants qui se transforme en lutte contre les migrants».
Il est évident que, pour des organisations dont le fonds de commerce est le passage clandestin vers le Royaume-Uni, les lieux d’aide et d’hébergement sont des cibles de choix. «Tout lieu de regroupement de personnes en séjour irrégulier est considéré comme un lieu d’opportunité par les réseaux. À Bruges, des gens – soi-disant bénévoles – rôdaient autour d’une structure d’aide, mais il s’agissait en fait d’un réseau de recruteurs [pour le passage vers le Royaume-Uni, NDLR]», explique Ann Lukowiak. En Belgique, même ceux qui ont voyagé seuls jusqu’ici «font généralement appel aux réseaux pour passer vers la mer du Nord, les 30 derniers kilomètres du trajet», particulièrement complexes à appréhender. Il ne s’agirait pas d’abandonner si proche du but. C’est pourquoi, à côté des gros réseaux bien structurés, d’autres réseaux de passeurs, spécialisés dans la traversée de la mer du Nord se créent, souvent dans le calaisis et parfois à Bruxelles pour «recruter», notamment vers la gare du Nord.
Jusqu’à l’exclusion des passeurs?
À Bruxelles, la Plateforme citoyenne de soutien aux réfugiés a bien conscience de l’attrait exercé par l’hébergement sur les réseaux en tous genres et développe des lignes directrices pour réduire les interférences de ces groupes. «Nous avons créé un lieu d’accueil sanctuarisé, explique Mehdi Kassou, coordinateur de la Plateforme. Selon nous, il faut évidemment être attentif aux agissements des uns et des autres. Il nous est arrivé d’avoir des doutes sur des tentatives d’instrumentalisation de nos dispositifs, mais, lorsque nous pensons que certaines personnes pourraient essayer de profiter du dispositif pour recruter des candidats au passage, nous rappelons le cadre humanitaire de notre action et soulignons que la sanction est, a minima, l’exclusion du dispositif. Les migrants sont eux-mêmes les garants du système et de la relation de confiance qui nous permet d’agir. Il nous est arrivé que certains nous mettent la puce à l’oreille et nous permettent d’intervenir.» La sédentarisation de certains migrants dans les dispositifs d’aide est l’un des indicateurs que les associations utilisent pour «repérer» de potentiels passeurs.
Cette préoccupation est la même dans l’autre «pan» de la plateforme, en Hesbaye. Là-bas, face au constat que des migrants se regroupaient près des parkings de l’E40, le groupe d’hébergeurs – qui fait partie de la plateforme – a centré son action sur ces exilés de proximité. Les citoyens offrent le vivre et le couvert, soit à domicile le week-end, soit dans l’un des trois lieux d’hébergement collectif développés par l’association.
La répartition des migrants dans ces lieux d’accueil ou chez les hébergeurs se fait à partir d’un centre d’accueil de jour à Waremme. «Il est arrivé que l’entrée dans ce lieu de répartition soit ‘tenu’ par des passeurs qui interdisaient certains migrants d’y entrer», explique Diego Dumont, qui coordonne la Plateforme en Hesbaye. Ce dernier assume. Il essaye de «repérer» les passeurs présents dans le dispositif. «Il est clair qu’on en loupe, mais il faut être vigilant. Il nous est arrivé d’exclure quelqu’un mais pas de le dénoncer à la police. Ce n’est pas notre job. Seule l’utilisation de la violence pourrait nous pousser à dénoncer.» Un hébergeur d’un autre collectif citoyen admet même avoir passé ce cap lorsqu’un migrant qu’il accueillait s’est fait «tabasser» par deux passeurs pour non-paiement d’une dette. Mais attention, prévient-il, lorsqu’on parle de passeurs, on ne parle pas ici des «petites mains» qui ferment des camions pour s’offrir le passage.
Dans d’autres collectifs – qui n’inscrivent pas leur action dans celle de la Plateforme et la jugent trop rigide –, on préfère ne pas trop évoquer les enjeux relatifs aux passeurs. C’est par exemple l’avis de Jean-Michel Puits, du collectif S13 à Spy – à deux pas de l’aire de service de l’autoroute, que longe un petit campement de bois et bâches en plastique. «On se doute bien que des réseaux nous voient comme un ‘trois étoiles’, mais nous ne voulons pas les fréquenter. Nous n’y pensons pas. Notre but, c’est d’apporter de l’aide humanitaire à des jeunes en détresse.»
Devant l’église de Villers-sur-Lesse, une bénévole surnommée «Mamie Mafia» évoque le sens de sa démarche: «Moi j’aide nos invités et je ne fais rien d’illégal, dit-elle. Il m’arrive de les ramener dans les bois, près des parkings. Mais ce n’est pas punissable.» Elle regarde, les larmes aux yeux, Jason qui a finalement décidé de tenter sa chance ici, en Belgique, en demandant l’asile et en se donnant corps et âme au football, plutôt que de s’épuiser en vaines traversées de la mer du Nord. «L’émotionnel, chez nous, est parfois compliqué à gérer, admet Paul Marlet, l’un des fondateurs du collectif. Lorsqu’ils partent, c’est un peu comme des enfants qui s’en vont, surtout qu’ils restent longtemps parmi nous.»
Cet enjeu de l’implication émotionnelle débordante – assez taboue parmi les bénévoles – est l’objet de discussions au sein de la plateforme d’aide en Hesbaye, autour de la future charte de l’organisation. Un thème important pour Diego Dumont: «Notre action n’est jamais complètement ‘gratuite’. Il s’agit de toujours combler un manque. L’idée, c’est de rappeler que nous ne sommes qu’une parenthèse dans leur parcours. Il n’est pas nécessaire de pousser les migrants à rester en contact avec nous. Certaines personnes insistent un peu trop là-dessus. Le souci, c’est que des migrants se sentent ensuite redevables émotionnellement. Les relations qui se développent dans ce cadre – y compris les relations d’amour – sont toujours déséquilibrées.» «Parfois, la capacité de discernement s’efface un peu chez les bénévoles, abonde Laurence Nazé, du collectif Gemboux hospitalière. Ils veulent juste faire plaisir. Aider. Mais c’est un terrain glissant. Un jour, ils pourraient glisser un peu trop loin, en dehors du cadre de l’aide humanitaire.»
La clarification n’a pas eu lieu
Si le terrain de l’aide est parfois glissant, c’est que la grande clarification tant attendue du «procès des hébergeurs» sur les limites entre aide humanitaire et aide à l’immigration illégale n’a pas vraiment eu lieu. «Le procès a semé le trouble et a eu un effet dissuasif chez les hébergeurs», affirme Alexis Deswaef, avocat d’Anouk Van Gestel. Sa cliente et les trois autres hébergeuses et hébergeur de la Plateforme étaient poursuivis pour des préventions de «trafic d’êtres humains».
L’aide qu’ils avaient apportée aux migrants désireux de passer au Royaume-Uni – et à des passeurs – se résumait à des accès internet ou à des prêts de téléphones – et même à la localisation d’un parking de passage pour l’une de ces demandes. Les hébergeurs ont été acquittés. Pour Alexis Deswaef, le prononcé du jugement du tribunal de Bruxelles du 12 décembre 2018 est une clarification. «La juge a souligné l’engagement social des quatre prévenus. De plus, elle rappelle qu’il n’y a pas eu d’avantage patrimonial.» Et, en effet, l’article de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers stipule clairement que la définition même du trafic d’êtres humains suppose d’obtenir «directement ou indirectement, un avantage patrimonial». Donc de l’argent ou un avantage. Depuis un jugement du tribunal correctionnel de Bruges, de décembre 2018, «on sait aussi qu’il faut avoir volontairement et consciemment participé au trafic pour être poursuivi selon cette prévention», ajoute Patricia Le Cocq.
Le jugement limpide au sujet des hébergeurs n’a pas tout résolu. D’abord, le parquet a fait appel. Ensuite, si les contours du trafic d’êtres humains sont aujourd’hui un peu plus clairs, ce n’est pas le cas de la notion d’aide humanitaire. La loi de 1980 interdit «l’aide à l’entrée, au séjour ou au transit» d’une personne en séjour irrégulier, même sans aucune rétribution. Une exception à cela: l’aide humanitaire. «On entre ici dans une zone grise, explique Frédéric Kurz, avocat général à Liège, responsable du réseau d’expertise «traite et trafic des êtres humains». Lorsqu’une aide est apportée à des personnes migrantes pour continuer leur chemin vers le Royaume-Uni, par exemple en conduisant la personne à son lieu de rendez-vous avec son passeur, à la gare ou sur un parking, on sort du cadre humanitaire, et c’est problématique.» Le magistrat le reconnaît, «aujourd’hui, il est assez difficile de donner un catalogue précis des actions qui ne sont pas humanitaires. Si un hébergeur aide à entrer en contact avec un trafiquant par téléphone ou internet, c’est assez délicat. Le risque étant d’être pris dans une organisation.» Et le risque augmente à mesure que l’on se rapproche des lieux de passage, reconnaît le magistrat.
Ces clarifications pourraient intervenir rapidement. En octobre, un arrêt de la cour d’appel est attendu dans une affaire d’aide aux migrants dans l’arrondissement de Hal-Vilvorde. «Nous espérons enfin une définition de l’aide humanitaire. Nous attendons cet arrêt et la réaction du collège des procureurs généraux», lance Ann Lukowiak.
En attendant, les collectifs qui hébergent font signer des chartes, des documents, des engagements à leurs hébergeurs – ne pas conduire un migrant vers un parking d’autoroute, ne pas lui acheter de carte Sim, ne pas lui laisser accès à l’informatique. «Nous mettons un cadre pour laisser le moins de place possible à l’interprétation», précise Mehdi Kassou. À la Cantine famennoise aussi, les bénévoles signent une charte et s’engagent à respecter des règles. «Mais ce sont des individus qui ont le cœur sur la main et qui feraient n’importe quoi pour leurs invités. Alors peut-être que parfois ils dépassent les limites», conclut Paul Malet, l’un des fondateurs du collectif. Des limites qui sont floues. Certaines voix réclament qu’on modifie la loi en un sens plus protecteur. Mais pour l’instant, «le gros risque, c’est que certains utilisent cette bonne volonté des bénévoles pour organiser le passage», résume Patricia Le Cocq (Myria).