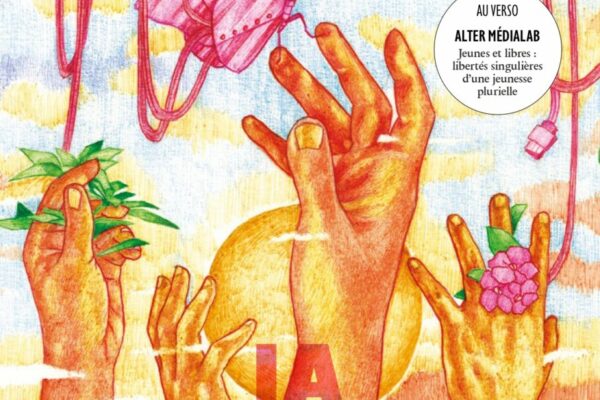Le rendez-vous est fixé dans un café près de la gare de Foggia, dans la province du même nom, avec Yvan Sagnet, témoin clé lors du premier procès pour esclavagisme en Italie, en 2017. Un procès contre la mafia qui organise dans la région le travail de milliers de saisonniers venus cueillir les tomates vendues ensuite dans le monde entier. En 2008, ce jeune étudiant camerounais arrive à Turin, au nord du pays, grâce à une bourse d’études. Suite à un problème administratif, Yvan cherche un travail pour poursuivre ses études. Ses compatriotes lui conseillent le seul poste disponible pour un «Noir»: la cueillette des tomates dans le Sud. C’est donc par hasard qu’il atterrit dans le ghetto de Borgo Mezzanone. Une descente aux enfers qu’il décrit dans le livre Ama il tuo sogno. Vita e rivolta nella terra dell’oro rosso (Galleria Fandango, 2017) (NDLR: Aime ton rêve. Vie et révolte sur la terre de l’or rouge). Il y découvre l’univers des caporali, des intermédiaires qui privent les immigrés de leurs documents en échange d’un travail. Douze heures à cueillir les tomates dans les champs, sous un soleil torride, sans eau ni sanitaires. Yvan se plie à ces règles inhumaines, il dort à même le sol les premiers jours, puis arrive à s’acheter un matelas qu’on lui vole aussitôt. Il endure toutes ces épreuves jusqu’au jour où un de ses compagnons fait un malaise lors d’une cueillette. Les travailleurs appellent alors le caporale à l’aide. Celui-ci exigera 20 euros pour son transport aux urgences. C’est l’étincelle qui allume le feu de la révolte. Yvan organise alors la première grève des saisonniers migrants et révèle à l’opinion publique le fléau du caporalato, cette intermédiation de travail illégale, bien connue, mais tolérée jusqu’alors par les autorités. Il devient témoin dans le procès qui suivra et qui conduira à l’arrestation de douze entrepreneurs et caporali pour «réduction en esclavage», et à une loi, la 199/2016, qui prévoit pour ces délits des peines allant jusqu’à six ans de prison. Ce combat lui vaudra la médaille du mérite de la République en 2017, et la reconnaissance de Roberto Saviano, journaliste célèbre pour son engagement contre la mafia, qui le définit comme «le premier leader noir italien». S’il a depuis obtenu son diplôme d’ingénieur en 2013, Yvan n’abandonne pas ses anciens camarades et a créé son association, «No Cap», contre toutes les formes d’exploitation du travail.
Un label éthique pour réformer toute la filière
«C’est la grande distribution la cause véritable du problème. Dans l’agroalimentaire, à l’inverse de tous les autres secteurs, ce sont les distributeurs, les multinationales, qui fixent les prix des fruits et légumes, et non les producteurs, les propriétaires agricoles. Ces derniers, ne pouvant pas réduire les coûts fixes de production, se rabattent alors sur le coût du travail, en imposant cette exploitation des travailleurs saisonniers inacceptable en Europe au XXIe siècle!», s’insurge Yvan. «Pour résoudre le problème, il faut réformer toute la filière», continue Yvan. Raison pour laquelle, à travers son association, il a lancé un label éthique qui vend ses produits en Europe, grâce notamment à la visibilité offerte par le film de Milo Rau, directeur du NTGent, The New Gospel, film qui revisite la Passion à la lumière des migrants et dans lequel le militant pour l’emploi éthique des travailleurs agricoles apparaît dans le rôle de Jésus.
Le modèle de lière «No Cap» exige non seulement le respect des contrats de travail pour les saisonniers, mais aussi une clause sociale qui prévoit un logement digne et un transport homologué.
Le modèle de filière «No Cap» exige non seulement le respect des contrats de travail pour les saisonniers, mais aussi une clause sociale qui prévoit un logement digne et un transport homologué. «Le consommateur européen est prêt à s’engager avec nous. À redonner au producteur le pouvoir d’établir un prix équitable. Nous recevons de plus en plus de commandes au-delà de l’Italie, avec l’Allemagne en tête», détaille Yvan au moment de rejoindre l’entrée principale du Cara, le centre d’accueil pour demandeurs d’asile géré par l’État.
3.000 travailleurs pendant la saison
Le ghetto abrite jusqu’à 3.000 travailleurs pendant la saison de la cueillette. En suivant la route, les regards répétés d’Yvan dans le rétroviseur font comprendre que nous sommes surveillés. Des «sentinelles» nous suivent, sans que ces guetteurs prennent la peine d’être discrets. Sur le chemin, nous croisons plusieurs jeunes à pied. Yvan s’arrête pour échanger quelques mots avec eux. Selon les informations qu’il obtient, la situation dans les campagnes ne semble pas s’améliorer. Tous restent amicaux, mais réservés. Yvan veut poursuivre la route, mais le premier chemin est bloqué par une Audi. Le chauffeur explique que le propriétaire des champs est dans le coma et qu’il vaudrait mieux de ne pas déranger ses hommes au travail. Le message est clair et ne laisse pas d’autre choix que de rebrousser chemin, vers une autre voie d’accès. Cette fois, c’est une camionnette jaune conduite par un capo bianco, un chef blanc, généralement des Roumains ou Bulgares, qui nous fait barrage. Ce sont eux qui font le lien entre les propriétaires terriens et les capo nero, les chefs noirs, des Africains subsahariens qui gèrent les travailleurs. «Ce champ est à moi et vous devez partir», lance-t-il avec un sourire tout sauf amical. Derrière lui, les caissons bleus de 100 kg de tomates s’entassent pendant que des hommes travaillent le dos plié, sans oser lever les yeux. Yvan décide alors de tenter une voie moins fréquentée à cette heure, celle qui arrive au ghetto. Cette fois-ci, c’est la police qui nous barre le chemin. Les agents nous demandent nos pièces d’identité et la raison de notre présence aux abords d’une zone qu’ils définissent comme «dangereuse». Après vérification, les agents nous laissent passer en nous lançant: «Vous avez cinq minutes, après quoi nous serons partis.» Nous arpentons enfin le chemin de terre battue qui nous amènera à «la piste», comme on l’appelle ici. Car ce baraquement abusif, fait d’abris en tôle ondulée et autres déchets récupérés, est érigé sur les ruines des anciennes maisons des militaires, autour de la piste d’un aéroport désaffecté. Le ghetto est un patchwork de conteneurs, un bric-à-brac où chacun essaye de s’arranger comme il le peut. Il y a une construction en brique avec un tuyau d’eau pour les douches, une supérette qui vend des biens de première nécessité. Pour les toilettes, tout le monde passe par un trou dans la clôture qui sépare «la piste» du Cara. C’est une solution tolérée par les autorités en l’absence de services sanitaires au ghetto. Dans ce décor, les sacs de poubelle s’entassent tout autour des baraques, un amoncellement qui attire les rats. «Il n’y a pas de récolte des déchets, et, comme c’est un campement illégal, la commune ne vient pas, alors au bout d’un moment…», explique Kadir, jeune Togolais arrivé en Italie depuis douze ans et au ghetto depuis cinq. Dans cette zone de non-droit, les travailleurs, des migrants sans papiers, mais aussi des déboutés de la procédure d’asile, des Italiens licenciés des grandes industries qui ont fait faillite au Nord, se sont organisés comme ils le pouvaient. Et ce sont ces silhouettes qui se dévoilent derrière des bouts de plastique épais faisant office de fenêtres.
Environ 420.000 personnes sont illégalement employées et exploitées dans l’agriculture intensive partout dans le pays.
À six dans le conteneur
«Dans le conteneur, on dort à six, continue Kadir. Il n’y a pas d’eau courante, pas d’électricité ni de toilettes ici, mais le pire c’est le froid, quand l’hiver arrive et que tu n’as pas assez travaillé pour t’acheter une bonbonne de gaz.» Le jeune Togolais et ses compagnons de mésaventure se chauffent et cuisinent avec des réchauds de camp, lorsqu’ils peuvent se permettre ce luxe. Et le Covid n’a fait qu’empirer la situation. «Là où les caporali embauchaient dix travailleurs, aujourd’hui, ils n’en prennent que cinq», ajoute Kadir. Quant à ceux sans travail, leur situation est dramatique. «C’est difficile, quand il n’y a pas à manger, il y a des vols, des agressions, admet-il. La paye est de 3,50 € pour le cageot de 100 kg. Si tu veux une petite bouteille d’eau, ça te coûte 1 €. Mais ce n’est pas tout: le matelas est à 5 €, auxquels il faut ajouter un loyer pour un endroit où le placer», poursuit le jeune homme. Mais le plus cher, c’est le transport: 5 € pour avoir une place dans le fourgon surchargé, un véhicule homologué pour huit passagers auquel les sièges sont arrachés pour en transporter jusqu’à vingt. C’est au ghetto le seul moyen de rejoindre leur lieu de travail, les champs. En 2018, après un énième accident où seize travailleurs ont trouvé la mort, le gouvernement italien avait promis de plus larges contrôles des conditions de travail dans les champs. Mais avec une centaine d’inspecteurs pour 300.000 exploitations agricoles, les contrôles sont sporadiques: 1,5% du total, selon les syndicats. «Les sans-papiers travaillent sans contrats, tandis que ceux qui ont un permis de séjour valable ont des contrats bidon, dénonce Kadir. Les propriétaires des champs ne peuvent pas déclarer les 12 heures que nous travaillons par jour ni ce tarif qui ne correspond pas au minimum légal. Si tu n’es pas d’accord, il y en a dix autres pour prendre ta place…» Kadir ne termine pas sa phrase. Les cinq minutes sont amplement dépassées, et nous rebroussons chemin. À la sortie de la piste, plus de traces de la police.
Environ 420.000 personnes sont illégalement employées et exploitées dans l’agriculture intensive partout dans le pays, estime la FLAI-CGIL, la confédération syndicale italienne. La tomate est d’ailleurs une affaire juteuse, le chiffre d’affaires des «produits à base de tomates» a atteint 1,86 milliard de dollars selon l’Observatory of economic complexity en 2019, ce qui fait de l’Italie le plus grand exportateur au monde. La Coldiretti, la principale organisation des exploitants agricoles, indiquait de son côté que 112,5 millions d’euros de fruits et légumes travaillés en conserve sont exportés vers la Belgique. Sans doute des tomates cueillies dans les champs des Pouilles…