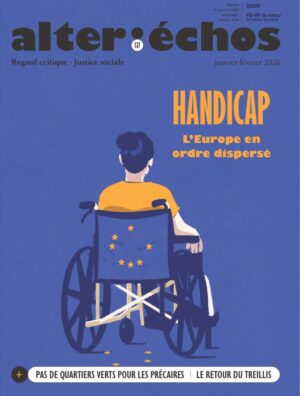L’alliance entre syndicats et activistes n’a rien de neuf. En Belgique, face au gouvernement Michel (N-VA/MR/CD&V/Open VLD), les mouvements Hart boven Hard et Tout Autre Chose en 2014-2015 ont notamment marqué les mémoires militantes. Certaines voix regrettent même amèrement le frein des mobilisations d’alors au profit des concertations sociales[1]. Quelles leçons tirer du passé? Comment organiser la convergence des luttes? Quels sont les profils rassemblés sous la bannière Commune Colère? Décryptage.
Combats sociaux et défis environnementaux
2022, quelques activistes écologiques et des syndicalistes issus de la CGSP ALR et de la CNE[2] décident d’unir leurs forces autour de revendications écologiques et sociales. En février 2023, le groupe hétéroclite mène une première action remarquée au cœur des sièges des trois partis francophones du gouvernement fédéral: MR, PS et Écolo. Les mois passent, loin des projecteurs, la coalition continue de s’organiser.
Juin et octobre 2024, les élections et la formation des différents gouvernements accélèrent la cadence… Le 13 décembre, environ 200 activistes et syndicalistes occupent le siège de la Fédération des entreprises de Belgique (FEB) à Bruxelles pour dénoncer «l’Arizona comme bras armé du patronat». Une fois délogés par la police, autour d’un verre de l’amitié, place au débrief. «Nos revendications s’enrichissent de nos deux secteurs différents qui n’ont pas forcément l’habitude de travailler ensemble. Nous sommes très bons dans l’action directe, tandis qu’eux ont une force de mobilisation et de plaidoyer politique», commente un activiste. Derrière lui, une permanente syndicale au sein d’un CPAS ajoute: «Ces dernières années, les syndicats se sont un peu endormis sur leurs acquis. Aussi, la bureaucratie syndicale peut impliquer une certaine lourdeur. Et ça, ça démobilise les militants. Face à cette réalité, une partie de la réponse pour favoriser la lutte est de se mobiliser avec d’autres groupes. Aux ALR, on défend un syndicalisme combatif et pas la négociation à tout prix.» Ce jour-là, plusieurs grands médias relatent l’événement: le coup est réussi. Sur les réseaux sociaux ou dans la rue, le mouvement prend de l’ampleur.
«Ces dernières années, les syndicats se sont un peu endormis sur leurs acquis. Aussi, la bureaucratie syndicale peut impliquer une certaine lourdeur. Et ça, ça démobilise les militants. Face à cette réalité, une partie de la réponse pour favoriser la lutte est de se mobiliser avec d’autres groupes. Aux ALR, on défend un syndicalisme combatif et pas la négociation à tout prix.»
Une permanente syndicale au sein d’un CPAS
Des assemblées où déposer son désespoir
4 février 2025, rue du Danemark. Ce soir, le sous-sol du DK est rempli de monde. Plus de 200 personnes sont présentes. Dans la salle: des visages bien connus de la militance bruxelloise, mais aussi des syndicalistes, des membres du secteur associatif et des citoyens sonnés par les mesures de l’accord de gouvernement fédéral. Assise sur une chaise, Jennifer, 41 ans, confie: «Je viens ici pour ne pas me sentir seule dans ma peur. J’avais déjà été à des manifs, mais je n’avais jamais rejoint d’organisation militante ni syndicale.» Une activiste prend la parole: «On se définissait jusqu’à il y a peu comme une coalition de syndicalistes et d’activistes, mais on a décidé d’élargir Commune Colère à une assemblée de travailleurs et travailleuses avec ou sans emploi, déterminée à contrer les attaques de la droite et de l’extrême droite. Ce soir, on va donc vous proposer une charte qui sera notre base commune[3].» La soirée marque la troisième «assemblée de lutte». Une sorte de super réunion fédératrice ouverte à toutes et tous, mais respectant une structure prépensée par «des groupes de travail». Au programme du jour notamment: une analyse de l’accord du gouvernement Arizona par la CNE, et une discussion autour d’une action à mener lors de la manifestation nationale à l’appel des syndicats de la semaine suivante. Au fil des échanges, plusieurs craintes sont émises quant à la liberté d’agir par rapport aux actions syndicales. «L’assemblée est souveraine. On n’attend pas le feu vert des directions des centrales, on est en lien avec des personnes au sein des syndicats qui se mobilisent pour les actions», répond l’activiste-animatrice de la soirée.
Au fil des échanges, plusieurs craintes sont émises quant à la liberté d’agir par rapport aux actions syndicales. «L’assemblée est souveraine. On n’attend pas le feu vert des directions des centrales, on est en lien avec des personnes au sein des syndicats qui se mobilisent pour les actions», répond l’activiste-animatrice de la soirée.
Jeudi 13 février. Dans les rues de Bruxelles, une odeur de soufre, la tension est palpable. Parmi les plus de 60.000 manifestants, plusieurs centaines de personnes ont répondu à l’appel de rejoindre le bloc Commune Colère. Les syndicalistes y côtoient des antifascistes, des collectifs féministes, des activistes écologiques et des citoyens lambda. Comme prévu la semaine précédente en assemblée, en marge du parcours, des militants se rendent au siège des Engagés. Ils entendent souligner ce qu’ils considèrent comme «une trahison» du parti face aux engagements sociaux énoncés durant la campagne. Le groupe est arrêté par un vaste dispositif policier, mais encore une fois la couverture médiatique est un succès!
Ne pas rejouer 2014
27 février 2025. Rue du Monténégro, Forest. Dans un grand local, plusieurs centaines de personnes sont présentes pour cette nouvelle assemblée de lutte. Au programme: débriefing de la manifestation et, à nouveau, une discussion houleuse autour de l’alliance activistes/syndicalistes. En substance résonne la crainte que l’élan de mobilisation de Commune Colère soit ralenti par les structures syndicales. Dans la foule, un pompier syndicaliste prend la parole: «On a été abandonné dans la mobilisation par les directions syndicales en 2014 au profit de la concertation. Il faudra voir comment Commune Colère peut marquer des points dans la coordination syndicale depuis la base.» Un délégué CGSP ALR rétorque: «Nous, on est pour la mobilisation maximale et on soutient Commune Colère. Ce qu’on veut maintenant, c’est tirer les autres secteurs.» Pour penser à toutes ces questions, la décision est prise de créer un groupe de travail au sein du mouvement pour réfléchir à ces enjeux en front commun.
Dans un coin de la salle, une responsable d’un mouvement d’éducation permanente proche des syndicats souffle: «Ce qui compte, c’est que les mouvements soient assez forts pour qu’à aucun moment, les syndicats ne puissent les arrêter. Pour moi, le véritable enjeu n’est pas que les activistes et syndicalistes collaborent, mais que les syndicats soient obligés de suivre…» Anne Dufresne, sociologue et spécialiste des mobilisations sociales ajoute: «On parle d’une alliance avec les syndicats en général, mais en fait, il s’agit de certaines centrales, la CNE et la CGSP-ALR en particulier, ainsi que l’Union syndicale étudiante (USE) qui ont toujours été parmi les plus combatives et ouvertes aux mouvements extra-syndicaux tels que Tout Autre chose, D19-20[4], et dernièrement les gilets jaunes. Si ces centrales ont bien un lien aux mouvements, peuvent-elles pour autant influencer les structures dans leur ensemble?»
«Ce qui compte, c’est que les mouvements soient assez forts pour qu’à aucun moment, les syndicats ne puissent les arrêter. Pour moi, le véritable enjeu n’est pas que les activistes et syndicalistes collaborent, mais que les syndicats soient obligés de suivre…»
Une responsable d’un mouvement d’éducation permanente proche des syndicats
Un mouvement qui essaime
Malgré les quelques tensions internes, Commune Colère continue de gagner en popularité. Loin de se cantonner à Bruxelles, des groupes sont désormais organisés à Liège et Namur. Au sein des assemblées, beaucoup répètent qu’on n’a plus d’autres choix que l’alliance et l’action. Et ce dans un contexte de criminalisation des activistes augmenté d’une fragilisation des syndicats par le gouvernement Arizona.
Douglas Sepulchre poursuit actuellement une thèse sur la prise en compte de l’environnement par les organisations syndicales belges, il commente: «Ce que je trouve intéressant avec les membres des organisations syndicales qui gardent un pied dans la militance qui appartient plus à la gauche radicale, c’est qu’ils ne sont pas pris par les mêmes contraintes institutionnelles et peuvent donc mener des actions différentes. Aussi, une initiative comme Commune Colère est pertinente, car cela permet de fédérer toute une série de gens qui ne trouveraient pas leur place dans les syndicats.» Et dans cette «série de gens»: de nombreux jeunes. «Parmi les délégués, la moyenne d’âge est haute, c’est d’ailleurs un problème parce que la jeunesse a souvent une fougue que beaucoup perdent avec le temps… C’est aussi pour ce mélange des générations que je m’implique dans le mouvement», appuie une syndicaliste de 47 ans.
Catherine Opalinski, coordinatrice des jeunes FGTB, observe aussi l’ampleur que prend l’initiative et son impact sur la jeunesse. «Ce qui nous importe le plus, c’est d’être le plus nombreux dans la rue, de faire front ensemble avec tous les mouvements de gauche pour lutter contre ce gouvernement. De mémoire, je n’ai plus vu un tel engouement de mobilisation depuis 2014 et nous sommes ravis qu’il y ait un mouvement de plus qui existe. Elle continue: Ne pas passer par un syndicat, c’est aussi avoir une parole libre et individuelle. C’est accessible, direct et immédiat, mais le risque, c’est l’essoufflement…»
Si personne ne peut prédire la pérennité du mouvement, Corinne Martin, secrétaire permanente à la CNE, se veut rassurante: «La mobilisation est là, il ne faut pas lâcher. Je pense qu’avec Tout Autre Chose, on est entrés dans trop de débats sur notre fonctionnement et ça a fini par nous miner. On essaye de retenir cette leçon. Ce qui nous relie, c’est la charte commune de l’Assemblée. C’est par l’action qu’on arrivera à rassembler et à lutter.» À suivre…
[1] Pour en savoir plus: «Grèves et conflictualité sociale en 2014» par Iannis Gracos dans le Courrier hebdomadaire du CRISP 2015/1 n°2246-2247.
[2] Affilié à la FGTB, le secteur des administrations locales et régionales (ALR) défend les intérêts des travailleurs occupés dans les services publics. La Centrale nationale des employés (CNE) fait partie de la CSC.
[3] La charte est encore en phase de travail, mais les grandes lignes se retrouvent sur le site de Commune Colère: https://commune-colere.be/
[4] L’objectif de cette alliance était de lutter contre le Traité transatlantique.