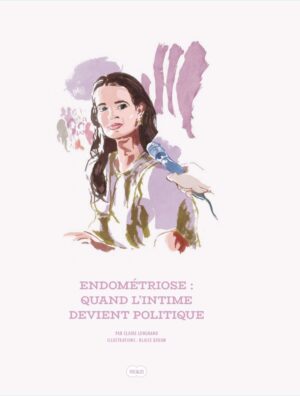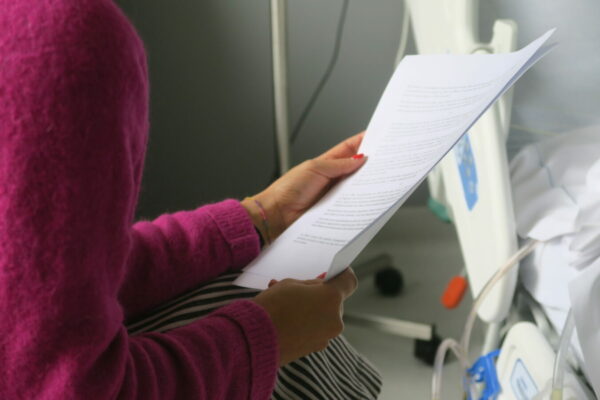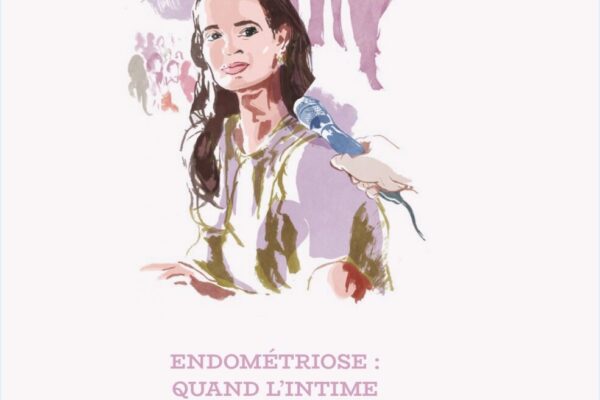Les journalistes, on les adore et on les déteste. Parfois les deux en même temps. Fantasmes, peur et malentendus alimentent les liens entre le secteur non marchand et les médias. Plongeon dans le bouillon.
«J’écris un article sur les tensions qu’il peut y avoir entre les organisations et les médias. Cela vous parle?» – «Ah oui, je vois bien. Très bien, même.» Dans certaines associations, on ne doit pas insister longtemps pour entendre le récit d’une expérience négative avec les médias: des propos «déformés» ou sortis de leur contexte, des interviews-fleuves réduites à une poignée de secondes, des équipes de télé débarquées comme des cow-boys, un goût pour le sang, les sensations fortes et les images-chocs. Les journalistes interrogés autour de nous sont conscients de cette image de doux gaffeurs, voire de goujats sans foi ni loi qui leur colle au stylo. «Quand on aborde une organisation, on a souvent droit au récit fondateur d’une mauvaise expérience avec les médias», témoigne Julie Luong, journaliste indépendante. «Il faut tout le temps se justifier du métier qu’on fait.»
De leur côté, les journalistes ont, eux aussi, leur collection de griefs à exposer: on leur demande le droit de relire les articles avant publication, on les critique pour avoir osé interviewer telle ou telle personne, on leur fait des leçons de vocabulaire, on plante une attachée de presse à leurs côtés pendant les interviews… Cette méfiance envers la presse se retrouve dans toutes les sphères de la société – comme d’ailleurs la fascination qu’elle exerce. Elle peut toutefois prendre une tournure particulière dans le secteur non marchand (associations, organismes publics ou subventionnés, ONG…) où la défense des valeurs et des idées peut entrer en concurrence avec celle d’une autre valeur essentielle de notre démocratie: la liberté de s’exprimer, de critiquer, d’analyser. «Parfois, c’est plus simple dans le milieu privé», reconnaît Julie Luong. «Les grosses boîtes essaient moins d’échapper à la critique et à la polémique alors que les petites associations vont vouloir que tu dises ce qu’elles disent, elles.» La journaliste souligne le paradoxe: «En général, le non-marchand est un milieu qui connaît très bien les médias et défend l’indépendance de la presse. Mais certains voudraient qu’on fasse exception pour eux.»
Le journaliste et le militant
Magali Ronsmans, consultante en relations publiques spécialisée dans la communication environnementale et sociale, confirme le malaise: «Dans le monde associatif, il est fréquent de vouloir relire un article, réclamer un droit de réponse, se sentir trahi quand on découvre qu’il y a d’autres interlocuteurs interrogés, etc. Dans ce cas, le rôle de l’attaché de presse est de recadrer son client et de lui mettre une autre paire de lunettes: il y a une différence entre la presse et la pub.» Selon la consultante, les associations confondraient fréquemment la communication et l’information: «Elles ‘décrochent’ un article dans un journal et pensent que celui-ci va nécessairement refléter leurs idées» — surtout si elles ont été à l’initiative du contact avec le journaliste. «Faire passer» un article serait pour elles une manière de s’offrir de la visibilité bon marché (certains osent même la question: «Combien ça coûte?»). En période de coupes budgétaires, où certaines structures craignent pour leurs subsides, «donner une image positive» de son travail dans les médias revêt parfois une importance vitale.
Et on doit bien l’admettre: une couverture médiatique peut en effet avoir un impact bien plus grand ou un effet bien plus immédiat qu’une campagne de pub onéreuse. Fabian Drianne, coordinateur d’Espace P Bruxelles, une association active auprès des prostituées et des prostitués, admet cette ambivalence: «Nous sommes toujours un peu méfiants avec la presse et certains journalistes sont persona non grata chez nous. Mais il faut reconnaître que les médias peuvent être très utiles. Par exemple, quand un échevin se sent obligé d’enfin nous recevoir parce qu’on est accompagné d’une équipe de télé ou qu’un subside est soudainement débloqué parce qu’on organise une conférence de presse.»
Se sentir utile et apprendre que son travail a contribué à débloquer une situation, à recruter des volontaires ou des donateurs, ou à assurer un soutien politique pour l’association peuvent être gratifiants pour le journaliste. Mais, comme le souligne André Linard, secrétaire général du Conseil de déontologie journalistique (CDJ) et ancien journaliste passé par le secteur associatif, «nous sommes des intermédiaires, pas des porte-voix». Et ce, indépendamment de la sympathie que le journaliste peut avoir pour la cause défendue.
La proximité de valeurs entre le journaliste et ses interlocuteurs, si elle peut faciliter la prise de contact, peut même compliquer le travail. «Je me rends compte, explique Julie Luong, qu’avec certaines associations j’arrive avec de trop bonnes dispositions. Pour une interview politique par exemple, je suis plus sur la défensive.» Or, cette attitude bienveillante peut générer une attente et, à terme, de la déception. «Il faut être particulièrement vigilant par rapport aux sujets qui nous enthousiasment parce que cela peut alimenter le malentendu. En tant que journalistes, nous devons aussi faire notre autocritique.» La Belgique étant un petit monde, il peut être encore plus difficile pour le journaliste de garder une distance critique alors qu’il a en face de lui un ami d’enfance, un cousin de sa belle-sœur ou un militant qu’il rencontre pour la 17e fois. André Linard note même, dans certains cas, le risque d’un effet pervers: pour prouver qu’il est au-delà de tout soupçon, le journaliste «familier» de son sujet se montrerait alors particulièrement distant, zélé ou critique.
Le Code de déontologie journalistique a été adopté en 2013 par le Conseil de déontologie journalistique (CDJ), un organe d’autorégulation des médias francophones et germanophones de Belgique composé de journalistes, d’éditeurs, de rédacteurs en chef et de représentants de la société civile. Extraits choisis.
Article 3. Les journalistes ne déforment aucune information et n’en éliminent aucune essentielle présentée en texte, image, élément sonore ou autre. Lors de la retranscription d’interviews, ils respectent le sens et l’esprit des propos tenus.
Article 23. Les journalistes ne prennent envers un interlocuteur aucun engagement susceptible de mettre leur indépendance en danger. Toutefois, ils respectent les modalités de diffusion qu’ils ont acceptées librement telles que l’embargo, le «off», l’anonymat… Ces engagements doivent être clairs et incontestables.
Article 27. Les journalistes sont particulièrement attentifs aux droits des personnes peu familiarisées avec les médias et des personnes en situation fragile comme les mineurs ou les victimes de violence, d’accidents, d’attentats, etc. ainsi que leurs proches.
Pour consulter le Code de déontologie journalistique ou introduire une plainte: www.lecdj.be
Couper, cadrer, nettoyer
Dans tous les cas, accepter que le journaliste fasse son travail, c’est accepter qu’il recadre, précise, commente, élimine, vérifie, nuance et critique nos propos. Un exercice difficile quand on a l’impression de lutter pour la bonne cause et d’être implacable sur notre matière. Magali Ronsmans: «Le monde associatif est composé de gens souvent très experts dans leur thématique, qui ont leur propre jargon et parfois l’impression que tout est essentiel, prioritaire et important. Ils s’attendent à ce que tout ce qu
’ils ont dit se retrouve dans l’interview finale.» Mais le journaliste soucieux de son public doit précisément traquer les longueurs, traduire le jargon, sélectionner l’information, si nécessaire en la resituant dans son contexte. D’une interview d’une heure, il ne gardera peut-être que deux-trois phrases, essentielles à ses yeux. «D’où l’importance du ‘media training’ [entraînement à parler aux médias, NDLR]», souligne Magali Ronsmans. «Il faut bien préparer l’interview et arriver avec un message clé: déterminer ce qu’on veut faire passer comme message essentiel, ajouter éventuellement quelques nuances et avoir sous la main quelques chiffres. Surtout, éviter de s’éparpiller.»
Jusqu’où les journalistes ont-ils le droit de «triturer» les propos qu’on leur a confiés? En presse écrite, l’usage est de couper les mots et les phrases parasites, les adverbes qui alourdissent, les constructions compliquées et les formules «orales», du style «ben oui, c’est comme je vous ai dit avant, en fait, moi, heu, je pense que fondamentalement…». Clac. C’est ce qui suit qui compte. Marc Vanesse, professeur de journalisme à l’Université de Liège (ULg): «Il faut accepter ce nettoyage. C’est une petite trahison que le journaliste opère pour plus de clarté.» Cette trahison peut quelquefois aller jusqu’à une légère réécriture. «Il y a des gens qui ne sont pas très limpides, qui bégaient, qui ne finissent pas leurs phrases, qui annoncent quatre points dans leur réponse mais n’en donnent que trois.» Dans ce cas, le journaliste peut s’autoriser une correction, par fidélité non pas aux mots réellement prononcés («ma réponse sera en quatre points») mais à l’intention de l’interlocuteur (donner une réponse en trois points). Il en va de même pour les fautes de français, les erreurs factuelles ou les propos sur un même sujet, éparpillés au cours d’une conversation et qui seront regroupés dans le texte final.
Le choix des mots
Ce passage du langage oral au langage écrit ne pose généralement pas de problème aux interviewés, qui ont tout à gagner de ce travail de réécriture. Sauf si, en reconstruisant une phrase démantelée, le journaliste en vient à transformer le sens des propos ou à faire apparaître un mot ou une expression tabous pour leur auteur. Dans le dialogue «militant/journaliste», le choix des mots devient une source inépuisable de tensions: aux erreurs dues à l’ignorance du journaliste (confondre «demandeur d’asile» et «réfugié», «sécurité nucléaire» et «sûreté nucléaire», «plaidoyer» et «plaidoirie») s’ajoutent des choix idéologiques lourds de sens aux yeux du militant (dire «déficient auditif» plutôt que «sourd», «travailleur du sexe» plutôt que «prostitué», «nos usagers» plutôt que «les SDF»)… S’il met les propos dans la bouche de son interlocuteur, le journaliste se doit d’être le plus fidèle possible au vocabulaire utilisé. Si, en revanche, il assume les propos, il peut décider d’adopter ou non les usages du «milieu» ou de se conformer à l’usage commun. Encore faut-il qu’il soit conscient du choix qui s’offre à lui…
L’équipe du Groupe pour l’abolition des mutilations sexuelles (GAMS) évite, par exemple, d’utiliser le mot «victime» pour désigner une femme qui a subi une excision. «Ça la réduit à cette position d’où elle ne peut pas se relever», explique Fabienne Richard, directrice. Face à des journalistes, elle n’hésite pas à attirer leur attention sur cette question: «Je leur explique pourquoi on refuse de parler de ‘victime’. Certains veulent juste avoir un témoignage sur l’excision, où la fille dit qu’elle avait 7 ans, qu’elle a eu mal et qu’il y avait du sang partout. Puis, ils interrogent un expert blanc. Nous refusons cela. Quand je sens que ce sera trop racoleur, je remballe le média.» Évoquer préalablement ces questions idéologiques, tout en laissant le journaliste libre de ses choix, peut souvent lever les malentendus et contribuer à enrichir sa réflexion.
Certaines associations vont jusqu’à faire, en amont, un travail de sensibilisation des médias. En 2011, des professionnels de la prévention du suicide ont ainsi collaboré avec l’Association des journalistes professionnels (AJP) pour attirer l’attention des journalistes sur leur responsabilité sociale dans le traitement du suicide. Certains mots, certains détails ou certaines images peuvent avoir un impact sur les proches de la victime ou encourager d’autres personnes à passer à l’acte. Cette collaboration a débouché sur la rédaction d’une brochure1, qui propose des balises pour un traitement plus «responsable» du suicide: par exemple, «on évitera de présenter un comportement suicidaire comme une solution aux difficultés rencontrées par un individu (…). Un suicide est toujours un échec, même si on peut signaler que la personne concernée a cru le contraire.»
La demande énerve plus d’un journaliste qui y voit un manque de confiance et une tentative de contrôle. D’autres s’en acquittent de bonne grâce, estimant que cela peut éviter certaines erreurs. Ce qu’ils en disent:
– Le journaliste-référent. Jean-François Dumont, de l’Association des journalistes professionnels (AJP): «Il n’y a pas de règle établie mais une habitude culturelle: en Belgique francophone, l’habitude est de ne pas demander à relire, contrairement à la France ou à la Flandre. En droit, une fois que l’interview est faite, les propos n’appartiennent plus à la personne et elle ne peut pas se rétracter. Dans les faits, c’est une question de bonne entente. La relecture peut se justifier dans certains cas: une demande expresse de la part du journaliste, des matières scientifiques ou particulièrement délicates, une mauvaise maîtrise de la langue.»
– Le gardien de la déontologie. André Linard, secrétaire général du CDJ: «Clairement, cette exigence de relecture, qui se répand en Belgique francophone, est anti-déontologique. Les journalistes ne peuvent pas se soumettre à cette pratique, qui peut nuire à leur indépendance. Mais dans la pratique, il y a souvent un rapport de forces, notamment quand l’interview est conditionnée à cela. Il faut, dans tous les cas, que le journaliste reste maître de ce qu’il dit.» La déontologie impose aussi le respect de l’accord qui aurait été préalablement conclu.
– La chargée de com. Magali Ronsmans, consultante en relations publiques. «Je déconseille à mes clients de faire cette demande, à moins qu’il ne s’agisse d’un contenu scientifique. Ça crée un environnement malsain qui, à terme, peut affecter les relations de confiance avec le journaliste.»
– Le prof de journalisme. Marc Vanesse, de l’ULg. «Accepter une relecture, bien souvent, c’est perdre de la fraîcheur, de la spontanéité, et risquer que les propos ne deviennent lisses et aseptisés.»
Protéger les personnes fragiles
La déontologie impose aux journalistes d’être particulièrement vigilants avec les personnes fragiles ou peu familiarisées avec les médias: s’assurer qu’elles ont bien compris leur démarche, ne pas tenter de leur faire dire des choses qu’elles regretteraient d’avoir dites, informer sur l’usage qui sera fait des photos ou vidéos, etc. En cas de problème, les associations qui ont servi d’intermédiaire peuvent se sentir trahies. Chez Espace P, on refuse tout simplement de présenter des travailleurs du sexe aux médias. Fabian Drianne: «On ne veut pas être tenu responsable si des propos sont déformés ou s’i
l y a un problème.» Mais n’est-ce pas pourtant une démarche respectueuse de passer par une association de terrain pour entrer en contact avec des prostituées? «Non, ce n’est pas plus respectueux. C’est surtout plus facile. Aller à la rencontre des travailleurs du sexe prend du temps. On connaît bien l’urgence dans laquelle travaillent les journalistes, mais on n’y peut rien. En plus, on risquerait de proposer toujours les mêmes personnes, qui ne sont pas forcément les plus représentatives.»
Gregory Vandendaelen, responsable de la communication à l’Îlot, un service d’accueil pour les sans-abri à Bruxelles, fait le choix inverse: «Je n’ai jamais refusé de demande. J’essaie de comprendre ce que le journaliste recherche – ce qui n’est pas toujours clair – et de l’accompagner pour trouver les meilleures personnes, par l’intermédiaire des intervenants sociaux.» Dans la mesure du possible, il essaie de ne pas répondre lui-même aux journalistes mais d’orienter vers les collègues de terrain ou vers les «usagers». «Je prends le temps d’un peu les encadrer. Si l’interview est bien préparée, on n’a jamais de mauvaises surprises.» De son expérience précédente chez MSF, il retient toutefois qu’il vaut mieux que le chargé de communication ne demande pas lui-même l’accord de la personne interviewée ou photographiée, pour éviter toute pression: «Quand vous arrivez avec votre tee-shirt MSF, vous avez une certaine autorité. J’introduisais le journaliste; j’expliquais aux personnes qu’ils avaient le droit de dire non et que ça ne changerait rien à la façon dont ils seraient soignés ou pris en charge.» Au journaliste de faire ensuite son boulot.
La peur de la gaffe
Les relations avec la presse méritent une attention professionnelle et une préparation minutieuse. Elles demandent aussi, parfois, une petite dose de lâcher-prise. «À un moment, il faut faire confiance et jouer le jeu», recommande Julie Luong. «C’est dans l’intérêt de tout le monde de sortir de l’obsession de faire passer son message pour ne pas perdre ses subsides.» Et de remarquer: «Dans les organisations, c’est parfois dans le bas de la hiérarchie qu’on se montre le plus stressé.»
La peur des médias, la crainte de mal dire, de gaffer ou de vexer un collaborateur: autant d’éléments qui alourdissent encore la relation avec les journalistes. L’idée de cet article est d’ailleurs née d’un malentendu avec la Stib où une chargée de projet s’était montrée particulièrement zélée face à notre volonté de faire un reportage sur un sujet a priori non polémique: nous devions préparer le sujet avec elle, envoyer nos questions et accepter une relecture par le service de communication. Impossible. Françoise Ledune, porte-parole de la Stib et ancienne journaliste, regrette la manœuvre: le service de communication de la Stib ne demande pas de relire les articles mais souhaite simplement être l’interlocuteur privilégié des journalistes. La responsable du projet a simplement mal interprété cette instruction. «Nous connaissons bien les contraintes du métier de journaliste et les règles de déontologie», rassure la porte-parole. Si elle admet que la communication impose une certaine prudence, elle recommande aussi de prendre du recul: «Il y a, globalement, dans la presse aujourd’hui, une volonté de sensationnalisme. Mais il faut en relativiser l’impact: ce qui est publié le lundi est souvent déjà oublié le mardi.»
Au final, si les exemples de frictions entre la presse et le non-marchand sont légion, le bon sens et le dialogue semblent souvent suffire pour apaiser les esprits. Le Conseil de déontologie journalistique, qui a reçu plus de 300 plaintes en presque six ans d’existence (dont plus de la moitié concernant le groupe Sud Presse), n’en a pratiquement pas vu passer de la part d’associations qui s’estimeraient victimes d’une faute déontologique. En revanche, André Linard reconnaît volontiers que l’évolution du métier a de quoi inquiéter: «Le journalisme est de plus en plus court, plus choc et plus rapide. Quand on donne une idée avec une nuance, on ne retient plus que l’idée sans la nuance. Il y a aussi une tendance à un clivage plus net des opinions.» Et vous, vous êtes pour ou contre le réchauffement climatique?
Les jeunes journalistes, soumis à une très grande concurrence sur le marché de l’emploi, acceptent parfois des conditions de travail et des pratiques indignes. «Je ne suis pas sûr qu’on choisisse toujours les plus compétents mais parfois les plus dociles», poursuit André Linard. L’exemple est fourni par Espace P: «On a été contacté à plusieurs reprises à propos de la prostitution estudiantine. Or, c’est un phénomène qui existe ailleurs mais qui est très marginal en Belgique.» Mais les journalistes insistent, veulent à tout prix faire exister leur sujet et «ramener» quelque chose à leur rédaction. «Manifestement, ils auraient préféré que je leur dise que toutes les étudiantes de l’ULB font ça.»
Derrière cette valse de poules sans tête se cache une vérité: «Comme il y a de mauvais boulangers ou de mauvais médecins, admet Marc Vanesse, il y a de mauvais journalistes.» Il y a aussi de mauvaises conditions de travail, qui font dire à André Linard qu’«aujourd’hui, le danger pour la liberté de la presse ne vient pas tant du politique que de l’économique». Et c’est le cœur du métier, la relation humaine, qui trinque en premier. Se déplacer pour un rendez-vous, prendre le temps d’exposer son projet, passer des heures sur un sujet avant d’admettre qu’il se dégonfle, mettre une énergie folle à trouver les bons témoins: autant de fondamentaux du journalisme qui, à la longue, deviennent, eux aussi, des actes militants.
Selon Magali Ronsmans, consultante en relations publiques, trois ingrédients sont essentiels pour remplir la gamelle du journaliste2:
– De la nouveauté. La nomination d’un nouvel administrateur ou la refonte du service comptable peuvent changer la vie d’une organisation. Mais ce ne sont pas forcément des événements essentiels aux yeux d’un professionnel de l’information. Les organisations qui ont le communiqué de presse trop facile risquent de lasser les journalistes et de n’obtenir aucune retombée médiatique.
– De la confiance. La relation avec les médias se construit au fil du temps et se base sur «la crédibilité» et «le professionnalisme». Mieux vaut contacter personnellement, ponctuellement, l’un ou l’autre journaliste ciblé pour lui offrir une bonne info que de tenter de «vendre sa soupe» à tout son carnet d’adresses.
– De la créativité. Si les journalistes n’aiment pas être dirigés, ils apprécient souvent qu’on leur suggère des angles originaux, adaptés à leur public. «Sur un même sujet, un journaliste de la presse économique ne traitera pas l’information de la même manière qu’un journaliste de la presse féminine: ils ne s’intéresseront pas aux mêmes données, ne solliciteront pas les mêmes experts, ne souhaiteront pas les mêmes illustrations.»
En savoir plus
- Voir la brochure «Le traitement du suicide dans les médias», disponible sur www.preventionsuicide.info
- Magali Ronsmans et Virginie de la Renaudie, «Communication et développement durable: pour des pratiques plus responsables», Edipro, 2014 (www.edipro.eu).