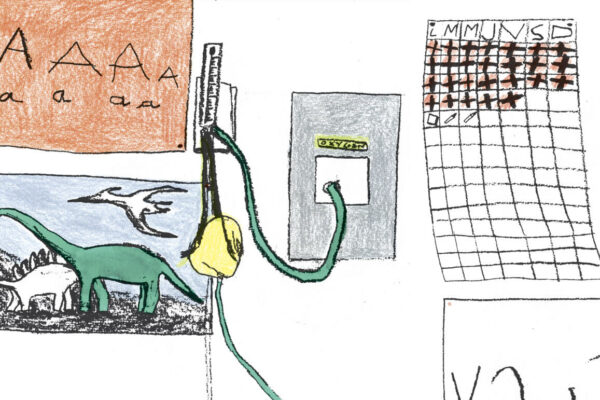À la rue du Zuen à Anderlecht, à deux pas du ring, on aperçoit les camions et on entend les voitures. Dans ce brouhaha incessant, à l’ombre de l’enseigne bien connue d’un magasin d’ameublement, c’est là que se situe le nouveau centre de tri des Petits Riens inauguré en 2015. Pour le trouver, il suffit de suivre les camions qui défilent et déversent chaque jour des tonnes de vêtements.
Ce lieu est sans doute celui qui symbolise le mieux la mue entamée par l’association depuis quelques années. Véritable fourmilière, les travailleurs trient ici environ 25 tonnes de vêtements par jour. Dans un ballet de jaune, de vert, de rouge ou de noir, les vêtements passent entre les mains des trieurs qui décident en une fraction de seconde du sort à réserver à la fripe. «10 à 15 % sont jetés d’emblée parce qu’abîmés ou rongés par l’humidité, 20 à 25% sont valorisés en matière textile, plus de 45% partent à l’export. Et les 15% restants sont vendus en boutiques», explique Maria, responsable de l’atelier textile.
Dégager des bénéfices
Les Petits Riens, c’est avant tout une entreprise d’économie sociale dont l’activité repose sur la «collecte-tri-vente» de vêtements mais aussi de meubles, d’électro-ménagers, de livres ou d’objets en tous genres. «L’objectif est clairement de faire des bénéfices pour mener des projets en lien avec notre objet social, explique Odile Dayez, directrice de la communication. Le modèle n’a pas changé depuis les débuts de l’association en 1937.» Si ce n’est par son ampleur.
Il faut dire que le marché de la seconde main a la cote en ce moment. Un secteur très en phase avec une évolution sociétale, qui élève la «récup» au rang de nouveau sport national chez les jeunes générations pour qui consommer autrement et respecter l’environnement sont des priorités. Aussi parce que le marché de la fripe de seconde main est devenu «tendance». «C’est vrai que les magasins marchent fort en ce moment, se réjouit Odile Dayez. On en a ouvert une dizaine ces dernières années.»
Mais si le secteur a le vent en poupe, le marché devient aussi de plus en plus concurrentiel. «Les Petits Riens devaient se professionnaliser s’ils ne voulaient pas être dépassés par la concurrence», analyse la responsable communication. Dans le précédent centre de tri, les Petits Riens n’arrivaient pas à traiter tout le volume reçu. «On a vu qu’on pouvait grossir davantage en ouvrant plus de magasins dans des régions où on n’était pas encore et du même coup engager plus de gens.»
Tension permanente
Un virage qui n’est pas sans conséquence sur l’organisation du travail et sur le fonctionnement de la structure. Pour Odile Dayez, le défi pour les Petits Riens est de grandir tout en continuant à être en phase avec ses différents publics: «En même temps surfer sur la vague ‘récup’ tout en n’oubliant pas le public premier auquel s’adressent nos magasins.» La quadrature du cercle? Peut-être pas si l’on en croit la directrice. «Nos enquêtes montrent que les clients les plus précarisés sont contents de l’évolution de nos magasins. Ils se sentent valorisés de faire leurs courses dans un magasin comme les autres.»
Martine a vu les changements. La soixantaine, cette habituée des Petits Riens se rend en moyenne une fois par semaine au magasin situé chaussée de Wavre, du côté de la Chasse à Bruxelles. Si elle apprécie les nouveaux agencements, elle trouve quand même que les prix ont augmenté. «Avant on trouvait plus facilement des chemisiers ou un accessoire à petit prix.» Du côté des Petits Riens, on nuance même si on admet un changement de politique. «Les prix de base sont restés les mêmes mais on valorise davantage les pièces rares, les produits de marque, confirme Odile Dayez. Il y a donc eu une augmentation ciblée, uniquement sur les produits de ‘luxe’.»
C’est une des difficultés inhérentes au modèle: vouloir accroître les bénéfices ne se fait-il pas au détriment des personnes les plus précarisées? Odile Dayez s’en défend et voit plutôt ça comme un défi permanent. Elle évoque la double casquette historique des Petits Riens. «On a toujours eu une pression à faire de bons résultats. Mais c’est vrai que celle-ci s’est encore accentuée avec la construction du nouveau centre de tri étant donné les investissements que ça représente pour l’association.»
«Il ne faut pas être nostalgique!»
Ce changement d’échelle fait également ricaner en interne et fait dire à certains travailleurs que les Petits Riens, ce n’est plus comme avant. Pour certains, cela s’est traduit concrètement par un déménagement de leur lieu de travail à la rue du Zuen, dans le zoning d’Anderlecht. «Avant, tout tournait autour de la rue Américaine à Ixelles. C’était le coeur historique de l’association où se mêlaient au quotidien le social et l’économique, regrette ce travailleur qui préfère garder l’anonymat. Tout était mélangé, je croisais les bénéficiaires tous les jours. Aujourd’hui, tout est cloisonné.»
«C’est vrai qu’on a beaucoup grandi et qu’on a été contraint de nous décentraliser, réagit Odile Dayez. On a éclaté les lieux et donc, forcément, les liens sociaux entre les travailleurs. Ce qui était possible dans un fonctionnement à petite échelle ne l’est plus aujourd’hui. On a dû se professionnaliser.»
Pour André Bouret, le directeur des actions sociales, il ne faut pas être nostalgique. «Les Petits Riens, c’est peut-être devenu un gros machin mais ce changement d’échelle a permis de dégager des moyens en plus pour l’action sociale. Ça permet de faire beaucoup de projets et en plus de créer de l’emploi.» Il rappelle aussi que les nouvelles marges ont permis à l’association d’engager 25 travailleurs sociaux supplémentaires en 10 ans pour le suivi des personnes. «Et avec les nouveaux projets en préparation, on va encore certainement en engager 10 au bas mot.»
Les Petits Riens: par-delà la collecte-tri-vente
«Les Petits Riens, c’est la collecte des biens et, derrière, il y a une bonne cause.» En substance, c’est ce qui ressort de l’enquête de notoriété qu’a menée l’association récemment. «85 % des Belges connaissent le nom ‘Petits Riens’ et l’associent à la collecte de seconde main», explique Odile Dayez. Mais le problème est que les gens n’associent pas le nom aux projets sociaux. «Ils pensent qu’on redistribue simplement les biens aux personnes précarisées. Ils ne connaissent pas l’action sociale que nous menons.» Car derrière les «bulles» à vêtements se cache aussi une plateforme d’insertion et de lutte contre la pauvreté.