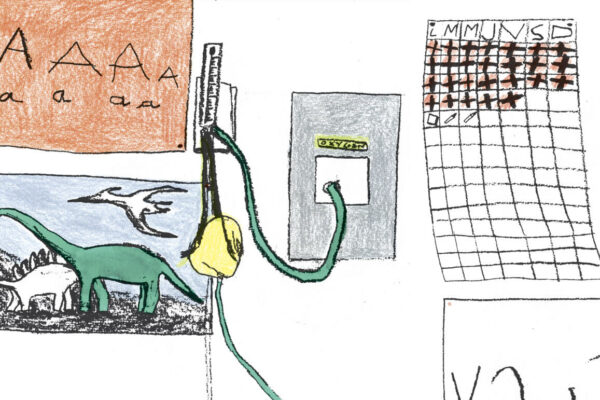Jusqu’ici le ciel tirait un peu la gueule. Mais alors qu’Amelia (nom d’emprunt) prend place derrière quelques tables disposées en carré, un rayon de soleil finit par percer les nuages, traverse la baie vitrée juste en face d’elle, et se pose sur son visage de jeune fille.
Quelques minutes plus tôt, Amelia est apparue presque soudainement, sans se faire remarquer, dans le hall d’entrée de Casa Legal. Pull à col roulé, doudoune blanche, jean troué, sneakers aux pieds, elle ressemble à toutes les gamines de son âge, celles que l’on peut croiser le soir, un classeur à la main, dans le bus ou le tram, à la fin des cours. Mais alors qu’elle commence à parler en chipotant à son masque et en plissant les yeux à cause de la lumière, on se rend compte que son histoire est un peu plus complexe que ça. À peine majeure, Amelia est née en Belgique. Elle y a toujours vécu, elle y étudie. Mais ses origines, et celles de ses parents, sont à aller chercher quelque part du côté de deux anciennes républiques soviétiques, entre Europe orientale et Caucase. Problème: en situation irrégulière, ses parents ne se sont jamais trop souciés de certaines formalités. Du coup, Amelia ne possède pas la nationalité belge, pas plus qu’elle n’était connue, jusqu’il y a peu, des services de ses pays d’origine. Amelia se situe dans une sorte de no man’s land. Malgré toutes ces années ici, son français parfait teinté d’accent bruxellois, sa scolarité, elle n’a pas de papiers, rien. «Dès que je me fais contrôler par la police, on m’embarque», lâche-t-elle mi-amusée, mi-incrédule.
«En tant qu’avocates, nous travaillons maintenant en binôme, ce qui est un gros changement. Et puis nous collaborons avec des assistants sociaux, ensemble, dans la même pièce. Cela permet de vraiment améliorer les choses.» Clémentine
À ses côtés, dans cette petite pièce dont on a ouvert les portes et fenêtres pour évacuer d’éventuels germes du Covid, se tiennent trois autres personnes. Il y a Susana, l’assistante sociale. Et Clémentine et Noémie, les avocates. Ensemble, elles tentent de dépatouiller la situation d’Amelia, qui est justement venue les trouver il y a quelques mois de cela, de son propre chef, pour tenter de mettre de l’ordre dans sa situation. Amelia a l’air d’en vouloir, elle a des projets plein la tête. Mais elle est un peu perdue dans ses démarches. Suite au travail déjà entrepris par Clémentine et Noémie, le pays de son père a fini par la reconnaître. C’est déjà ça de pris: Amelia n’est pas – plus – apatride. Mais il faut maintenant qu’elle obtienne un passeport, qui permettra ensuite aux deux avocates d’essayer de régulariser son séjour en Belgique. Un sacré boulot, qui nécessite de produire plein de paperasse et, surtout, d’avoir les idées claires. Pas évident pour une jeune de moins de 20 ans qui jusqu’il y a peu vivait dans un squat avec son père… Autour de la table, on parle composition de ménage, acte de naissance, apostille, consulat… «Tu n’y arrives pas?», demande Clémentine à Amelia à propos des démarches pour l’obtention du passeport, qui semblent un peu s’enliser. «Non non, ça va, c’est juste que c’est un peu cher…», répond la jeune fille. 200 euros pour un passeport, c’est effectivement une jolie somme quand on se nourrit grâce aux défraiements payés dans le cadre de ses stages d’apprentissage. Susana semble pourtant avoir une solution: elle trouvera l’argent auprès de CAP Brabantia – Antenne Caritas International, la structure qui l’emploie. Noémie et Clémentine, elles, se chargeront de continuer à épauler Amelia pour l’obtention du passeport. «Tu as tous les documents?», lui demande Clémentine. «Maintenant, il faut qu’on l’obtienne ce passeport, il ne faut plus attendre des mois», continue l’avocate. «S’il y a encore un souci, dis-le nous, on peut débloquer des choses», renchérit Noémie. Tout a l’air en ordre. Un sourire derrière son masque, Amélia se lève et s’en va presque aussi discrètement qu’elle était arrivée.

Des situations pareilles, il s’en joue souvent dans les murs de Casa Legal. Lancée par quatre jeunes avocates au mois de septembre 2020, en pleine pandémie de Covid-19, cette asbl propose à ses bénéficiaires de les accompagner de façon holistique, intégrée et multidisciplinaire. Ceux-ci s’adressent toujours à Casa Legal pour des problèmes relevant du droit des étrangers ou du droit familial. Mais si cet aspect juridique et administratif constitue en quelque sorte une porte d’entrée, la jeune asbl a aussi décidé de s’occuper du volet psychosocial de la situation des bénéficiaires, souvent compliqué. Un peu à l’image de ce que font les maisons médicales dans le domaine de la santé. «Il s’agit souvent d’un public fragile, vulnérable», témoigne Susana, que son employeur, CAP Brabantia – Antenne Caritas International, dépêche une fois toutes les deux semaines – en alternance avec une collègue – pour épauler Casa Legal. «On parle de personnes ayant eu des trajets de vie très difficile, qui ont connu l’exil, la violence, les viols, qui ont laissé leur famille au pays ou y ont subi des discriminations.»
L’approche de Casa Legal est quelque peu iconoclaste. À parler avec Susana Parraga, l’assistante sociale, et Clémentine Ebert, Noémie Segers, Katia Melis et Margarita Hernandez-Dispaux, les quatre avocates, on comprend que ces deux mondes, ceux du social et du droit, ne se croisent logiquement jamais dès lors que l’on parle de droit des étrangers ou de droit familial. En temps normal, il y a d’un côté les assistants sociaux, travaillant pour des structures de première ligne, qui n’ont de contact avec les avocats «que par mail ou par téléphone», d’après Susana. Et de l’autre, des avocats officiant la plupart du temps en solo au sein de cabinets. «Avec Casa Legal, on a voulu changer cet état de fait, explique Clémentine. Déjà, en tant qu’avocates, nous travaillons maintenant en binôme, ce qui est un gros changement. Et puis nous collaborons avec des assistants sociaux, ensemble, dans la même pièce. Cela permet de vraiment améliorer les choses. Ce à quoi vous avez assisté aujourd’hui, cette mise en confiance d’Amelia pour tenter de l’accompagner au mieux, n’aurait pas été possible sans l’approche qui est aujourd’hui la nôtre… Même dans les cas les plus affreux, comme ceux concernant des victimes d’esclavage sexuel, où celles-ci te déposent les pire atrocités, le fait qu’il y ait deux ou trois personnes face à elles fait qu’elles en parlent plus facilement.»
«On parle de personnes ayant eu des trajets de vie très difficile, qui ont connu l’exil, la violence, les viols, qui ont laissé leur famille au pays ou y ont subi des discriminations.» Susana