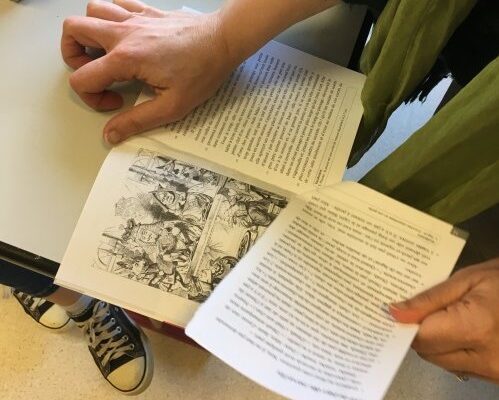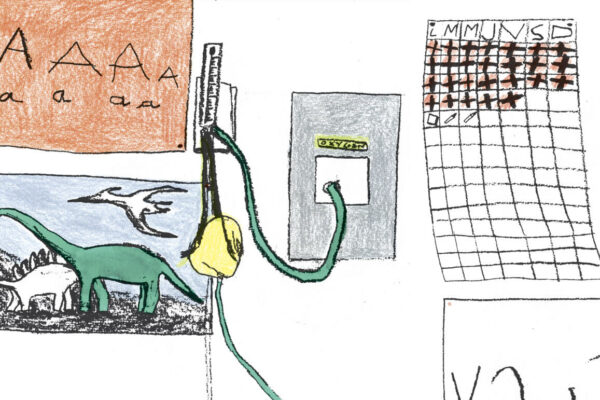Les champs sont roussis par la sécheresse. Hubert del Marmol est très inquiet. Ses vaches limousines n’ont plus rien à manger. Le propriétaire de la Ferme du Petit Sart veut récupérer quelques vaches et leurs petits pour les nourrir dans les étables. Il prend un sac de foin qu’il dépose dans la bétaillère garée près de la clôture. Nous partons avec lui à la recherche de ses bêtes. À perte de vue, des prés jaunes, secs. «Elles doivent être à l’ombre.» Effectivement, on finit par les trouver couchées sous des arbres. Hubert del Marmol les appelle: «Venez, les filles!» Les «filles» ont toutes un prénom et l’éleveur assure ne jamais les confondre, mais, ce matin, elles n’ont visiblement pas envie de s’approcher de lui. À force de les appeler, de taper dans les mains, Hubert finit par susciter leur intérêt. Un énorme et impressionnant taureau mène la marche. «Restez près de moi», me conseille Hubert del Marmol. Je comprends sans peine. Le troupeau, taureau en tête, se met à courir à travers les prés. Mais l’opération de séduction va échouer. L’éleveur n’arrivera pas à faire monter une vache et son veau dans la bétaillère. Le troupeau préfère rester près du petit ruisseau, le Piétrebais, qui longe le domaine de la Ferme du Petit Sart.

En ce mois de juillet, l’orage ne couvait pas encore. Il a éclaté fin août quand le propriétaire de la Ferme du Petit Sart a appris que la Province du Brabant wallon veut construire un bassin d’orage sur le Piétrebais et sur ses terres. Le conflit n’est pas nouveau. Il y a une petite dizaine d’années déjà, il était question d’exproprier trois hectares pour la construction de ce bassin. Hubert del Marmol avait gagné devant le Conseil d’État. Inonder des terres avec des eaux polluées par les hydrocarbures aurait ruiné son activité d’éleveur bio et le Conseil d’État avait aussi relevé l’intérêt paysager du site. Cette fois, la menace est bien plus grave car elle vise 11,8 hectares sur les 13 hectares de pâturage que possède le propriétaire de la Ferme du Petit Sart, autant dire tout. Or la vente en circuit court de la viande de vaches limousines est la ressource financière essentielle de l’agriculteur. Ce qui signifierait alors la fin de son activité et de celle de Générations.bio, qui a reçu cette année le prix du Développement durable de la Loterie nationale. Générations.bio, c’est notamment un projet de «couveuse de maraîchers bio» qui s’inscrit dans la trajectoire personnelle de ses fondateurs.