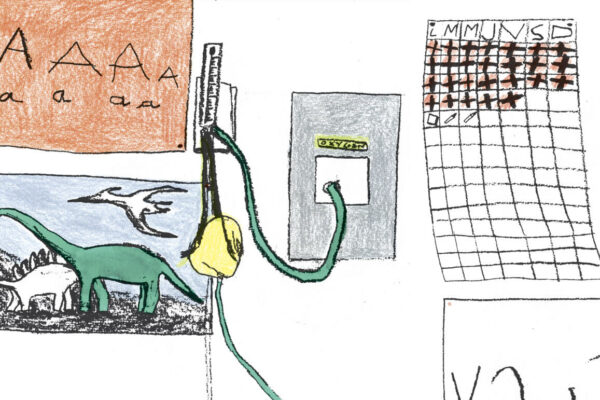Déçus par les grèves et manifestations, certains militants sont-ils tentés de trouver d’autres moyens d’action moins « consensuels » ?
Manifestations, grèves. Depuis la mise sur pied du « nouveau » gouvernement fédéral en 2014, le front commun syndical a multiplié les actions afin d’instaurer un rapport de force censé faire revenir Charles Michel et ses ministres sur certaines de leurs décisions. Sans résultat palpable aux yeux des militants, bien souvent. Et quand l’équipe gouvernementale accepte tout de même de s’asseoir à la table des négociations, le résultat ne serait guère plus concluant. « En Belgique, une action syndicale est jugée efficace quand elle mène à une négociation collective, explique Bruno Bauraind, secrétaire général du Groupe de recherche pour une stratégie économique alternative (Gresea). Or aujourd’hui cette négociation collective est très encadrée, l’espace de négociation des syndicats y est faible… »
Face à ce double constat, un sentiment diffus semble se répandre chez certains militants : les manifestations, les grèves, tout cela ne servirait plus vraiment à grand-chose. Au point de les pousser à plus de « radicalité » ou de les inciter à opter pour d’autres moyens de contestation ?
La violence paie ?
« L’idée que la violence paie est très présente. » Le titre de l’interview est sans équivoque. Publié sur le site du quotidien Libération, cet entretien avec la sociologue Isabelle Sommier – professeure de sociologie à l’Université Paris-I Panthéon-Sorbonne et spécialiste des mouvements sociaux – évoque la situation tendue que connaît la France depuis quelques semaines à la suite de l’émergence du mouvement des gilets jaunes. « Les réponses tardives d’Emmanuel Macron et d’Édouard Philippe ont exaspéré les gilets jaunes et conforté l’idée chez certains que le recours à la violence était nécessaire pour être audible », affirme Isabelle Sommier au cours de l’entretien.
« Un mouvement, s’il veut faire aboutir des revendications, doit faire peur. » Bruno Bauraind, Gresea.
Les « résultats » engendrés par le mouvement ont aussi pu venir conforter cette impression. Si on peut discuter de l’ampleur des concessions faites par le président français, il n’empêche que les gilets jaunes, malgré leur faible nombre en rue – quelques dizaines de milliers de personnes à l’échelle d’un pays de 67 millions d’habitants – sont parvenus à obtenir des avancées que des syndicats français n’auraient peut-être pas obtenues en mettant plus de monde dans les rues. « Grâce » à la violence ? « C’est une question vieille comme le capitalisme, analyse Bruno Bauraind. Un mouvement, s’il veut faire aboutir des revendications, doit faire peur. Les gilets jaunes ont compris cela. Et cela interroge les syndicats. »
Attention : en Belgique et en France, les situations sont très différentes. D’après les chiffres de l’OCDE, en 2015 le taux de syndicalisation était de 54,2 % en Belgique contre… 7,9 % en France – même si ce chiffre peut notamment s’expliquer par le fait qu’en Belgique les syndicats servent de caisse de paiement pour les allocations de chômage, ce qui pousse les gens à s’affilier. Or on connaît le rôle de « catalyseur » de la colère rempli par les syndicats dans le cadre des conflits sociaux, ainsi que leur capacité à faire « atterrir » certains mouvements et certaines revendications. Dans un contexte de grande faiblesse syndicale outre-Quiévrain, il n’y a donc rien d’étonnant qu’un mouvement comme les gilets jaunes puisse naître plus facilement et opter pour des actions moins « institutionnalisées » que la manifestation ou la grève. Alors qu’en Belgique, où les syndicats sont encore forts, le mouvement des gilets jaunes paraît plus anecdotique. Ce qui n’empêche pas ses secousses de venir y faire trembler les syndicats. « Les gilets jaunes reprochent aux syndicats d’être trop institutionnalisés. Ils leur disent ‘Vous négociez, mais on n’en voit plus le résultat’. Ils veulent des actions plus directes », continue Bruno Bauraind. Avant de préciser que la notion de résultat est toutefois à nuancer. « Cela veut dire quoi être efficace ?, s’interroge-t-il. Pour un syndicat, certaines actions sont aussi faites pour maintenir leur position dans le jeu institutionnel… »
Trop d’institutionnalisation ?
Et si c’était justement dans l’institutionnalisation que résidait le problème ? En Belgique pourtant, le phénomène n’est pas nouveau. La contestation sociale « a été institutionnalisée dès le début du XXe siècle. La pratique d’action collective a très tôt été dirigée vers la concertation sociale, la négociation collective », explique Bruno Bauraind. Il en est de même pour la manifestation ou la grève « qui, dès lors qu’elle a été acceptée, est entrée dans une structure qui lui a fait perdre de l’efficacité », estime Bruno Frère, chargé de cours en sociologie à l’ULg. Avant d’ajouter : « À partir du moment où des actions sont illégales, elles ont un pouvoir de transformation, parce que l’État, les patrons se sentent menacés. »
« À l’heure actuelle, le débat tourne beaucoup autour des modes d’action, mais pas autour du fait que les décideurs n’écoutent plus… » Marie-Hélène Ska, CSC.
Pourtant, malgré cela, ces « outils » semblent avoir fonctionné pendant des décennies. Qu’est-ce qui a donc changé ? Pour Robert Vertenueil, président de la FGTB, une des réponses est peut-être à aller chercher du côté du regard que l’on porte sur ces actions, justement. « On nous dit que la grève, ce n’est pas transgressif. Mais ça l’est. Cela coûte des millions à l’économie. Mais une partie de la population ne le voit pas comme ça, elle se dit qu’elle a perdu de l’argent, du temps, etc. », analyse-t-il.
Marie-Hélène Ska, secrétaire générale de la CSC, elle, va un pas plus loin : « À l’heure actuelle, le débat tourne beaucoup autour des modes d’action, mais pas autour du fait que les décideurs n’écoutent plus… » À l’entendre, c’est l’attitude de ces décideurs qui a changé. Un point que confirme Robert Vertenueil. « Il y a quelques années, quand il y avait une action d’envergure, le gouvernement appelait le lendemain pour qu’on discute. Aujourd’hui, il attend et finit par faire ce qu’il veut », admet le secrétaire général de la FGTB.
Une attitude qui créerait de la frustration dans les rangs des militants. Qui, face à cette surdité, pourraient être tentés par plus de « radicalité ». « Je ne cautionne pas, mais, quand les gens manifestent et qu’ils ont l’impression d’être pris pour des gugusses, ils se radicalisent. Toute cette situation va nous pousser à prendre un rôle de subversion », analyse Robert Vertenueil. Cette voie vers plus de radicalité pourrait-elle vraiment être suivie par les syndicats ? Pas vraiment si l’on en croit Bruno Frère. « Si les syndicats se mettent à donner un blanc-seing à des actions violentes, ils risquent de perdre leur position institutionnelle et leur possibilité de négocier ce qui peut encore l’être », analyse-t-il.
« On nous dit que la grève, ce n’est pas transgressif. Mais ça l’est. » Robert Vertenueil, président de la FGTB.
Autre difficulté pour les syndicats : être dans la capacité d’assembler et d’organiser une « classe précaire » composée par des individus connaissant des réalités très différentes. Quel point commun existe-t-il effectivement entre un ouvrier métallurgiste et une travailleuse de centre d’appels ? Une situation qui n’existait pas il y a cinquante ans où la « classe ouvrière » paraissait plus « homogène ». « Les statuts se sont fortement diversifiés, et ils ne se reconnaissent pas forcément entre eux alors qu’ils ont en commun une forme de précariat », analyse Bruno Frère. « Esseulés », ne se sentant plus représentés par des structures ayant du mal à « collectiviser » le conflit, ces « nouveaux statuts » peuvent dès lors être tentés de prendre leur sort en main via des structures ou des modes d’action moins « classiques ».
Le retour de la désobéissance civile
Les syndicats semblent donc coincés. D’autant plus que de « nouvelles conflictualités » sont apparues entre-temps : écologistes, féministes, « zadistes ». Autant de nouveaux champs d’action dont les conflictualités « ne se situent plus – que – sur le travail », explique Bruno Frère. Des sujets qui sont aussi portés par des générations parfois plus jeunes « qui ne sont plus forcément prêtes à suivre des appareils. Les jeunes sont très engagés, mais ils ne suivent plus de mouvement. Ils défendent des causes », admet Robert Vertenueil.
« Il ne faut absolument pas que la désobéissance civile soit institutionnalisée. » Stéphanie Demblon, Agir pour la paix.
Dans ce contexte, la tentation d’opter pour d’autres modes d’action est forte. Si elle existe depuis très longtemps, la désobéissance civile (voir encadré) a de nouveau le vent en poupe ces derniers temps. Une désobéissance civile qui n’a quant à elle rien d’institutionnel puisqu’elle revendique clairement le fait d’enfreindre une loi pour faire entendre sa voix. « Il ne faut absolument pas que la désobéissance civile soit institutionnalisée, cela n’aurait plus aucun sens ni aucun impact, même si nous prendrions sûrement moins de risques au niveau légal », estime Stéphanie Demblon, qui travaille pour l’asbl Agir pour la paix. Reconnue par la Communauté française, cette association donne notamment des formations à la désobéissance civile. « Absolument pas anti-démocratie, parce qu’elle met l’État devant certaines de ses contradictions », la désobéissance civile se veut « publique, assumée, intentionnelle et non-violente », continue Stéphanie Demblon. Un mode de fonctionnement qui plaît visiblement puisque la travailleuse acquiesce quand on lui demande si ce mode d’action connaît un regain d’intérêt. « En même temps, c’est cyclique, continue notre interlocutrice. Il y a 15 ans, il y avait déjà 2.000 personnes à Kleine-Brogel (base de la Force aérienne belge) pour une action de désobéissance civile contre les ogives nucléaires américaines qui y sont entreposées. »
Il n’empêche, « le sentiment d’impuissance actuel, peut-être plus grand, fait qu’on en reparle », admet Stéphanie Demblon. De même que le mode de fonctionnement intrinsèque de ces actions ? Si l’on en croit Stéphanie Demblon, les actions de désobéissance civile sont « collectives, non hiérarchiques et permettent à tout le monde de se sentir impliqué. Il y a une sorte d’emporwerment très fort ». Des caractéristiques visiblement susceptibles de plaire à des générations de jeunes militants en recherche de moins de verticalité. Attention cependant : cela ne signifie pas pour autant que ceux-ci sont prêts à abandonner des modes d’action plus « classiques ». « Quand je vois les jeunes qui manifestent pour le climat, je constate que ce que l’on présentait comme ringard il y a peu redevient tendance », ironise Marie-Hélène Ska.
Plus globalement, toute action semble devoir se penser dans une stratégie plus complexe, que l’on parle de manifestation et de désobéissance civile. « Je ne connais personne qui choisisse la désobéissance civile de manière exclusive, souligne Stéphanie Demblon. Cela s’inscrit dans une stratégie où l’on fait des manifestations, des pétitions, des cartes blanches, etc. » Le tout dans le but de tendre vers plus d’efficacité ? Il faut voir. « Sur les cinq dernières années, on n’a peut-être pas beaucoup progressé, mais nous avons prouvé que nous ne nous résignons pas. Vous pensez que les gens qui manifestent pour le climat vont obtenir un effet à court terme ? Nous continuerons aussi longtemps qu’il le faut », conclut Marie-Hélène Ska.