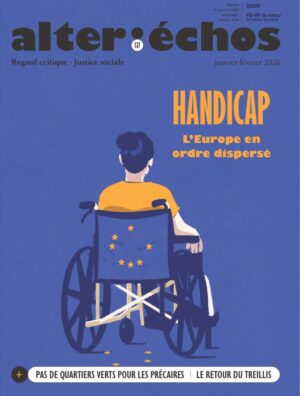Alter Échos: Vous évoquez la disparition du maillage ouvrier et associatif comme l’une des causes majeures de la déconnexion de la gauche avec les classes populaires. Quels éléments de ce maillage vous semblent aujourd’hui les plus urgents à reconstruire?
Jérôme Van Ruychevelt Ebstein: L’enjeu prioritaire, c’est de remettre des gens ensemble. Réunir des personnes, leur permettre de discuter de leurs problématiques et de leur vécu partagé, c’est subversif par rapport au modèle politique actuel. Ce processus permet de recréer une conscience de classe: on réalise qu’on n’est pas seul à vivre telle difficulté, qu’il y a des causes systémiques derrière nos problèmes. La seule façon de s’en sortir, c’est de se coaliser, de trouver des solutions ensemble. Ce sentiment collectif, on l’a largement perdu. Il faut donc multiplier les «foyers chauds», ces espaces où la solidarité se vit au quotidien. C’est la base pour reconstruire un lien fort avec les classes populaires.
AÉ: Vous insistez également sur la fracture culturelle entre une élite progressiste et les classes populaires. Comment cette fracture s’est-elle concrètement manifestée lors de vos expériences de terrain en Belgique francophone?
JVRE: Les symptômes sont visibles partout. Prenez les mutualités: aujourd’hui, quand un affilié pousse la porte, il a l’impression d’entrer dans une administration froide, où le lien social et affectif a disparu. On a perdu la symétrie qui existait entre travailleur et affilié, alors qu’ils vivent souvent des réalités similaires. Ce lien social, affectif, «chaud» a disparu, conséquence d’un processus de déconnexion structurelle. On observe la même chose avec l’écologie: les politiques comme les zones à faibles émissions sont perçues comme imposées par une élite, sans ancrage local, sans que les premiers concernés prennent la parole. Cela alimente la défiance et renforce la fracture.
Prenez les mutualités: aujourd’hui, quand un affilié pousse la porte, il a l’impression d’entrer dans une administration froide, où le lien social et affectif a disparu.
On a perdu la symétrie qui existait entre travailleur et affilié, alors qu’ils vivent souvent des réalités similaires.
AÉ: Vous parlez d’ailleurs d’un langage «froid» et d’un manque d’affect dans les discours de gauche…
JVRE: Oui, c’est flagrant. Sur la suppression des allocations de chômage après deux ans, on a beaucoup cité des chiffres, des statistiques sur les personnes exclues, les coûts pour les communes… Mais tant qu’on ne raconte pas d’histoire, qu’on ne met pas de visages, cela ne touche pas. À l’inverse, quand la FGTB a raconté l’histoire d’une caissière licenciée après 35 ans de carrière qui sera rayée du chômage dans deux ans; là, la dimension morale et émotionnelle a ressurgi. Les gens se sont sentis concernés. C’est pareil pour la réforme du conventionnement en santé: le langage est incompréhensible pour les affiliés, alors que cela aura un impact concret sur leur vie. Ce manque d’ancrage local et d’émotion limite la capacité à mobiliser.
AÉ: La notion de «personnalités-ponts» revient aussi dans votre analyse. Quelles qualités devraient avoir ces figures? En voyez-vous émerger actuellement?
JVRE: Les personnalités-ponts existent déjà dans nos structures: délégués syndicaux, guichetiers investis, animateurs de quartier… Ce sont des personnes capables de dialoguer avec des publics différents, de s’adapter, d’écouter sans juger. Chez les Gilets jaunes, on a vu émerger des figures capables de faire le lien entre des mondes différents. Parmi les élus, je pense à l’ex-députée Zoé Genot, très investie dans son quartier. Militer, c’est aussi fréquenter des gens différents de soi, accepter de se transformer au contact des autres et de s’adapter à des valeurs différentes. C’est essentiel.
Militer, c’est aussi fréquenter des gens différents de soi, accepter de se transformer au contact des autres et de s’adapter à des valeurs différentes. C’est essentiel.
AÉ: Quelles initiatives locales ou formes de mobilisation vous paraissent les plus prometteuses actuellement?
JVRE: Je vous donne quelques exemples récents concrets qui m’ont marqué. Les mutualités remettent en place des groupes de patients, pour politiser la santé à partir du vécu. Dans les Marolles, à Bruxelles, des locataires se sont mobilisés pour racheter leur immeuble et lutter contre la gentrification. Il faut aller soutenir ce genre d’initiative. Dans le syndicalisme, des efforts sont faits pour recréer des moments collectifs, comme à l’ULB où des travailleuses du nettoyage ont été invitées à partager leur pause-déjeuner, ce qui a tout changé dans la dynamique de lutte. Ces initiatives montrent que, quand on se retrouve, on peut passer de l’impuissance à l’action collective. Les personnes concernées passent d’un sentiment d’isolement à la conviction qu’ensemble, elles peuvent améliorer leurs conditions matérielles et gagner des droits concrets. C’est un défi, car la numérisation et l’individualisme ont fragmenté les liens sociaux. Mais il y a toujours un besoin fondamental d’empathie et d’écoute. Les initiatives qui fonctionnent partent de ce besoin: groupes de parole, syndicalisme de quartier, entraide locale. Il ne s’agit pas de remobiliser tout le monde du jour au lendemain, mais de répondre à ce besoin d’être entendu, de recréer des espaces d’empathie. Cela comble un besoin humain fondamental. Les initiatives efficaces sont celles qui partent de ce besoin empathique, avant même la volonté d’agir collectivement.
Ces initiatives montrent que, quand on se retrouve, on peut passer de l’impuissance à l’action collective. Les personnes concernées passent d’un sentiment d’isolement à la conviction qu’ensemble, elles peuvent améliorer leurs conditions matérielles et gagner des droits concrets. C’est un défi, car la numérisation et l’individualisme ont fragmenté les liens sociaux.
AÉ: En quoi la situation belge se distingue-t-elle de celle d’autres pays européens?
JVRE: La Belgique francophone s’est distinguée par deux facteurs: le maintien d’un cordon sanitaire contre l’extrême droite et la densité relative de son tissu associatif, notamment via l’éducation permanente. Cela a permis de capter les publics les plus précaires. Mais aujourd’hui, la tranche supérieure des classes populaires, les travailleurs salariés, échappe aux radars de la gauche et glisse vers la droite populiste, comme on l’a vu ailleurs en Europe. Il y a donc urgence à agir. Pour la droite populiste, il y a encore une réserve de voix importante du côté PS et PTB, la «part de marché» à conquérir, c’est la caissière, le travailleur salarié, les petits indépendants qui se sentent de plus en plus attirés par les discours populistes et par cette droite qui a su capter l’attention des classes populaires en moralisant les débats, en offrant reconnaissance et fierté à des publics délaissés, en activant la peur de la menace «venue d’en bas» et surtout en racontant une histoire là où la gauche s’est perdue dans l’expertise et a abandonné la quête transformatrice de la société.
«Pourquoi les narratifs de gauche ne touchent plus les classes populaires» est disponible gratuitement en téléchargement: https://cecinestpasunecrise.org/wp-content/uploads/2025/03/Pourquoi-les-narratifs-de-gauche-ne-touchent-plus-les-classes-populaires_VdefWeb.pdf