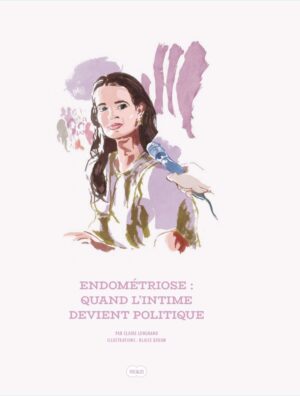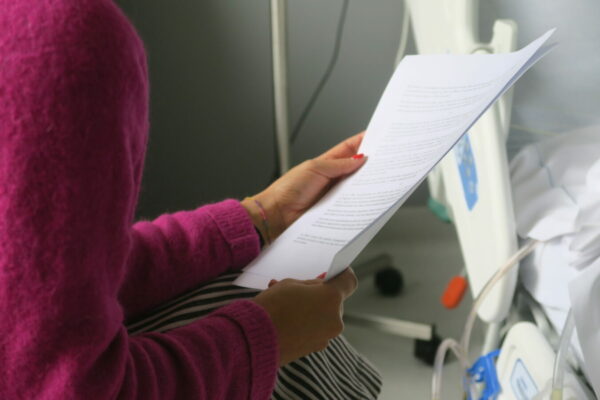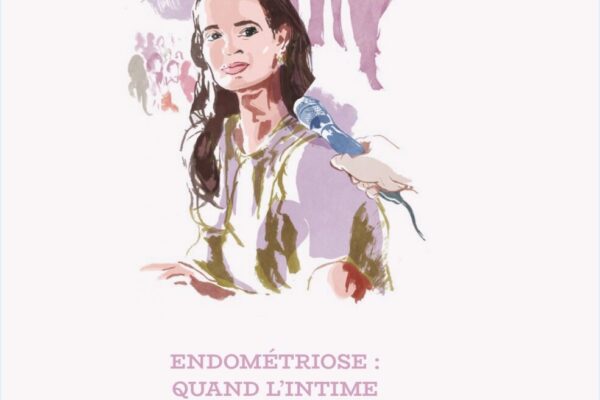«La porte du bonheur est une porte étroite… On m’affirme aujourd’hui que c’est la porte à droite»… chantait du haut de ses belles bacchantes Jean Ferrat, déplorant dans les années 80 l’abandon des idéaux de gauche au nom de la réalité économique.
Quarante ans plus tard, la déprime à gauche n’est plus un simple ressenti, c’est un fait social. En Belgique comme ailleurs, les progressistes affichent un moral en berne, et les causes de ce malaise sont aussi profondes que multiples. Les dernières élections, la montée de la droite et de l’extrême droite, l’incapacité à former des coalitions progressistes solides: tout semble concourir à renforcer ce sentiment d’impuissance et de découragement qui traverse aujourd’hui le camp de ceux qui, hier encore, portaient l’espoir d’un monde meilleur.
L’idée que les personnes de gauche seraient, en moyenne, moins heureuses ou plus sujettes à la déprime que celles de droite n’est plus seulement un cliché. De nombreuses études internationales l’attestent, et cette tendance se retrouve dans toutes les démocraties occidentales, quel que soit le niveau de richesse, d’éducation ou d’âge. Pourquoi? Parce que la gauche, par empathie, porte le poids des injustices du monde. Parce qu’elle se prive, souvent, de repères structurants (religion, famille, institutions) qui donnent sens et stabilité à la vie de nombre de leurs opposants conservateurs. Parce que la lucidité sur les inégalités, l’éco-anxiété, la défiance envers les institutions, finissent par miner la capacité à croire au changement.
Ce constat, loin d’être anecdotique, résonne fortement dans l’actualité politique et sociale belge, où ce mal-être prend une acuité particulière. La gauche, divisée, n’est plus dominante en Wallonie et quasi marginalisée en Flandre. Les alliances sont impossibles, les projets communs introuvables, et la droite – voire l’extrême droite – impose son agenda. À Bruxelles, la paralysie politique est telle que la Région semble ingouvernable. Pendant ce temps, les réformes portées par la majorité fédérale, dominée par la droite nationaliste et libérale, s’attaquent aux piliers historiques de la gauche: sécurité sociale, retraites, allocations de chômage. Les syndicats multiplient les grèves, mais rien n’y fait: la trajectoire politique ne dévie pas. Cette dynamique s’accompagne d’un discours dominant qui stigmatise certaines valeurs de gauche (solidarité, multiculturalisme, redistribution), rendant leur défense plus difficile, voire impopulaire.
Les partis de gauche, en Belgique comme ailleurs en Europe, souffrent d’une crise de leadership et d’un manque de projet mobilisateur. À en croire les politologues, ils ont perdu le contact avec leur base traditionnelle et peinent à proposer une vision claire et attractive pour l’avenir. Faut-il alors se résigner à la fatalité de la déprime à gauche? Certainement pas. L’histoire montre que la gauche, lorsqu’elle parvient à transformer sa lucidité douloureuse en action collective, peut redevenir une force d’espérance. Pour sortir de cette impasse, il ne suffira pas de dénoncer la montée de la droite ou de multiplier les appels à l’unité. Il faudra que la gauche retrouve un récit qui dépasse ce sentiment de décalage. Car, comme le rappelait un manifestant interrogé à la télé lors de la dernière mobilisation contre la réforme des pensions en juin: «On ne peut pas vivre seulement de défaites et d’indignation.»