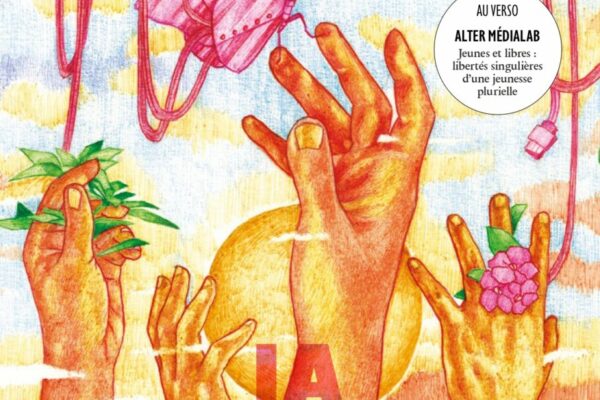Encore mineurs ou ayant à peine atteint l’âge de la majorité, de nombreux jeunes, belges ou étrangers, errent entre un canapé de fortune, des structures d’accueil d’urgence et la rue. Ils ont échappé ou ont été lâchés par les dispositifs d’aide et suscitent l’inquiétude des travailleurs sociaux. Lesquels se mobilisent afin d’élaborer des dispositifs pour les raccrocher au système.
«J’ai trouvé une fois un parc, j’avais ma couette et j’ai dormi sur un banc, la deuxième fois dans un garage et les autres fois c’était vraiment dehors dehors, dans des gares… J’étais toute seule, j’avais peur quand même parce que c’est le monde de la nuit, c’est différent, y a tous les SDF qui viennent voir si t’as pas à manger ou des pièces. Mais on dort pas beaucoup dans ces cas-là, c’est vraiment dormir une ou deux heures juste histoire de dire, se reposer.» C’est dans le cadre d’une recherche exploratoire1 menée en 2018 par le Forum-Bruxelles contre les inégalités sur la problématique des «jeunes en errance» que cette jeune fille confie son angoisse de la nuit en rue. (Tous les témoignages de jeunes dans cet article sont issus de cette étude.) Comme elle, de nombreux adolescents ou jeunes adultes endurent les embûches d’un parcours marqué par une instabilité de logement – voire un long parcours en rue – et un décrochage des institutions censées les protéger. Si leur nombre est difficile à estimer (voir encadré), «tous les voyants sont au rouge», alerte Bernard De Vos, délégué général aux Droits de l’enfant.
Le sans-abrisme chez les jeunes et les enfants en quelques chiffres:
- En 2018, le Samusocial a hébergé 7.780 personnes, dont 13,6% de mineurs (la plupart du temps en famille) et 22,2% de jeunes de 18 à 26 ans. La même année, 31 jeunes adultes étaient encadrés dans le projet d’accompagement dans le logement Step Forward (26 étaient toujours dans le logement fin d’année).
- Lors du dénombrement organisé le 5 novembre 2018 par la Strada, 4.187 personnes sans abri ou mal logées ont été décomptées, dont 612 mineurs. Parmi ces derniers: 20 ont été identifiés dans l’espace public, 227 en hébergement d’urgence et de crise, 18 à la Plateforme citoyenne, 256 en maison d’accueil, 11 en squat et 72 en occupations négociées. Entre 2016 et 2018, le nombre de mineurs recensés dans les hébergements d’urgence et de crise a explosé, passant de 149 à 245 (+64%).
- En 2016, les 15 maisons d’accueil de la Cocof ont comptabilisé 447 séjours pour des mineurs, soit 22% des séjours.
- Chaque année, 250 jeunes passent par l’hébergement d’urgence de l’AMO SOS-Jeunes. En 2018, 34% d’entre eux ont déclaré avoir vécu un épisode de vie en rue, contre 1,8% en 2004 (!). Ces données excluent le public des mineurs étrangers non accompagnés (Mena), qui, s’il est pris en compte, fait exploser le chiffre.
Incasables vs éjectables
Exclus de leur milieu familial, en fugue, avec un passé de sans-abrisme avec leurs parents, en situation d’exil ou en rupture avec les services d’aide à la jeunesse, les motifs de l’errance chez les jeunes sont multiples. Mais toutes les situations ont en commun la perte de réseaux familiaux et le décrochage des structures d’aide. C’est ce qu’explique Hugo Lantair, coordinateur du service d’aide en milieu ouvert SOS Jeunes, ouvert 24/24 h et qui propose des lits d’urgence à des jeunes en galère: tous les jeunes – hors mineurs étrangers non accompagnés, Mena – qui passent par ce service d’hébergement et qui ont déjà vécu un épisode de vie en rue étaient en fait suivis par les services d’aide ou de protection de la jeunesse.
«L’aide à la jeunesse dit qu’il n’y a pas plus de 5% de son public qui lui échappe. Nous sommes assez d’accord avec ce chiffre, qui n’a sans doute pas beaucoup évolué. Par contre, ce qui a changé, c’est l’inclusion de ce public: aujourd’hui, on en est arrivé à se dire qu’on pouvait le laisser en rue!» Hugo Lantair, SOS-Jeunes
Souvent placés dès leur plus jeune âge, ils connaissent dès leurs 10-12 ans des ruptures avec ces milieux de vie, dont ils sont exclus ou dont ils s’enfuient. «Après une dizaine de placements, vers 15-16 ans, les services se trouvent dans l’impuissance face à ces jeunes, et ces derniers sont dans le refus. Il y a de moins en moins de confiance réciproque. Or comme les services d’aide et de protection de la jeunesse sont confrontés en permanence à de nouveaux entrants, ils font le choix de laisser ces jeunes ‘gérer leur vie’ et se concentrent sur les nouvelles situations.» Étiquetés par les pouvoirs publics d’«incasables», ces adolescents sont en fait lâchés par un système débordé et dépassé. Une démission des institutions dont témoigne cette jeune fille de 17 ans: «[…] Même en institution quand j’étais placée, chaque pas que j’essayais de faire, ils me cassaient sur ma lancée. Ils me disaient que ça allait pas être possible, que je devais suivre les règles, etc. Mais leurs règles ça sert à rien et puis j’ai été renvoyée du centre, et là ils m’ont laissée à la rue. Quand ils m’ont virée, ils savaient qu’ils me mettaient dehors…»
«L’aide à la jeunesse dit qu’il n’y a pas plus de 5% de son public qui lui échappe, poursuit Hugo Lantair. Nous sommes assez d’accord avec ce chiffre, qui n’a sans doute pas beaucoup évolué. Par contre, ce qui a changé, c’est l’inclusion de ce public: aujourd’hui, on en est arrivé à se dire qu’on pouvait le laisser en rue!» En décrochage scolaire, mais aussi de leurs réseaux – familial, culturel ou sportif –, «ces jeunes passent au travers de tout ce qui est mis en place pour les rattraper et vivent dans les replis du monde».
Pour d’autres, la vie bascule un peu plus tard, au moment de la majorité et du passage entre l’aide à la jeunesse et l’aide sociale pour adultes: à l’inversion de la logique d’aide (les mineurs ont – en principe – des droits quasiment illimités tandis que les majeurs doivent remplir des obligations pour y accéder) s’ajoutent un manque de confiance toujours plus aigu envers les intervenants sociaux, des problématiques d’assuétudes et des rythmes de vie dissolus.
L’errance dans l’exil
Le tableau du sans-abrisme chez les jeunes ne serait pas complet sans évoquer les mineurs «en transit» dont une part importante se dérobe elle aussi aux structures d’accueil publiques (Fedasil) ou associatives. Originaires du Soudan, d’Égypte, d’Érythrée, de Syrie ou encore du Maghreb, certains oscillent entre une demande d’asile en Belgique ou une poursuite de leur route vers l’Angleterre; d’autres errent, sans but, d’une ville à l’autre. «Avant 2015, les jeunes demandeurs d’asile étaient peu visibles et beaucoup moins nombreux, se remémore Laurence Bruyneel, qui coordonne la cellule «Mena-tuteurs» chez Caritas international. La plupart débarquaient directement à l’Office des étrangers, ils étaient même déposés à la porte par leur passeur. S’ils arrivaient en Belgique le 15 et que leur demande était déposée le 17, on s’inquiétait de ce qui s’était passé pendant deux jours. Aujourd’hui ils se retrouvent à la rue, à la Porte d’Ulysse ou sont hébergés en famille. Il y a pourtant souvent assez de places dans les centres d’orientation et d’observation de Fedasil. Ce n’est pas un problème de places, mais c’est plutôt que ces jeunes ne sont pas sûrs de vouloir rester.»
Le nombre des jeunes migrants non demandeurs d’une protection est lui aussi difficile à apprécier. En 2019, sur les 500 à 600 jeunes en contact avec SOS-Jeunes, présents à la Porte d’Ulysse et au hub humanitaire, seuls 12% décident d’entamer une démarche en vue de rester en Belgique (un chiffre à prendre avec beaucoup de pincettes car il recouvre des personnes qui se déclarent mineurs et ne le sont pas forcément, ou qui sont sur le point d’être majeurs). La même année, sur les 150 jeunes Mena informés par Caritas, après un premier contact avec SOS-Jeunes, la moitié acceptent d’entamer une procédure.
Parfois âgés de pas plus de 10 ou 12 ans, ils ont quitté leur pays d’origine où ils vivaient dans une extrême pauvreté, avec, déjà, un parcours de rue. Ici, ils baignent dans le trafic de médicaments et les casses de pharmacies, avec aucune perspective légale en vue.
Ce public de «non-demandeurs» serait de plus en plus touché par des problèmes de consommation – et notamment de médicaments. C’est le constat posé par l’asbl Synergie14, qui s’adresse aux jeunes en exil et en particulier aux «non-demandeurs», et qui dispose de 14 places d’hébergement pour «des jeunes en situation de crise». Sanni Hamoud, éducateur: «C’est notre grand défi: ces jeunes sont amochés par le produit qu’ils consomment et nous avons des difficultés à les remettre dans le système.» Ces non-demandeurs, parmi lesquels de nombreux Maghrébins, font la tournée des villes européennes sans autre projet que celui de survivre. «Ils voyagent en Europe, souvent au départ du Maroc, et peuvent remonter jusqu’en Scandinavie. Puis ils redescendent. Certains se sont connus au Maroc, d’autres au Danemark, en Allemagne. Il y a une petite solidarité entre eux, qui prend fin quand un membre du groupe se retrouve en IPPJ.»
Si, pour Synergie14, la problématique des assuétudes chez les Mena a pris de l’importance depuis 2019, celle «des jeunes Maghrébins non demandeurs n’est pas neuve, rappelle Laurence Bruyneel. En 2005 on en voyait déjà régulièrement. C’est justement ce profil qui se faisait attraper par la police de Zeebrugge». La nouveauté se situe plutôt dans le rajeunissement de ces gamins. Parfois âgés de pas plus de 10 ou 12 ans, ils ont quitté leur pays d’origine où ils vivaient dans une extrême pauvreté, avec, déjà, un parcours de rue. Ici, ils baignent dans le trafic de médicaments et les casses de pharmacies, avec aucune perspective légale en vue. «Ils ont un système de débrouille assez bien foutu, dépeint Bernard De Vos. Ils sont assez autonomes, ils ont l’habitude de vivre dans la rue. Du coup, ils sont très méfiants, inabordables. Et tout le monde s’inquiète: l’asbl Bravvo, Philippe Close, les CPAS.» Hedwige de Biourge, responsable de la cellule Mena de Fedasil, renchérit: «Ils arrivent au centre d’arrivée (le Petit-Château à Bruxelles) après avoir été interceptés par la police. Ils ne veulent pas de l’accueil, mais on ne peut pas prendre la responsabilité de les remettre à la rue. Quand ils sont très jeunes, nous interpellons le Parquet. Si aucune mesure n’est prise, ils repartent. On fait donc un avis de disparition. Ils vivent dans des squats, entre enfants ou avec des adultes dont ils seraient parfois exploités. Un accueil collectif et générique comme celui de Fedasil n’est pas du tout adapté.» Au nombre de 30 à 40, selon Hugo Lantair, ces enfants se déplacent sur le territoire au gré des interventions policières.
Après une première réunion fin janvier, une seconde table ronde intersectorielle – aide à la jeunesse, migration, aide sociale de première ligne – devrait (aurait dû, au vu de l’actualité…) se tenir à la fin du mois de mars afin d’envisager des réponses adéquates pour ces enfants des rues. «Ce qu’il faudrait, estime le délégué général aux Droits de l’enfant, c’est la mise sur pied d’un lieu à très bas seuil d’accès et l’intensification du travail de rue de proximité, dans l’intérêt de ces enfants et non dans celui de la sécurité. Car s’ils ne sont pas en demande, ils sont en danger.»
Une méfiance à casser
Belges ou en exil, chez les jeunes en errance, la méfiance est de mise. Pour restaurer cette confiance abîmée, le travail de SOS-Jeunes se fait sans mandat – si ce n’est celui du jeune. Des activités «prétextes» (cuisine, sport, art) replacent les ados au centre de l’action, renforcent le lien ainsi que l’image qu’ils ont d’eux-mêmes. Une image souvent dégradée, comme l’exprime ce jeune homme de 19 ans: «À 3 heures du matin, quand tu regardes l’heure sur le grand écran à la Bourse et que t’attends l’heure du premier métro pour prendre le métro et pouvoir dormir, et à midi tu recommences, rebelote, épuisé, t’as plus de force, t’es sale… C’est un peu tout, tu deviens parano, quand j’étais dehors, pour moi, tous les gens me regardaient et pensaient que j’étais un connard, un moins que rien du tout, mais au fait pas du tout.»
Créer cette accroche est aussi au cœur du travail de Filip Keymeulen, de l’asbl Diogènes, service bruxellois de travail de rue pour les personnes sans abri. Un travail de tous les instants, qui peut prendre du temps. Le travailleur social évoque par exemple sa rencontre avec une jeune fille au cours de ses tournées nocturnes dans le quartier d’«Yser»: lors de leur première conversation, elle est en train de nettoyer sa pipe à crack. Elle a 16 ans, mais traîne en rue depuis au moins deux ans. Aux aguets, elle pose de nombreuses questions. Peu à peu la sauce prend. Un café, un hamburger. Et puis se tisse progressivement un fil qui demeurera fragile, tant cette jeunesse en errance est peu visible et en mouvement perpétuel, créchant tantôt chez un copain, tantôt en rue.
«La société ne sait pas trop quoi faire avec eux et les juge à cause du pied qu’ils ont mis dans la criminalité. Pourtant, c’est très important de les voir comme des jeunes.» Filip Keymeulen, asbl Diogènes.
Ce ne sera que bien plus tard – des mois, voire des années parfois – que les démarches concrètes pourront être entamées, à commencer par une remise en ordre administrative. «C’est très difficile de travailler avec eux sur cet accès aux droits», détaille Filip Keymeulen. Parce qu’ils bougent tout le temps, parce que c’est compliqué pour eux d’arriver à un rendez-vous à l’heure et avec les bons documents. Sans parler des trous temporels causés par des passages en IPPJ – s’ils sont mineurs – ou en prison – s’ils sont majeurs. «Il faut aussi parfois convaincre certains travailleurs sociaux de travailler avec eux. Car ils peuvent avoir des comportements un peu durs.» Et d’expliquer: «Ils vivent de la manche, de la prostitution, de vols, de la vente de drogues… Ils consomment. La société ne sait pas trop quoi faire avec eux et les juge à cause du pied qu’ils ont mis dans la criminalité. Pourtant, c’est très important de les voir comme des jeunes. Il y a finalement très peu de gens pour prendre leur défense.»
92% des jeunes de moins de 25 ans en contact avec les travailleurs de rue de Diogènes sont rencontrés dans le réseau Stib. Parmi eux, la moitié sont sans revenus, au moins la moitié ont des troubles de santé mentale, un tiers présentent des problèmes d’alcool et la moitié de toxicomanie. La débrouille, en ce compris la petite criminalité, est un mode de survie: «Faut trouver une manière de se rémunérer soi-même, avoir de l’argent pour se payer son manger; si tu manges pas, tu vas crever sur le trottoir, faut trouver à manger… Et après y en a qui choisissent de voler, y en a qui choisissent de vendre des drogues. Après, voilà, après la police s’étonne pourquoi y a autant de personnes en prison. Mais c’est des personnes très faibles, ils avaient pas le choix» (un jeune homme de 20 ans). Le travailleur de Diogènes conclut: «Ce qui est important, c’est le lien social. Ils sont parfois en rue depuis leurs 13 ans. Il faut travailler cette période, leur faire reconnaître que ce parcours n’était pas normal, que c’était dur!»
Accueil le jour et toit la nuit
Un dispositif d’accueil de jour: c’est l’une des requêtes exprimées par les jeunes consultés dans la recherche menée par le Forum-Bruxelles contre les inégalités. Cette même idée a germé dans la tête d’un groupe de professionnels de l’aide à la jeunesse, du sans-abrisme et de la santé mentale après qu’ils ont visité, à Montréal, le projet pour jeunes en itinérance «Chez Pop’s».
L’ambition est donc de mettre sur pied à Bruxelles un lieu «bas seuil» accessible aux jeunes de 16 à 25 ans afin qu’ils puissent venir «se poser». Le projet aurait également pour mission un accompagnement mobile des jeunes vers le réseau d’aide externe, de même que l’organisation de permanences de professionnels des secteurs de la santé, social, de milieux artistique ou manuel. «On pourra aussi y élaborer une analyse participative et poursuivre un travail de plaidoyer entamé par le Forum avec certains jeunes2, dans le but d’être au plus près des besoins», ajoute Fanny Laurent, chargée de mission au Forum.
Si cet espace a, a priori, été pensé à partir d’un public «belge, issu de l’aide à la jeunesse», il serait ouvert à tous. «On ne sait pas encore quel public se saisira du lieu et à quel moment. L’idée est de réfléchir à tous les publics, à toutes les problématiques. C’est pourquoi nous rencontrons pour le moment les acteurs des secteurs des assuétudes, de la migration et du travail de rue», précise Fanny Laurent. Aujourd’hui porté par le Forum, le projet devrait s’autonomiser en 2020. Des promesses orales de subsides ont été faites dans le chef du ministre bruxellois de l’Action sociale et de la Santé Alain Maron. L’objectif étant, à terme, d’engager d’une équipe de 14 ETP pour couvrir une ouverture du lieu de 6 h 30 à 22 h 30.
L’ambition est donc de mettre sur pied à Bruxelles un lieu «bas seuil» accessible aux jeunes de 16 à 25 ans afin qu’ils puissent venir «se poser».
Mais quid de l’après-22 h 30? «On a décidé qu’on ne pouvait pas répondre aux questions de logement et d’hébergement en interne, répond Fanny Laurent. C’est un problème structurel, et notre idée est plutôt de rassembler les forces en présence pour porter des revendications communes sur ce sujet.»
Aujourd’hui, des projets accompagnent des jeunes dans le logement – ex.: logements de transit mené par SOS-Jeunes en partenariat avec des agences immobilières sociales, projet «Housing First» pour les 18-25 ans en situation de sans-abrisme du Samusocial. D’autres sont en phase d’élaboration – l’asbl Capuche, un partenariat entre SOS-Jeunes, Abaka et Solidarité Logement, permettra de loger un public mixte de jeunes désaffiliés et de jeunes étudiants ou travailleurs. Mais ils demeurent insuffisants.
Et les travailleurs sociaux sont souvent contraints de patienter jusqu’à l’âge de la majorité du jeune pour lui donner accès à des projets de logement pour adultes. Quant aux possibilités de logement en autonomie en aide à la jeunesse, elles sont trop étriquées, selon Filip Keymeulen: «Le jeune doit suivre tout un parcours en institution avant d’y avoir accès.» Ce que confirme Hugo Lantair: «Tu dois être scolarisé, ne pas fumer de pétards, correspondre aux normes de ton centre et ensuite on te propose la mise en autonomie.» Et, l’un comme l’autre, de promouvoir la logique Housing First, peu exigeante en termes de conditions d’accès, le toit étant «le premier besoin auquel il faut répondre».
Quant à l’hébergement des Mena, d’aucuns suggèrent la création d’un centre spécifique pour assurer leur sécurité et répondre à leurs besoins primaires. Car, avec ou sans papiers, être confronté, dans des institutions pour adultes, à la rudesse de la vie en rue et à ses effets, a de quoi provoquer quelques sueurs froides: «T’as 24 piges, tu te retrouves dans un centre, et là tu vois des gens de 60 piges qui se shootent à l’héro, ça attaque le moral direct, direct tu te dis je vais finir comme ça, tu vois…»
1. Dans le cadre de la recherche «Jeunes en errance» (réalisée par Bénédicte De Muylder, septembre 2019), 55 jeunes ont été rencontrés via des focus groups et des entretiens individuels afin de livrer leurs réflexions sur la situation d’errance. À noter: les mineurs étrangers non accompagnés et les jeunes adultes sans papiers n’ont pas été pris en compte.
2. Voir le résultat de ce travail, sous la forme de capsules vidéo présentées au parlement bruxellois le 23 janvier 2020, sur http://www.le-forum.org/medias.