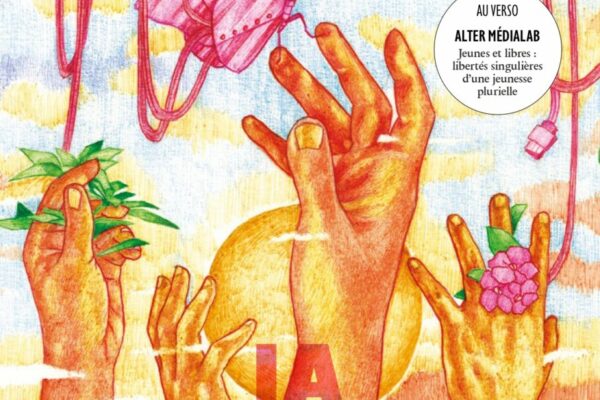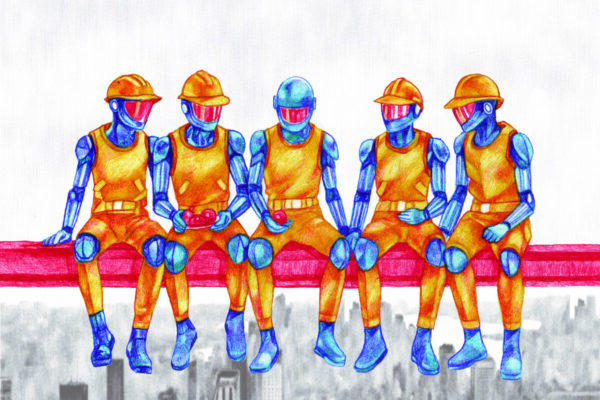«Je les vois souvent dans la rue. Pour moi, les jeunes militants d’aujourd’hui, et notamment ceux pour le climat, ce sont des petits bourgeois, qui ont fait l’université, qui ont des parents qui gagnent bien leur vie. Bref, qui n’ont pas trop de problèmes dans leur vie.» Ces mots d’un homme d’une cinquantaine d’années ont été entendus lors de la grande manifestation du 21 septembre 2022. Cette vision de la jeunesse militante, certains l’approuvent en la condamnant, d’autres l’acceptent, mais s’en désolent, et d’autres la réfutent.
Les chercheurs qui travaillent sur le sujet préfèrent la tempérer. C’est le cas de Robin Lebrun, collaborateur scientifique au Centre d’études de la vie politique à l’ULB. «Tout d’abord, les expressions ‘militant bourgeois’ ou ‘militant élitiste’ sont des expressions trop fortes. Certes, il y a une réalité: les jeunes militants qui s’engagent dans des partis, dans des syndicats ou dans des organisations militantes, ont majoritairement un capital socio, éco et culturel important.» Les raisons sont assez simples à comprendre: s’engager pour une ou plusieurs causes, c’est déjà comprendre le jeu et les codes du débat et du monde politique, c’est aussi avoir du temps à consacrer et une sécurité financière qui permettent d’avoir le choix et l’envie de s’engager, et c’est avoir assez de confiance pour penser que sa voix et ses actes comptent.
«Mais deux choses, continue Bruno Frère, professeur de sociologie à l’Université de Liège. Ça ne veut pas dire que les jeunes militants sont extrêmement riches. On peut penser notamment aux étudiants qui galèrent et qui s’engagent ou à tous les jeunes des quartiers populaires ou de la ruralité profonde, qui portent des combats moins médiatisés. Ensuite, cela ne veut pas dire que les jeunes militants issus de classes moyennes ou supérieures portent forcément des combats élitistes. Réduire le combat écologiste ou féministe à un combat d’élite est très très réducteur.»
L’exemple des jeunes écolos
Adélaïde Charlier a 22 ans. Célèbre activiste belge, elle fait partie de différents collectifs dont Youth for Climate. Les reproches émis par ceux qui définissent ses combats et ses camarades de bourgeois, elle les connaît bien. «Il y a une réalité: la majorité des jeunes militants pour le climat sont issus de la classe moyenne, voire supérieure, et ont presque tous fait l’université, explique-t-elle. En revanche, les collectifs climat n’ont absolument pas pour objectif de stigmatiser les plus démunis.»
C’est même tout le contraire, selon elle. «D’abord, parce que plus on est pauvre, moins on pollue. Ensuite parce que les populations les plus fragiles sont les premières victimes du changement climatique. Nous, on s’attaque aux riches, aux gros pollueurs et aux États qui ne bougent pas assez vite. Et enfin, notre combat ne s’arrête pas à ‘arrêtez le CO2 et sauvez les abeilles’ (même si c’est essentiel). On cherche à engager un changement systémique, avec une meilleure répartition des richesses, de meilleurs logements, créer une société avec des personnes et des territoires vulnérables mieux accompagnés, etc.»
Les raisons sont assez simples à comprendre: s’engager pour une ou plusieurs causes, c’est déjà comprendre le jeu et les codes du débat et du monde politique, c’est aussi avoir du temps à consacrer et une sécurité financière qui permettent d’avoir le choix et l’envie de s’engager, et c’est avoir assez de confiance pour penser que sa voix et ses actes comptent.
Lorsque l’on pose la question à Adélaïde sur la raison du manque de diversité sociale au sein des mouvements de jeunes écolos, sa réponse est limpide: «Quand tu n’arrives pas à boucler les fins de mois, quand tu bosses pour aider ta famille, que tu es victime d’injustices chaque jour, l’état du climat passe bien après. On le comprend tout à fait. Et puis nos organisations sont jeunes. Je crois qu’on doit encore travailler à aller rencontrer et surtout écouter les jeunes des territoires populaires, pour mesurer leurs combats, les injustices qu’ils vivent. On doit se former encore plus et pas chacun dans notre coin, mais auprès d’eux, sur le racisme, les violences policières, le manque de services publics, l’isolement et la pauvreté dans les milieux ruraux, etc. Et, s’ils le souhaitent, on doit leur laisser la place qu’ils méritent dans nos organisations.»
Donner de l’espace
En Belgique, des collectifs qui laissent la place à des jeunes issus de classes populaires, il en existe pourtant partout. Les maisons de jeunes, les AMO, des asbl, des espaces culturels, etc. Leur objectif: donner des outils, des espaces et de la confiance pour permettre à des jeunes d’exprimer, de découvrir et de transformer en partie leur réalité. Le théâtre, la musique, le débat, des projets de groupes… sont autant d’outils pour les intéresser.
Thibault Coeckelberghs et son équipe ont décidé d’utiliser l’audiovisuel, en créant il y a une dizaine d’années l’asbl Comme un Lundi. «Notre objectif est de donner la parole aux jeunes, explique-t-il. Une parole souvent trop peu considérée, surtout quand on parle de jeunes issus de quartiers populaires.» Grâce à l’asbl, des jeunes construisent des podcasts de A à Z. «On leur demande de créer un récit, de donner leur point de vue. Pour ce faire, ils vont faire des interviews de leurs potes, d’experts, de politiques, etc.» L’objectif: leur montrer que leurs voix comptent. «On veut qu’ils se prouvent qu’ils peuvent avoir un avis construit et qu’ils ont des choses à faire entendre. Alors, bien sûr, leur combat arrive rarement à bout. C’est le jeu de la militance: souvent on perd, parfois on gagne.»
Ras El Hanout, une troupe et un espace de théâtre molenbeekois, organise de nombreux ateliers et échange avec des jeunes de son quartier. «Donnez-leur des espaces où ils peuvent s’exprimer sur les injustices qu’ils vivent et où leurs formes de conscientisation et d’expression ne sont pas étouffées ou réprimées, et ils parleront, affirme Salim Haouach, directeur artistique de Ras El Hanout. Même si tous ne le font pas, et c’est bien normal.» «Et, surtout, il ne faut pas leur imposer des sujets ou parler à leur place, ajoute Lise Cirillo, coordinatrice chez Tyn, une organisation de jeunesse présente en Fédération Wallonie-Bruxelles qui mène une série de projets collectifs avec les jeunes dans le but de stimuler leur participation active, responsable, critique et solidaire. «Si vous leur donnez les outils et un accompagnement suffisant, ils sont capables de créer des projets vraiment engageants du début à la fin.»
S’intéresser à leur réalité
Pour tous ces collectifs, la règle est de partir de la réalité de ces jeunes. «On ne va pas commencer à leur parler de climat, alors qu’ils ont d’autres problèmes», explique Margot Tortonese, coordinatrice de la dynamique jeune chez ATD. Un groupe d’une quinzaine d’hommes et de femmes de 16 à 30 ans, venant de Bruxelles et de Wallonie, qui se réunissent chaque mois pour aborder des sujets qui les touchent. «On a travaillé sur le logement, l’isolement ou encore le harcèlement, explique Dylan, 26 ans et membre du groupe. Moi, j’ai vécu la pauvreté avec mes parents, donc je sais ce que c’est. Ici, on parle de nos réalités, de ce qu’on vit. On essaye de trouver des solutions à de grandes thématiques, mais aussi de s’aider individuellement. C’est ça pour moi être militant.»
En Belgique, des collectifs qui laissent la place à des jeunes issus de classes populaires, il en existe pourtant partout. Les maisons de jeunes, les AMO, des asbl, des espaces culturels, etc. Leur objectif: donner des outils, des espaces et de la confiance pour permettre à des jeunes d’exprimer, de découvrir et de transformer en partie leur réalité.
«Moi, je pense que ce n’est pas inintéressant de leur parler aussi d’écologie ou de féminisme, ça les concerne. Mais les jeunes n’en parlent pas souvent, car on les considère trop souvent comme ‘public’ et peu comme ‘acteurs’ du savoir», tempère Emilie Steffens. En 2018, cette sociologue de formation a cofondé l’asbl L’Interstice et puis, en 2020, la Maison rouge. Un lieu où enfants et jeunes peuvent participer à des ateliers individuels et collectifs. Pour elle, il faut partir de leur réalité familiale, de quartier, de leurs envies et besoins. «Pour nous, l’idée est de leur donner des outils, afin qu’ils puissent analyser petit à petit leur réalité et le monde qui les entoure. C’est comme cela que, dès l’âge de 5 ans, on peut aborder les questions de mobilité au détour d’une randonnée à vélo. Ils vont ensuite pouvoir s’interroger sur la mobilité globale: d’où je viens? Quelles sont mes origines? Quand l’enfant se sent à sa place, il va petit à petit poursuivre son questionnement sur toute réalité. Ainsi, il peut poser son regard sur des thématiques comme le logement, les rapports hommes-femmes, la nature, l’écologie… et donner sa propre opinion sur les problématiques qu’il observe.»
Créer des ponts
En bref, des jeunes issus de classes populaires qui développent des formes de militance, il en existe beaucoup. Doit-on pour autant créer des ponts entre eux et les jeunes militants pour le climat? «Entre ces jeunes, les réalités ne sont pas les mêmes, explique Nadia Cornejo, responsable du département campagne au CNCD. Donc ce n’est pas simple de créer des ponts. En revanche, c’est possible de créer des ateliers et des discussions, mais il faut partir avec deux éléments en tête: il faut s’écouter, car toutes les paroles sont audibles et surtout il faut des espaces inclusifs.»
Et comme le rapporte Souad Aïnèche, chargée de projet chez Tyn, ce n’est pas tout le temps le cas. «J’ai des amies racisées, issues de quartiers populaires, qui ont essayé d’entrer dans des mouvements écolos ou féministes. Bon nombre d’entre elles ont décidé d’en sortir, parce qu’on ne leur laisse pas la place pour exprimer leur point de vue, pour parler racisme, injustices, etc. Bien souvent dans ce genre de collectif, ce sont des Blancs qui prennent le lead.»
Certains des collectifs que nous avons rencontrés seraient d’accord, si «leurs» jeunes le sont aussi, de créer des rencontres avec des jeunes plus favorisés. «Mais encore une fois, il faut que les espaces soient safe, appuie Océane Lestage, coordinatrice chez Ras El Hanout. Il ne faut pas non plus qu’après coup, les militants climat parlent au nom des classes populaires parce qu’ils les auraient rencontrées une fois. Ça, ce n’est pas possible. C’est à eux de porter leurs combats.»
Sauter d’autres barrières
Mais ces jeunes issus de classes populaires pourront-ils ensuite porter eux-mêmes leur combat, en créant leurs collectifs. Ce qui est sûr, c’est que cela sera plus difficile pour eux. Pour affirmer cela, on peut s’intéresser à un secteur militant, mais plus entrepreneurial: l’économie sociale et solidaire. Ici aussi les porteurs de nouveaux projets sont surtout des jeunes issus de classes favorisées. «Cela se comprend assez facilement, explique Joanne Clotuche, chargée de plaidoyer et chargée de projet impact social chez SAW-B, la Fédération francophone d’économie sociale. Pour se lancer dans l’économie sociale et solidaire (ESS), il faut d’abord lancer un projet, entrer dans des cases et ensuite postuler à de potentielles aides financières. Donc en gros, au début et pour un temps indéfini, il faut que ta famille puisse t’aider financièrement à vivre. Si tu n’as pas ça, c’est quasiment impossible. De plus, il faut avoir une connaissance administrative importante, avoir accès à des prêts bancaires, etc. Ce qui n’est pas le cas de tout le monde.»
En revanche, les structures ESS, une fois implantées et solides, travaillent avec tous les types de publics. «C’est le but en réalité, continue-t-elle. On travaille avec des jeunes issus de tous les milieux, que ce soit dans l’insertion, l’aide à la personne, le développement durable, etc. Et ça fonctionne plutôt bien. Puisque l’idée est certes de leur apprendre des choses, mais aussi que ces jeunes, avec leur réalité et leurs connaissances, apprennent des choses aux structures et fassent bouger les lignes. Ils en ont largement les capacités.»