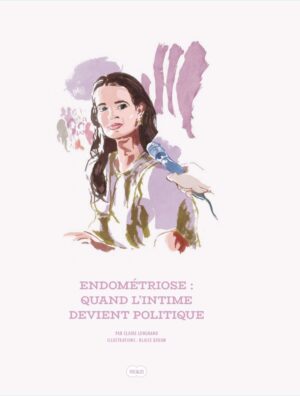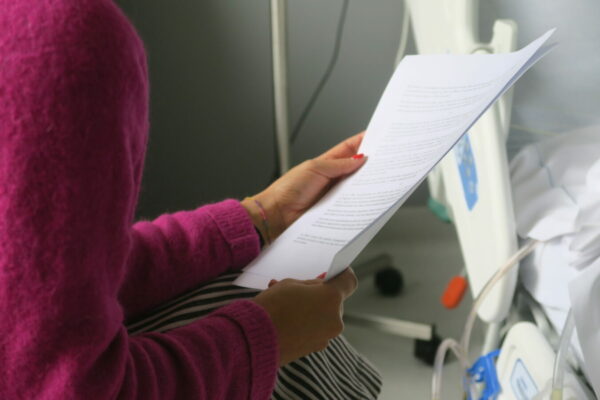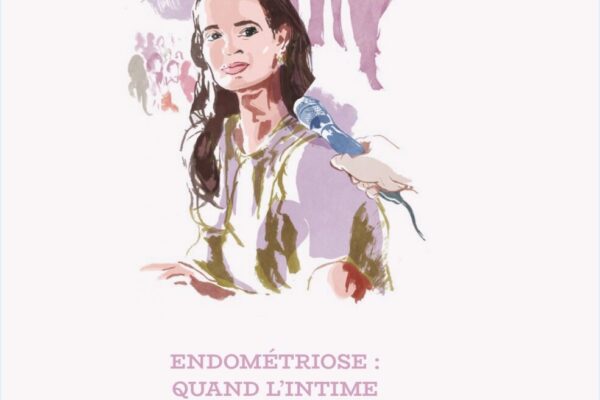Depuis que le graffiti existe, le métro de Bruxelles est un endroit prisé par les graffeurs. Les prendre en flagrant délit relève du miracle. La Stib préfère passer l’éponge sur les coups de bombe.
Le métro bruxellois, il en connaît tous les recoins. Quand vous patientez sur les quais, lui observe les dispositifs de surveillance ou tente d’ouvrir une porte de secours. Mine de rien, se fondant dans la masse. Patrick a peint son premier métro à la fin des années nonante. Et n’a jamais cessé depuis. «J’ai suivi des gens que je connaissais avant de comprendre moi-même le système», explique l’entrepreneur, fin de la trentaine. On est loin de l’image du jeune tagueur, regard défiant et casquette vissée sur le crâne. Plusieurs fois par semaine au début, un peu moins aujourd’hui, le sous-sol bruxellois devient son terrain de jeu, «sa manière de se dépenser à côté du boulot».
«C’est plus compliqué que la rue»
Le métro est un lieu très apprécié des graffeurs (le monde du graff ne compte que quelques femmes). C’est là que tout a commencé, à Philadelphie au début des années 70. «Comme le train, c’est un endroit de prestige pour tous les graffeurs, quels qu’ils soient», explique Alain Lapiower de l’asbl bruxelloise Lézarts-Urbains qui œuvre à la promotion des cultures urbaines. Et de citer l’exemple de Bonom, l’artiste bruxellois aujourd’hui sorti de l’anonymat, qui a commencé «en vandale» sur les métros. «L’idée est que la signature voyage avec le véhicule. Elle est ainsi vue par un maximum de gens», poursuit-il. La difficulté d’accès et le danger contribuent à la renommée du lieu. Une bonne dose de préparation et d’aplomb est nécessaire pour se faufiler dans les tunnels et déjouer les systèmes de surveillance de ce petit monde souterrain. Sans oublier la présence du 3e rail, potentiellement électrifié. «C’est plus compliqué que la rue, commente Patrick, le métro, c’est beaucoup d’appelés, peu d’élus.» Face au succès de l’underground bruxellois auprès des étrangers, «tu dois parfois protéger ton plan», confie-t-il. Les cadenas ne sont donc pas toujours ceux de la Stib mais des graffeurs eux-mêmes…
Nettoyer, stratégie la plus payante
Le métro n’a pas une brigade dévolue spécifiquement au graffiti, comme la Ville de Bruxelles (voir encadré). «Les agents de la Stib, qui patrouillent dans les stations, peuvent repérer les graffeurs et appeler la police du métro en cas de flagrant délit», explique-t-on à la police du métro. «Dans les faits, rapporte Patrick, ils se permettent beaucoup plus, certains sont frustrés de ne pas t’avoir pris en flagrant délit alors ils se déchaînent.» Et les plaintes sont rares dans le milieu du graffiti. Mieux vaut soigner ses blessures qu’être identifié et casser sa tirelire… Alain Lapiower nuance de son côté: «Tous les tagueurs ne sont pas enfants de chœur!» Ni tous les flics des casseurs: «Ils ont aussi des états d’âme et parfois ils apprécient le travail des graffeurs. Ils sont conscients des enjeux en termes de démocratie culturelle…». Au fil des années, ils finissent même par se connaître.
En réalité, sans chiffres à disposition, la porte-parole de la société de transport communique que les flagrants délits sont «très rares», malgré les dispositifs de surveillance en nombre dans les stations. Le phénomène se confirme du côté de la cellule tag de Bruxelles, où aucun dossier provenant de la Stib ne leur est parvenu depuis plusieurs années.
La société de transport a privilégié l’option du nettoyage. L’enveloppe totale allouée à cette tâche est de 6 millions d’euros. Les graffitis n’en sont qu’une infime partie, si l’on se réfère au montant de 2009, le dernier disponible, qui s’élevait à 265.547 euros. «Chaque membre du personnel en station reçoit la consigne de signaler les tags et graffitis. En plus, une équipe de cinq personnes est spécialement chargée de cette mission. Quelque 27.000 tags ont été repérés en 2014», rapporte la porte-parole de la Stib. Quand il y en a, des équipes de nettoyage sont chargées de les retirer en 48 heures. Le délai est de trois heures en cas d’insultes. «Il s’agit d’une question de propreté mais aussi de sécurité», explique-t-elle. «Le graffiti est souvent considéré comme un baromètre de la violence et du sentiment de sécurité, à tort», analyse Alain Lapiower, cela s’est illustré après la mort de Joe Van Holsbeeck en 2006, poignardé dans la gare Centrale. Le débat sur la jeunesse délinquante a été relancé et les procédures de contrôle du graffiti renforcées.» Pour la Stib, le nettoyage systématique vise aussi à «éviter les effets boule de neige». Pas gagné… Si l’effacement systématique peut décourager certains tagueurs occasionnels à s’aventurer dans les tunnels souterrains, il ne constitue nullement un effet dissuasif pour d’autres irréductibles comme Patrick: «Je me fous de la visibilité, je fais ça pour me sentir vivre.»


La police locale de Bruxelles-Capitale/Ixelles s’est dotée en 2000 d’une «cellule tag». Sa mission: lutter contre les tags et graffitis à Bruxelles. Un travail de répression, mais aussi de prévention.
Les murs de leur bureau sont couverts de «blazes», sortes de signatures laissées par les graffeurs après leur passage. Bienvenue à la cellule tag, créé en 2000, en vue de lutter contre les tags et graffitis sur les murs et le mobilier urbain du centre de Bruxelles. «On est les anarchistes de la police!», prévient d’emblée Jean-Marc Huart, chef depuis 2008 de cette cellule composée de trois personnes, trois chasseurs de «tags vandales», ils insistent sur le mot. Parce que, même s’ils n’en font pas vraiment l’aveu, ils admirent le travail de certains de «leurs petits tagueurs».
Chaque semaine, la brigade effectue des rondes dans la zone Bruxelles-Capitale/Ixelles. «On patrouille rarement en début de semaine, par manque de personnel mais également parce qu’en général les tagueurs se réveillent le jeudi…», explique Jean-Marc Huart, en civil, au volant de sa voiture banalisée. En quelques années, il est devenu spécialiste et sait repérer en un coup d’œil les nouveaux graffs laissés sur les murs de la ville. La brigade passe par Recyclart, le skatepark ou Tour et Taxis, lieux de prédilection des graffeurs. Son but: les surprendre sur le fait. Mais la tâche n’est pas simple… La brigade estime à une trentaine le nombre de graffeurs arrêtés par an. Depuis 2005, ils sont punis par des amendes administratives, qui peuvent monter jusqu’à 300 euros, ou des heures de travaux d’intérêt général. Les étrangers n’ayant pas de domicile en Belgique, par contre, ne sont pas concernés. «Cela contribue au tourisme du graffiti à B
ruxelles», déplore Jean-Marc Huart. Dans des cas plus graves, le fait de dessiner des graffitis sans autorisation peut être puni de six mois de prison au maximum.

Pour réaliser sa mission, la cellule tag dispose d’un outil efficace: la «tagothèque»: une banque de données qui rassemble près de 900 tagueurs identifiés, belges et étrangers, et compile environ 10.000 tags ou signatures.
La répression n’est qu’un volet du travail de la cellule. «Si vous n’agissez qu’en matière répressive, vous perdez le combat. Il faut aussi comprendre le phénomène», explique Jean-Marc Huart. Le commissaire refuse aussi les clichés qu’on colle à la peau des graffeurs: «Il ne s’agit pas pour la plupart de gens violents. Je suis toujours en colère quand je vois des journaux illustrer des agressions par des photos de tags. Les graffeurs ont entre 13 et 40 ans et proviennent de tous les milieux.» Pas facile pourtant d’entamer le dialogue avec un milieu qui se méfie toujours de la police: «Ils savent que je suis contre le fait de s’attaquer à des choses qui ne leur appartiennent pas. Mais je comprends que cette liberté totale de s’exprimer soit l’essence du graffiti.» Pour tenter de résoudre le paradoxe, Jean-Marc Huart, qui avoue «croire fortement au street art», travaille à la création d’espaces légaux pour donner aux graffeurs la possibilité de s’exprimer. Et éviter qu’ils ne s’attaquent aux autres murs.