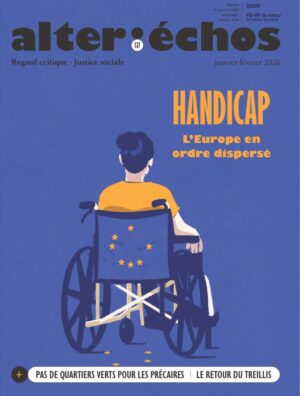«C’est le bas de laine qui donne la possibilité de vivre.» À 67 ans, Christophe van den Berghe a une carrière bien remplie derrière lui. Représentant de commerce, il se serait même bien vu continuer de travailler jusqu’à son âge actuel. C’était compter sans son employeur, qui avait décidé qu’il partirait à la retraite à 65 ans. Après six mois «comme les grandes vacances» où il trouve «tout un tas de trucs à faire», il se rend cependant compte que malgré sa longue carrière, la maison qu’il possède et la pension de sa femme, les fins de mois sont parfois compliquées, surtout avec un fils encore aux études. «Nous devions restreindre la vie sociale pour des raisons financières», explique-t-il.
«Nous devions restreindre la vie sociale pour des raisons financières.»
Christophe van de Berghe, 67 ans, sur les raisons qui l’ont poussé à travailler après la pension.
Christophe s’inscrit donc chez Nestor, une société d’intérim pour les plus de 60 ans et finit par travailler pour VAB, une société proposant des services de dépannage et d’assurance. «J’ai officié comme chauffeur pour aller chercher et remettre les véhicules de remplacement pour les clients», explique-t-il. À raison de deux jours de travail par semaine, Christophe gagne entre 400 et 500 euros net par mois, soit un «argent de poche» qui lui permet de vivre un peu plus à l’aise. C’est un secret de polichinelle: les pensions belges sont parmi les plus mauvaises d’Europe, pas tant au niveau de leur montant que de leur capacité à «remplacer» le revenu qui était issu du travail. Ainsi, d’après les chiffres d’Eurostat, alors que le taux de remplacement moyen des 27 États membres de l’Union européenne se situait à 60% en 2024, la Belgique atteignait péniblement les 48% alors que l’Italie montait jusqu’à 79 et l’Espagne à 81…
Au travail malgré un AVC
Christophe van den Berghe n’est pas le seul pensionné à avoir décidé de continuer à travailler en Belgique: Statbel estime leur nombre à 10%. Parmi les raisons invoquées pour expliquer ce choix, 44% d’entre eux évoquent le fait d’aimer travailler et d’être productif, 13,3%, le maintien des contacts sociaux et 15,7%, la nécessité de maintenir un niveau de revenu assez élevé. Signe de l’importance du phénomène, Eneo, le mouvement social des aînés associé à la Mutualité chrétienne, a d’abord semblé prudent lorsque nous lui avons demandé de relayer un appel à témoins. Avant de se trouver surpris… «Je ne pensais pas que nous aurions autant de réponses», témoigne Sylvie Dossin, secrétaire politique d’Eneo, lorsqu’elle évoque les 35 propositions de témoignages qu’elle a récoltées en à peine quelques jours.
Parmi elles, outre Christophe van den Berghe, on trouve aussi les parcours d’Isabelle De Block ou encore Bernard Lamboray, comme autant de témoignages de la diversité des parcours de ces aînés qui continuent à travailler. Prenons Isabelle De Block tout d’abord. Licenciée en chimie, cette enseignante de 70 ans, qui a débuté sa carrière en 1982, est aujourd’hui examinatrice extérieure en chimie au Jury central. Ravie de se sentir utile, «au service des autres», elle remplit cette tâche deux ou trois jours par mois malgré «une très belle pension». On l’aura compris, Isabelle De Block se situe plus dans la catégorie de celles et ceux qui continuent à travailler «pour le plaisir». Mais attention: la petite «dringuelle» de 60 euros net par jour qu’elle touche grâce à son activité la comble également. «Je ne veux pas dépendre de ma fille, et je ne veux pas qu’elle ait une mémé qui s’assied dans un fauteuil et qui pleure», lâche-t-elle.
C’est un secret de polichinelle: les pensions belges sont parmi les plus mauvaises d’Europe, pas tant au niveau de leurs montants que de leur capacité à «remplacer» le revenu qui était issu du travail.
Quant à Bernard Lamboray, cet homme au parcours multiple (restaurateur, technicien forestier en agronomie et finalement assistant pour les ordinateurs «Mac»), il a continué sa dernière activité d’assistant «Mac» jusqu’à il y a peu. À 70 ans, le voilà donc pensionné pour de bon, mais il se souvient avec plaisir des raisons qui l’ont poussé à continuer à travailler. «J’ai continué par passion, mais les questions de revenus sont aussi entrées en ligne de compte. Je n’ai pas toujours bien gagné ma vie, j’ai eu une vie professionnelle aventureuse, je n’aurais pas pu subsister avec ma seule pension. Avec celle de ma femme, nous atteignons 3.000 euros, ce n’est pas gras, même si nous avons notre maison. Ceux qui n’ont pas de toit sur la tête, je ne veux même pas imaginer», analyse-t-il.
Ce témoignage rejoint celui de Christophe van de Berghe qui, dans le jardin de sa maison située à Avennes, dans la province de Liège, fait état des situations variées et bien souvent complexes des nombreux ami(e)s qu’il s’est faits du côté de chez Nestor. Il y a le cas de cet homme de 67 ans devenu homme à tout faire, malgré un AVC quelques années plus tôt. Ou encore celui de cette femme de 68 ans qui a repris du service dans une asbl à cause d’une pension «taille Grapa» (garantie de revenus aux personnes âgées).
Tant pis pour les femmes
Cette situation, qui désespère Sylvie Dossin, «en dit long sur le statut des aînés et des pensions en Belgique». Un statut qui ne risque d’ailleurs pas de s’arranger avec la réforme prévue par la majorité Arizona, aux manettes au niveau fédéral. Parmi les mesures prévues: un malus sur le montant brut des pensions pour les personnes décidant de partir à la pension de manière anticipée. Dorénavant, un travailleur pourra partir à la pension anticipée sans être pénalisé financièrement s’il compte au moins 35 années de travail effectif (travail pendant six mois au moins, ce qui ne comprend pas le chômage ou la maladie…) et 7.020 jours de travail effectifs. S’il n’atteint pas les conditions de ‘travail effectif’, sa pension va diminuer: moins 2% de pension par année d’anticipation entre 2026 et 2030; moins 4% par année d’anticipation jusqu’en 2040; moins 5% par année d’anticipation à partir de 2040. À l’opposé, un bonus est prévu pour celles et ceux qui décident de continuer à travailler après l’âge légal de la pension…
«Je n’ai pas toujours bien gagné ma vie, j’ai eu une vie professionnelle aventureuse, je n’aurais pas pu subsister avec ma seule pension. Avec celle de ma femme, nous atteignons 3.000 euros, ce n’est pas gras, même si nous avons notre maison. Ceux qui n’ont pas de toit sur la tête, je ne veux même pas imaginer.»
Bernard Lamboray, 70 ans, au travail après sa pension jusqu’à récemment.
De façon plus «genrée», ce sont les femmes qui risquent de payer la note la plus salée. D’après Pensionstat, l’écart de pension légale entre les femmes et les hommes était de 17% en 2023. En cause, les carrières plus morcelées des femmes, faites de contrats à temps partiel, principalement pour s’occuper des enfants. Les nouvelles mesures, notamment le malus, risquent encore de faire grimper cet écart, s’inquiète Selena Carbonero, secrétaire fédérale de la FGTB. «L’ensemble des mesures de l’Arizona ne tient pas compte du fait que les femmes travaillent souvent à temps partiel», note-t-elle. Avant de citer le même rapport du Comité d’étude sur le vieillissement qui estime que parmi les personnes ayant pris leur pension anticipée, 49% des femmes et 22% des hommes ne rempliraient pas les conditions d’emploi du malus prévues par l’Arizona.
Plus globalement, cette diminution des possibilités de partir à la pension de manière anticipée risque de pénaliser encore plus les personnes fragiles, ayant connu des carrières et de métiers pénibles, alors que celles et ceux encore en mesure de travailler pourront prolonger, notamment via le système de bonus pension, également mis en place par l’Arizona, qui permettra aux personnes reportant leur pension après l’âge légal de voir celle-ci augmentée. Un constat qui fait dire à Anne Léonard, secrétaire nationale de la CSC, «qu’on crée un effet d’aubaine pour celles et ceux qui peuvent encore travailler alors que les autres, celles et ceux qui ne peuvent plus, qui n’ont pas d’autres possibilités que de s’arrêter, vont être pénalisés alors qu’ils sont déjà en difficulté sociale. C’est socialement dramatique».
Vive les flexi-jobs
Ce dernier constat est également valable pour les pensionné(e)s ayant décidé de continuer à travailler après l’âge de la pension. Travailler dans ces conditions, oui, mais encore faut-il en être capable, souligne Selena Carbonero. «Seulement 10% des pensionnés continuent à travailler parce que ce sont ceux qui ont la capacité de le faire», précise-t-elle. Pourtant, avec les mesures décidées par l’Arizona, de plus en plus de pensionné(e)s pourraient être tentés de continuer à travailler après l’âge de la pension. Le rapport annuel du Comité d’étude sur le vieillissement du Conseil supérieur des finances, paru en juillet 2025, a en effet chiffré l’impact de l’ensemble des mesures de la réforme sur le taux de remplacement des pensions belges. Déjà pas très gras, il risque de baisser de 7,6% en 2040 et 8,3% en 2050 pour les salariés, de 3,1% et 3,3% pour les indépendants et 4,6% et 8,3% pour les fonctionnaires.
«L’ensemble des mesures de l’Arizona ne tient pas compte du fait que les femmes travaillent souvent à temps partiel.»
Selena Carbonero, secrétaire fédérale de la FGTB.
Sera-ce via les flexi-jobs? Ce qui est sûr, c’est que, déjà à l’heure actuelle, de plus en plus en plus de pensionnés se tournent vers ce type d’emploi qui permet aux personnes ayant au moins un emploi principal à 4/5 temps ou aux pensionnés de travailler sans payer d’impôts (jusqu’à un plafond de 12.000 euros pour les non-pensionnés, les retraités étant exonérés de ce même plafond). En 2023, on comptait 22.747 personnes de plus de 65 ans qui travaillaient sous ce statut, d’après les chiffres de l’ONSS. En 2024, ce chiffre était passé à 34.705 personnes, soit une augmentation de 52,6%. Une situation qui fait grincer des dents Cédric Simon, permanent Seniors CSC Bruxelles, pour qui «il y a un impact énorme du taux de remplacement trop faible» sur cette situation. «La situation va encore plus encourager le recours aux flexi-jobs», constate-t-il. Avant d’insister sur le «dumping social» généré selon lui par ce système. «On veut atteindre un taux d’emploi de 80% tout en maintenant sur le marché des personnes ayant déjà eu une carrière», analyse-t-il.
Risque-t-on de rencontrer encore plus de Christophe, Bernard ou Isabelle dans le futur? Alter Échos aurait voulu en discuter en détail avec le cabinet de Jan Jambon (N-VA), le ministre fédéral des Pensions. Celui-ci s’est contenté de renvoyer un court texte sur le malus, se clôturant par: «Nous rétablissons ce lien entre travailler plus longtemps et le montant de la pension d’une manière qui maintient le coût du vieillissement sous contrôle, et qui est équitable et logique»…