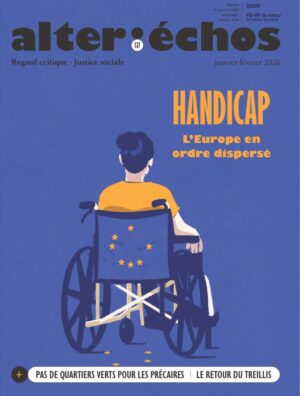Créé en 2008, l’ISADF a connu une évolution majeure en 2025. «Cette édition intègre 13 droits fondamentaux, contre 9 auparavant, et s’appuie sur 148 indicateurs, dont beaucoup issus du ressenti des citoyens», souligne Christine Ruyters, sociologue et coresponsable de l’outil. L’enquête menée auprès de 102.000 habitants (avec plus de 24.000 réponses exploitables) permet pour la première fois de croiser données administratives et vécu des populations, notamment sur le non-recours aux droits.
La méthodologie, inspirée des recommandations du Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme et du Conseil de l’Europe, garantit la robustesse et la comparabilité des résultats. «On a voulu respecter à la fois les exigences internationales et les réalités locales, en intégrant des indicateurs objectifs et subjectifs», précise Baptiste Feraud.
Sécurité sociale: un droit fondamental fragilisé
Parmi les 13 droits évalués, l’accès à la sécurité sociale – qui englobe l’assurance-santé, la protection et l’aide sociale, ainsi que les prestations familiales – apparaît comme un pilier sous tension. «On observe une dégradation incontestable de l’accès à la sécurité sociale en raison notamment du durcissement des critères d’accès, de la pression budgétaire et des inégalités croissantes dans l’accès aux droits, en particulier pour des catégories de population particulièrement fragilisées, parmi lesquelles les personnes en fracture numérique», constate Christine Ruyters. En chiffres: 18,6 % des Wallons bénéficient de l’intervention majorée (BIM), 5,3 % des 18-24 ans touchent un RIS, et 4,5% des plus de 65 ans perçoivent la Grapa ou un revenu garanti.
«On observe une dégradation incontestable de l’accès à la sécurité sociale en raison notamment du durcissement des critères d’accès, de la pression budgétaire et des inégalités croissantes dans l’accès aux droits, en particulier pour des catégories de population particulièrement fragilisées, parmi lesquelles les personnes en fracture numérique»
Christine Ruyters
Mais derrière ces moyennes régionales, l’ISADF met au jour de profondes disparités territoriales: «Les scores les plus faibles d’accès à la sécurité sociale se concentrent dans les grandes agglomérations comme Liège, Charleroi, Verviers, ainsi que dans certaines zones rurales du sud de Namur. À l’inverse, le Brabant wallon et le sud du Luxembourg affichent en général des situations nettement plus favorables», détaille Baptiste Feraud.
Le non-recours, un phénomène massif
Une innovation majeure de l’édition 2025 réside dans la mesure du non-recours, c’est-à-dire le fait de ne pas demander ou d’abandonner des démarches pour des droits auxquels on est pourtant éligible. «Nous avons pu, pour la première fois, documenter le non-recours à partir du vécu des citoyens», se félicite Christine Ruyters.
Les chiffres sont éloquents: 49,8% des personnes interrogées se disent mal informées sur les démarches à entreprendre pour accéder à leurs droits sociaux. Plus d’une sur deux (56,5%) a rencontré au moins une difficulté lors de ses démarches pour obtenir une allocation sociale. Parmi eux, 6,8% citent le manque d’information, 19,6% la complexité administrative, et 14,8 % un mauvais rapport avec l’administration. Enfin, 19,8% déclarent avoir dû renoncer ou abandonner leurs démarches, un taux qui grimpe à plus de 27 % dans les territoires les plus fragilisés.
«Les scores les plus faibles d’accès à la sécurité sociale se concentrent dans les grandes agglomérations comme Liège, Charleroi, Verviers, ainsi que dans certaines zones rurales du sud de Namur. À l’inverse, le Brabant wallon et le sud du Luxembourg affichent en général des situations nettement plus favorables»
Baptiste Feraud
«Le non-recours n’est pas un épiphénomène: il touche en priorité les publics les plus fragiles et contribue à la reproduction des inégalités», insiste l’équipe de recherche. Pour Christine Ruyters, «c’est un enjeu central pour l’effectivité des droits fondamentaux: des milliers de personnes restent à l’écart de la protection sociale, souvent par découragement ou faute d’accompagnement».
Ce cumul des précarités est un problème, rappelle la sociologue: «Si on n’a pas suffisamment de revenus, on a aussi du mal à se nourrir, à accéder aux soins de santé… Tous les droits sont interconnectés.»
Un outil pour agir, pas seulement constater
L’ISADF se veut un levier pour l’action publique. «L’outil est d’abord destiné aux communes, pour leur permettre de réaliser un diagnostic précis, d’identifier les points faibles et de cibler leurs interventions», explique Baptiste Feraud. Grâce à une cartographie interactive, chaque commune peut comparer sa situation à la moyenne régionale ou à celle de communes voisines.
Les associations, les CPAS, mais aussi des acteurs comme la Croix-Rouge, s’en servent pour orienter leurs stratégies et programmer leurs actions. «L’ISADF est à la disposition de tous: il doit permettre d’objectiver les besoins et d’adapter les politiques sociales aux réalités locales», ajoute Christine Ruyters.
Les chiffres sont éloquents: 49,8% des personnes interrogées se disent mal informées sur les démarches à entreprendre pour accéder à leurs droits sociaux.
En dressant une carte précise des inégalités, l’ISADF 2025 met les pouvoirs publics face à leurs responsabilités. «L’accès aux droits fondamentaux, et en particulier à la sécurité sociale, est un enjeu de justice sociale. L’ISADF donne les moyens d’agir, à condition de s’en saisir pour lutter contre le non-recours et adapter les politiques aux besoins des territoires», concluent les auteurs du rapport.
L’édition 2025 marque ainsi un tournant: jamais l’accès effectif aux droits n’a été autant documenté, commune par commune, droit par droit. Reste à transformer ce diagnostic en actions concrètes pour garantir à chacun l’accès à la protection sociale.
Pour découvrir cet outil: https://isadf.iweps.be/