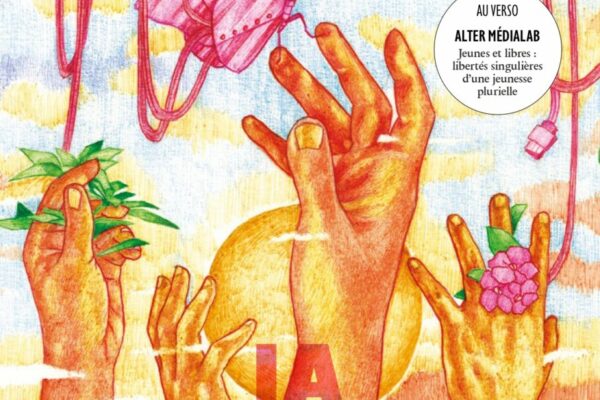«On crève de trouille. On se rend sur le terrain la peur au ventre.» Eric Labourdette, délégué SLFP pour le Service d’incendie et d’aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale, n’y va pas par quatre chemins. À plusieurs reprises, il a alerté les médias sur la progression constante des agressions commises sur les secouristes lors de leurs interventions. Il décrit les voitures de pompiers caillassées, les embuscades avec des rues bloquées par des conteneurs, les jets de cocktail Molotov, etc. Du côté des médecins généralistes, on tire aussi la sonnette d’alarme. Dans la revue médicale Le Spécialiste, Lieve Galle, coordinatrice du projet «Médecins en difficulté», fait état de 330 agressions contre des médecins au cours de ces six dernières années, dont 75% sont dirigées contre des généralistes. De quoi émouvoir l’ABSyM, le syndicat des médecins, qui exige une réaction de la ministre de l’Intérieur après une prise d’otages avec violence physique d’une généraliste à Waregem en juin dernier.
Du côté des médecins généralistes, on tire aussi la sonnette d’alarme. Dans la revue médicale Le Spécialiste, Lieve Galle, coordinatrice du projet «Médecins en difficulté», fait état de 330 agressions contre des médecins au cours de ces six dernières années, dont 75% sont dirigées contre des généralistes.
C’est grave, docteur? Les agressions contre le personnel soignant en contact direct avec le public sont-elles vraiment en forte augmentation? Une certitude: dans pratiquement tous les pays européens, mais aussi au Canada, on constate que, depuis une bonne dizaine d’années, les intervenants de première ligne font l’objet de violences inédites de la part de leurs patients ou du public en général. En France, il est devenu courant que les pompiers et les ambulanciers se fassent escorter par la police sur les lieux de l’intervention. Fin juillet, dans le quartier Esseghem à Jette, les pompiers ont dû être protégés par la police pour éteindre deux foyers d’incendie qui avaient été allumés volontairement. «Cela fait quelques années que l’on constate une augmentation des actes de violence, qu’elle soit physique ou verbale, explique Misikir Corhay, président de la Centrale générale des services publics pour les pompiers de Liège. C’est principalement chez les ambulanciers que cela se passe. Les gens appellent le 112 pour une assistance et les ambulanciers se font agresser. C’est paradoxal tout de même! Évidemment, les ambulanciers ne sont qu’à deux sur le terrain. Pour les incendies, on est toute une équipe, c’est plus dissuasif, mais les ambulanciers, eux, ont tout connu: se faire taper avec des barres de fer, être poursuivis avec une hache, encaisser des coups de poing… Tout récemment, nous sommes intervenus sur un incendie. L’ambulance était arrivée avant nous et les secouristes ont été pris à partie parce qu’ils n’avaient pas de moyens d’extinction. Sur l’ambulance, il est écrit ‘pompiers’, et donc les gens estimaient qu’ils devaient éteindre l’incendie.»
Que disent les chiffres? Selon la DG Sécurité civile, on comptait 189 agressions des membres de services de secours en 2019 contre 110 cinq ans auparavant. «Mais sur combien d’interventions? Dans quelle proportion les interventions donnent-elles lieu à des agressions?», nuance Vincent Yzerbyt, professeur de psychologie sociale à l’UCLouvain, qui ne nie cependant pas une progression des réactions négatives du public. Les soignants, eux, ressentent bel et bien un changement d’attitude à leur égard. L’Institut VIAS (l’ex-Institut belge de la sécurité routière) a réalisé un sondage en mars dernier auprès de 836 personnes travaillant comme pompiers, ambulanciers ou au service des urgences des hôpitaux. La toute grande majorité des répondants sont flamands (88%), tout comme dans l’enquête de «Médecins en difficulté» sans que l’on sache pourquoi les médecins et intervenants francophones ne se plaignent pas ou très peu. Selon VIAS, la majorité (83%) des répondants évoquent de la violence verbale: cris, insultes. Un sur deux dit avoir été victime de violence physique (poussés, frappés). Des chiffres qui sont sans doute sous-évalués puisque seuls 29% des intervenants signalent les faits à leur hiérarchie. Un exemple parmi d’autres: dans les hôpitaux de Charleroi, «les comportements agressifs et insultants ne sont pas nécessairement signalés par le personnel qui ‘encaisse’ sans les mentionner à la hiérarchie», constate Frédéric Dubois, directeur de la communication pour l’ISPPC (Intercommunale de santé publique du pays de Charleroi), qui regroupe le CHU de Charleroi et plusieurs autres hôpitaux. «Le personnel du central téléphonique est de plus en plus malmené. Ces violences verbales ne sont pas comptabilisées dans les statistiques de violences à l’égard du personnel soignant, mais pèsent lourdement sur le moral du personnel.»
Les médecins de garde les plus malmenés
Sous-estimation, voire banalisation? Le même phénomène doit sans doute s’observer du côté des médecins généralistes. Seuls les faits de violence physique grave (ayant parfois entraîné des blessures, voire la mort du médecin) sont fortement médiatisés et ont fait l’objet de réactions vigoureuses de l’ABSyM. David Simon est médecin à Colfontaine. Il a été confronté à la violence d’un patient à deux reprises. Le premier a jeté du jus d’orange sur son ordinateur et l’a poursuivi dans la rue en l’insultant. «C’était un patient que je soignais depuis longtemps, mais qui n’était pas très équilibré.» Le second a séquestré le médecin dans son domicile pour obtenir des médicaments stupéfiants. Mais c’est une expérience ancienne, précise David Simon, et c’est le cas pour la majorité de ses confrères auxquels il a posé la question à notre demande. «J’ai 57 ans et, au début de ma carrière, j’ai eu droit à tous ceux qui pensent que le médecin va céder à la pression psychologique. Le jeune médecin qui s’installe reçoit dans l’année tous les toxicomanes du coin!» David Simon nuance tout de même: si lui et ses confrères ne rencontrent pas trop de problèmes, ce n’est pas le cas des jeunes médecins qui font les gardes. «Il y a une concentration de la violence verbale, psychologique et parfois physique quand ce n’est pas le médecin habituel qui intervient. Les gens qui hurlent, qui injurient le personnel médical, c’est là qu’on va les rencontrer. Le patient s’énerve plus rapidement. Il a une attitude qu’il n’aurait jamais avec son médecin. Au poste de garde, le médecin n’est pas seul, mais, s’il se rend au domicile du patient pendant la nuit, alors là, oui, cela peut mal se passer et on a des témoignages de violence. Surtout si le généraliste est une femme.»
«Les comportements agressifs et insultants ne sont pas nécessairement signalés par le personnel qui ‘encaisse’ sans les mentionner à la hiérarchie. Le personnel du central téléphonique est de plus en plus malmené. Ces violences verbales ne sont pas comptabilisées dans les statistiques de violences à l’égard du personnel soignant, mais pèsent lourdement sur le moral du personnel.» Frédéric Dubois, directeur de la communication pour l’ISPPC (intercommunale de santé publique du pays de Charleroi) qui regroupe le CHU de Charleroi et plusieurs autres hôpitaux
David Simon n’a pas l’impression pour autant que les gens «pètent les plombs» plus rapidement qu’avant. Ce n’est pas l’avis de Lawrence Cuvelier, médecin généraliste dans un centre médical au cœur de Bruxelles. «Les gens ont plus de difficultés à maîtriser leur stress et leur impatience. C’est lié à une culture de l’immédiateté très présente dans notre société.» Le généraliste bruxellois rejoint cependant David Simon: «Lorsqu’on a pu établir un lien personnel avec le patient, les problèmes de violence sont peu présents. Mais ce n’est effectivement pas le cas dans les postes de garde. Je suis parfois très surpris de l’attitude qu’ont mes patients par rapport aux assistants qui interviennent le week-end.»
Une agressivité qui use
La confrontation avec un médecin qu’on ne connaît pas, le contexte de stress dans lequel se trouve le patient quand il fait appel au médecin de garde ou se rend aux urgences des hôpitaux sont à la base des faits de violence les plus fréquents. Cette violence est le plus souvent verbale, mais elle use les médecins-urgentistes, les infirmiers, les ambulanciers. «La violence verbale et les comportements désobligeants à l’égard du personnel augmentent, explique Frédéric Dubois. Les causes de cette violence sont difficilement identifiables, mais la population me semble en perpétuel état de stress ces dernières années.» Pendant la période Covid, le personnel hospitalier était applaudi, mais en même temps les urgences non liées à l’épidémie étaient désertées. Dès la seconde vague, la situation s’est complètement inversée, constate Frédéric Dubois. L’interdiction des visites, le port du masque obligatoire ont créé de fortes tensions, mais la situation ne s’est pas améliorée depuis lors, au point que l’ISPCC a dû mener une campagne de sensibilisation, via des vidéos et des affiches pour demander au public de respecter davantage son personnel. L’Intercommunale a aussi mis en place un dispositif anti-agressions, un bouton d’alarme qui permet d’appeler le service interne de gardiennage, soit une quarantaine d’agents présents en permanence aux endroits «stratégiques». Il y a aussi de nombreuses caméras installées dans les différents hôpitaux. Mais «la solution ne réside pas dans l’augmentation des systèmes de sécurité, estime Frédéric Dubois. Il faut ramener plus d’humain dans les soins, là où il manque du personnel soignant».
La confrontation avec un médecin qu’on ne connaît pas, le contexte de stress dans lequel se trouve le patient quand il fait appel au médecin de garde ou se rend aux urgences des hôpitaux sont à la base des faits de violence les plus fréquents. Cette violence est le plus souvent verbale, mais elle use les médecins-urgentistes, les infirmiers, les ambulanciers.
«Nos patients ont souvent une expérience très négative de l’hôpital, explique Lawrence Cuvelier. Quand vous n’avez pas une maladie qui nécessite l’intervention personnelle et immédiate d’un spécialiste, cela se passe souvent mal. Si le patient vient pour un mal de dos, on ne va pas résoudre son problème. Il va ressortir énervé, frustré parce qu’on est devant une offre de soins inappropriée. Le système se perpétue ainsi. Les gens vont aux urgences parce qu’ils n’ont pas de médecin. Les urgentistes sont confrontés à une surcharge de travail qui a pour résultat que l’accueil des patients est souvent très mauvais. Dans notre équipe, nous avons la chance d’avoir plusieurs femmes d’un certain âge. Elles gèrent mieux l’agressivité des patients que les hommes et la maturité joue un rôle positif. Elles peuvent ‘prendre sur elles’. Les plus jeunes n’y arrivent pas alors qu’ils ne sont pas visés personnellement.»
«Quand on a installé notre premier poste de garde, on a acheté un dispositif ‘bouton d’alerte’ permettant au médecin d’être localisé, mais l’appareil est resté dans sa boîte. Sans doute parce que les médecins ne se sentaient pas en insécurité, raconte David Simon. Pour les jeunes médecins, il me semble plus utile d’investir dans une formation à la gestion de situations de crise.» «On nous a donné des formations de gestion de l’agressivité, qui envisagent aussi la ‘retraite’ et l’appel à la police pour éviter les dommages physiques, explique Misikir Corhay. On a même reçu une formation plus ‘physique’ pour apprendre à réagir aux coups de poing. Mais ce n’est pas la panacée d’apprendre aux agents du service public d’être des maîtres de kung-fu.»
«On prend le 112 pour un taxi»
Le syndicaliste s’interroge sur la représentation qu’a le public des services de secours. «Les réactions négatives viennent de personnes frustrées parce que nous ne leur obéissons pas au doigt et à l’œil. Elles exigent qu’on les amène à l’hôpital de leur choix; or, nous sommes obligés d’aller à l’hôpital le plus proche.» Ce qui crée aussi des tensions, c’est de constater que très souvent l’urgence n’en est pas une. «En fait, on nous prend pour un taxi. Combien de fois, lorsqu’on arrive sur place, les gens disent aux ambulanciers d’attendre un peu, le temps de faire les bagages et, quand on leur fait remarquer qu’ils ont fait appel à un service d’urgence, l’énervement est immédiat.» Yvan Vanderkeeren opère pour le 112 dans la région de Rixensart, La Hulpe, une zone plutôt calme et favorisée du Brabant wallon, mais il confirme: «Les gens cherchent à éviter une course en taxi en nous appelant. Environ 70% des interventions 112 ne sont pas urgentes.» Pour ces deux intervenants, le 112 étant un service public, les gens estiment «avoir le droit» de tout lui demander.
«Les réactions négatives viennent de personnes frustrées parce que nous ne leur obéissons pas au doigt et à l’œil. Elles exigent qu’on les amène à l’hôpital de leur choix; or, nous sommes obligés d’aller à l’hôpital le plus proche.» Misikir Corhay, président de la CGSP pour les pompiers de Liège
Misikir Corhay va plus loin: «Les actes de violence à notre égard peuvent être complètement gratuits. Il y a peu, lors de festivités à Liège, le camion des pompiers a été caillassé. J’imagine que, pour certains, c’est une manière de s’en prendre à l’autorité publique, que nous représentons avec notre uniforme. Ces actes sont moins dirigés contre nous en tant que personnes que contre l’État qu’ils voient à travers nous.» Le psychologue Vincent Yserbyt lui donne raison: «La manière dont un nombre croissant de la population est susceptible de se représenter le métier de secouriste, de médecin généraliste a fortement évolué. Toute une catégorie d’intervenants n’est plus considérée comme bienvenue et au côté de la population. À Bruxelles, près de 40% de la population n’a pas de médecin généraliste. Cela signifie que le contact avec les métiers de la santé, de l’aide, de l’intervention sont devenus très réduits et considérés comme des contacts avec des personnes qui font partie de ‘l’autre bord’, des personnes avec qui on n’a pas grand-chose de commun. Entre cette population déshéritée, déconnectée et les services de soins et d’aide qui sont pourtant au service de la population, le fossé s’est creusé et le dialogue s’est perdu. On perçoit aussi cette distance par rapport aux fonctionnaires, aux administrations. Mais comment s’en étonner quand on ne cesse de réduire le nombre de personnes physiquement présentes pour ne plus compter que sur les interventions virtuelles…» Cette perte de contact est «très préoccupante. On l’a déjà observée dans le cadre du Covid où pour une partie de la population, les médecins de première ligne, les infirmiers n’étaient pas considérés comme des alliés dans la lutte contre la pandémie. Tous les services sociaux de Bruxelles vous diront que cette méfiance accumulée au fil des années a été un handicap majeur pour la couverture vaccinale à Bruxelles».
Pour le psychologue social, augmenter le cadre de sécurité dans les hôpitaux ou les postes de médecine de garde ne sert pas à grand-chose, c’est juste essayer «de se réfugier dans le château. Quand on a une structure hospitalière imposante avec des contraintes d’hygiène et de sécurité importantes, quand on met des gardes à l’entrée pour vérifier qui entre, ça ne permet pas de lever les barrières. Je peux comprendre le désarroi des pompiers, des ambulanciers, des infirmiers qui se font refouler alors qu’ils viennent pour aider, mais c’est en amont qu’il faut agir, dans une offre de soins et d’aide plus importante et diversifiée. Il faut des médecins de quartier, des pompiers, des policiers issus du terrain pour recréer du lien, poursuit Vincent Yzerbyt. Nous sentons tous qu’avec certains services d’intervention et la police, au nom de la sécurité, une distance s’est créée. Récemment, un incendie s’est produit près de chez moi. Il n’était pas évident de parler avec les policiers qui refoulaient avec très peu de convivialité les spectateurs».
«La manière dont un nombre croissant de la population est susceptible de se représenter le métier de secouriste, de médecin généraliste a fortement évolué. Toute une catégorie d’intervenants n’est plus considérée comme bienvenue et au côté de la population. À Bruxelles, près de 40% de la population n’a pas de médecin généraliste. Cela signifie que les contacts avec les métiers de la santé, de l’aide, de l’intervention sont devenus très réduits et considérés comme des contacts avec des personnes qui font partie de ‘l’autre bord’, des personnes avec qui on n’a pas grand-chose de commun.» Vincent Yserbyt, psychologue
La méfiance à l’égard des métiers du soin est-elle liée à la précarité des populations? Pas forcément, estime David Simon. «Dans le Borinage, où je suis installé, toute la population est précarisée et il y a pourtant moins de violence qu’ailleurs. C’est une question de lien, de proximité humaine.» Lawrence Cuvelier constate que «les gens qui ont un niveau social élevé peuvent aussi se montrer exigeants et méprisants», mais il ajoute: «Le sentiment de frustration est sans doute plus présent chez les plus défavorisés avec lesquels nous travaillons, car ils se trouvent dans des situations compliquées sur le plan tant social que médical. Nos patients, sans-papiers, toxicomanes, arrivent en ne sachant plus que faire et nous sommes souvent placés dans des situations arbitrales. Vis-à-vis de l’école, par exemple. On nous demande de délivrer des documents qui répondent plus à des urgences sociales que médicales. Ce sont ces attentes non rencontrées qui provoquent malentendus et tensions.» Et de s’inquiéter de la pénurie croissante de médecins généralistes à Bruxelles. «Les médecins sont débordés, ils ont de moins en moins de temps pour leurs patients. La profession se déshumanise. On va vers des situations qui vont s’aggraver.»
Pour Vincent Yserbyt, les métiers de première ligne sont déconsidérés, au même titre que les enseignants. Il faut donc les revaloriser, notamment au niveau des conditions de travail, renforcer leur nombre et leur diversité sociale et culturelle. «On a l’impression que, malgré les années Covid, on n’a rien compris quant à l’urgence de combler les failles qui sont apparues sur le terrain du soin et de l’attention à la santé.»
– Les ambulanciers et les pompiers sont victimes de plus en plus souvent d’agressions physiques et verbales.
– Cette agressivité touche aussi les médecins généralistes de garde et les urgentistes dans les hôpitaux.
– Cause avancée: la perte de contacts et une méfiance accrue entre la population et le monde des soignants. Surtout dans les villes.
En savoir plus
«Travail social: la violence en première ligne» (dossier), Alter Echos n°482, mars 2020.