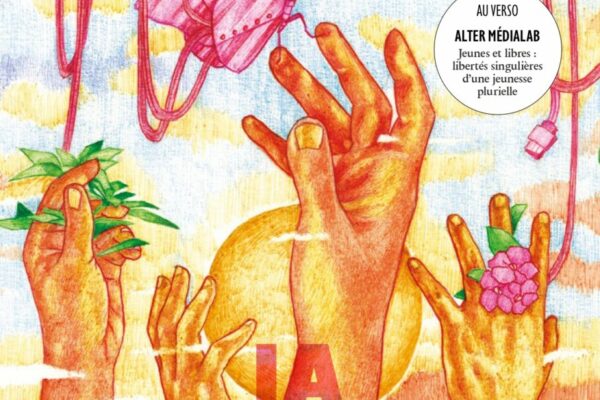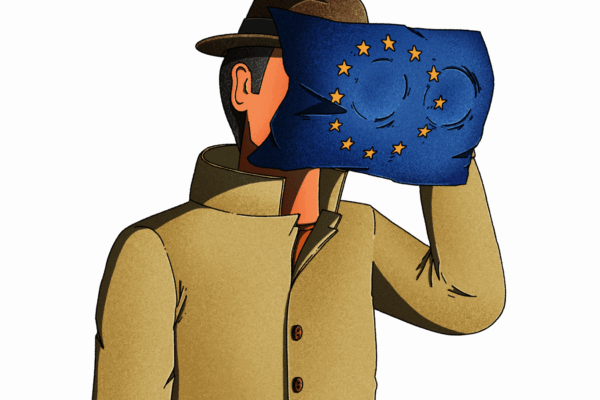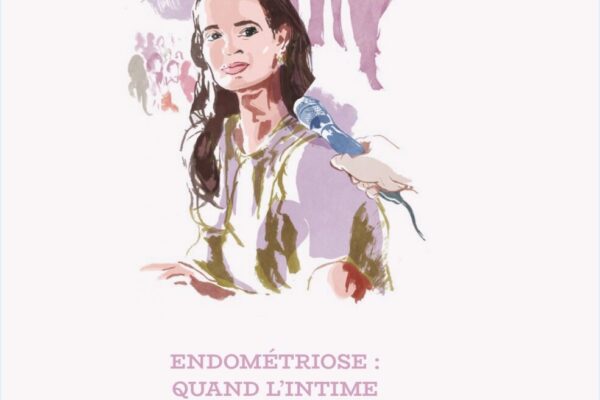L’accès au logement a rarement été aussi difficile. Pour les publics précarisés comme pour les ménages issus des classes moyennes. Et, malgré les innombrables chantiers, la pénurie guette… Rien que pour la Wallonie et Bruxelles, on estime qu’il manque 250 000 logements. Or, cela se sait moins, le droit à un logement décent est garanti par la Constitution. Né aux USA il y a plus de 40 ans, et actuellement expérimenté en Région bruxelloise, le «Community Land Trust» pourrait bien s’affirmer comme une réponse logique à la crise du logement. La particularité de ce système? Il permet d’acquérir la maison, pas le terrain. Une manière, par la même occasion, de faire baisser les prix. Et de lutter contre la spéculation immobilière. Alter Échos a rencontré John Emmeus Davis, un des pionniers du «Community Land Trust» aux États-Unis. John Davis a enseigné la politique du logement et l’urbanisme au New Hampshire College et au MIT (Chicago). Il vient de publier, en français, un «Manuel d’antispéculation immobilière», qui retrace l’histoire des fiducies foncières communautaires (FFC) et la lutte pour le droit au logement. Un livre qui analyse aussi l’expérience du «Community Land Trust» à Bruxelles. Interview.
Le «Community Land Trust» commence à peine à s’implanter en Europe. Comment et dans quel contexte ce modèle a-t-il vu le jour?
La première organisation de propriété collective, reconnue comme l’initiatrice des FFC, a été fondée en 1969. Elle est née dans le sud des États-Unis, en Géorgie. À l’époque, les afro-américains luttaient pour les droits civiques et contre l’exclusion raciale. Mais aussi pour l’accès à la propriété. Après ces mouvements sociaux, les créateurs du New Communities ont cherché à étendre leur projet au reste de la société. Une de leurs sources d’inspiration, c’était le «programme constructif» de Gandhi, basé sur une société décentralisée constituée de villages autonomes et autosuffisants. Gandhi avait aussi articulé un autre concept: celui de fidéicommis. Il soutenait que la terre et d’autres actifs devaient être détenus en fiducie pour servir aux pauvres. Cette vision a donné naissance au mouvement Gramdan, en Inde. Dans les années 60, près de 160000 villages Gramdan ont ainsi échappé aux mains des spéculateurs, pour la simple raison que les terrains étaient détenus en fiducie par le conseil du village et loués aux fermiers. C’est ce qui explique qu’au début des années 80, les FFC américaines n’étaient que de petites enclaves rurales.
Qu’est-ce qui distingue les FFC du mouvement de Gandhi?
Une des forces du «Community Land Trust», c’est qu’il ne faut pas de terrains vierges pour créer une fiducie communautaire. Ça s’applique aussi à des bâtiments déjà existants, et même à la réhabilitation de quartiers entiers. Et par conséquent, pas seulement à l’environnement agraire, mais aussi au paysage urbain. En fait, avant d’être un mouvement communautaire, la FFC se démarque d’abord par sa façon inhabituelle de considérer la propriété. Le sol appartient à une seule organisation, sans but lucratif. Tandis que les bâtiments appartiennent à des particuliers qui doivent y habiter personnellement, après en avoir fait l’acquisition à un prix d’achat plus abordable, puisque dépourvu des frais d’acquisition du terrain. Ces terrains ne sont jamais revendus. Ils sont retirés du marché de manière permanente. Pour éviter la spéculation.
Comment cette vision s’est-elle structurée par la suite?
Il a fallu attendre quelques décennies, jusqu’au début des années 2000, pour que le «Community Land Trust» devienne un véritable mouvement, prêt à s’étendre aux villes et aux banlieues, et plus seulement en milieu rural. À la fin des années 80, il y avait une soixantaine de FFC aux États-Unis. Aujourd’hui, il en existe 280 dans 46 États américains (sur 50, ndlr), à Porto Rico et dans le District de Columbia. Elles ont aussi fait leur apparition en Australie, au Canada, en Angleterre, en France et en Belgique.
Pour implanter une FFC, l’alliance des gens ne suffit pas. Il faut aussi composer avec les politiques. Comment dealez-vous avec les autorités locales?
Je dirais que jusqu’à la fin des années 90, presque chaque projet de FFC américain se construisait par opposition aux plans gouvernementaux. Pas seulement en réaction aux pressions du marché, donc, mais aussi face aux pressions politiques. Ces pressions consistent généralement à pousser les ménages à bas revenus en dehors des villes. Autrement dit, à faire de la gentrification. Mais avec le temps, de plus en plus de villes et de communes s’érigent en partenaires. Et ce, même dans le fief des conservateurs. Ce changement n’est pas seulement dû au fait que le «Community Land Trust» est devenu un mouvement moins militant, mais bien parce que les gouvernements locaux sont désespérés… Ils ont de moins en moins d’argent pour construire des logements sociaux. Du coup, les FFC s’imposent comme une évidence pour revitaliser certains quartiers. Et sans doute la meilleure alternative à la crise du logement.
Depuis la crise des subprimes, on constate que même les classes moyennes éprouvent plus de difficultés à accéder à la propriété. Les FFC parviennent-elles vraiment à tordre la mécanique?
Oui, à partir du moment où leur modèle s’étend. Les FFC visent à développer un mode de propriété qui protège la terre au bénéfice de ceux qui y vivent, et non pas de ceux qui l’acquièrent dans le seul but de s’enrichir. La propriété à plus-value partagée permet de préserver l’abordabilité du logement aussi pour les générations futures. L’argent investi par les autorités publiques reste donc dans les quartiers. Et ça, c’est devenu un argument politique très fort… Mais en distribuant autrement les intérêts liés à la propriété, la propriété à plus-value partagée réussit surtout là où la propriété ordinaire (qui obéit aux lois du marché) échoue: elle empêche la perte de maisons abordables, surtout lorsque le marché immobilier surchauffe. Et protège les propriétaires lorsque le marché refroidit.
Propos recueillis par Rafal Naczyk
En savoir plus:
Manuel d’antispéculation immobilière, par John Emmeus Davis, éd. Ecosociété, 2014, 250 p., 25 euros