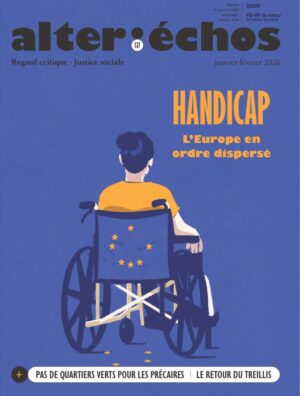Près de 96.000 personnes avaient reçu, en mai dernier, l’attestation de protection temporaire(1), depuis le début de la guerre en Ukraine. Alors que celle-ci se poursuit, la Belgique a décidé, fin 2024, de réduire son offre d’accueil subventionné. Deux raisons sont invoquées par les autorités belges pour justifier cette décision. La première: la baisse du nombre d’arrivées de réfugiés en Belgique. «En mai dernier, 550 attestations ont été délivrées par l’Office national des étrangers, contre 1.000 en mai 2024», énonce Adrien Alexis, attaché à la cellule wallonne de coordination de l’accueil des réfugiés ukrainiens (SPW). Deuxième motif avancé: «Entre 10 et 15% des réfugiés ukrainiens ont actuellement besoin d’un logement à leur arrivée, contre 25% en 2022.»
Un transfert entravé
Sur le terrain, l’ONG Vluchtelingenwerk Vlaanderen, qui défend les droits des réfugiés, constate que «même si la demande d’accueil s’est réduite, il n’y a pas assez de places disponibles pour couvrir les besoins», pointe Helena Laureyns, juriste au sein de l’organisation. Entre 60 et 70 personnes arriveraient chaque semaine, selon l’ONG. Le problème se situe surtout à la première étape, lorsque les réfugiés arrivent en Belgique. Celles et ceux ne disposant pas de solution de logement transitent par le centre fédéral Ariane, à Woluwe-Saint-Lambert, avant d’intégrer un centre conventionné, un logement public ou privé. «Depuis que les capacités d’accueil ont diminué, nous constatons que les arrivées dans le centre Ariane sont plus importantes que les sorties», nous écrit Benoît Mansy, porte-parole de Fedasil. Résultat: «Des gens restent parfois plusieurs mois à Ariane, et le transfert ne se fait plus aussi efficacement», déplore Helena Laureyns.
Entre 60 et 70 personnes arriveraient chaque semaine, selon l’ONG. Le problème se situe surtout à la première étape, lorsque les réfugiés arrivent en Belgique.
Ce centre ne prend cependant en charge que les personnes bénéficiant du statut de protection temporaire. Or, entre juillet 2024 et juillet 2025, les décisions de refus ont quasiment triplé d’après les données de l’Office national des étrangers(2). Une hausse qui serait due, selon Helena Laureyns, à «une charge de preuves plus élevée» de la part des autorités. «Les personnes peuvent refaire une demande, mais au bout de 30 jours, ce qui retarde l’accès à leurs droits.» Avec comme risque principal celui de pousser ces dernières à la rue. La juriste insiste aussi sur le fait que les réfugiés arrivant actuellement «sont plus vulnérables qu’au début, car ce sont ceux qui sont partis parce qu’ils n’avaient plus le choix».
Un accompagnement vers la sortie
En Wallonie, l’accueil des réfugiés ukrainiens s’est déroulé en plusieurs étapes. Au début de la guerre, de nombreuses personnes furent logées par des particuliers. L’élan de solidarité s’est essoufflé et la Région a pris le relais en ouvrant, à partir de juillet 2022, des centres d’hébergement conventionnés avec l’appui des gouverneurs, puis des logements publics de type modulaire. Ces derniers, représentant au total 158 places, sont réservés aux réfugiés ukrainiens jusqu’à la fin de la protection temporaire. En revanche, il ne restait en juillet dernier qu’une dizaine de centres conventionnés (contre 25 fin 2024) accueillant 310 résidents, selon Adrien Alexis. Six d’entre eux sont gérés par la société Profirst pour le compte de la Région wallonne, dont celui de Jodoigne, à deux pas de la gare des autobus. Fin août, cet ancien internat accueillait 64 résidents, pour une capacité totale de 72 places. «Il y a un gros turn-over. Certaines personnes arrivent dans le cadre du regroupement familial», explique Maria Buzan, coordinatrice des centres Profirst (au nombre de 32 au départ). Elle constate également que «les réfugiés actuels sont plus enclins à quitter les centres et à trouver des solutions pour s’intégrer à la société belge». Même si les autorités wallonnes poussent aussi les résidents vers la sortie, précise-t-elle.
En Wallonie, l’accueil des réfugiés ukrainiens s’est déroulé en plusieurs étapes. Au début de la guerre, de nombreuses personnes furent logées par des particuliers. L’élan de solidarité s’est essoufflé et la Région a pris le relais en ouvrant, à partir de juillet 2022, des centres d’hébergement conventionnés avec l’appui des gouverneurs, puis des logements publics de type modulaire.
Pour les aider, le personnel de Profirst, qui a notamment recruté des femmes ukrainiennes venues durant la guerre, accompagne les ressortissants au quotidien, dans leurs démarches administratives, dans la recherche de logement et d’emploi, et les informe sur leurs droits, etc. À Jodoigne, des cours de français sont également dispensés. Le but est de leur permettre de s’autonomiser. «Pour les personnes isolées, c’est plus compliqué. Elles arrivent néanmoins à se faire un réseau, à s’appuyer sur d’autres», assure Maria Buzan. C’est notamment le cas d’Inna, en Belgique depuis le 6 avril dernier. «J’ai tenu trois ans sous la guerre, mais quand notre maison a pris feu et qu’on a tout perdu, je suis partie. Mon mari est toujours en Ukraine, on ne le laisse pas sortir du pays», raconte-t-elle(3). Inna a d’abord passé deux mois et demi au centre Ariane avant d’arriver à Jodoigne. «Ici, je me sens soutenue. Nous formons une vraie collectivité. Malgré nos différences, on se serre les coudes.»
«La vie se passe bien avec les résidents, le seul problème est qu’il n’y a pas de travail», confient Angelica et Yevehniia. Originaires de Bakhmout, la première était sage-femme en réanimation et la deuxième exerçait «dans le domaine floral». Avant d’arriver en Belgique, elles ont vécu et travaillé deux ans aux Pays-Bas, dans la restauration et comme femmes de ménage. «Là-bas, l’anglais suffisait, mais ici, il faut apprendre le français…» En septembre, elles déménageront près de Mons avec leurs enfants, «dans une grande maison avec cinq chambres», trouvée grâce à Maria. Les deux amies tenaient à vivre sous le même toit afin de se soutenir mutuellement, leurs «hommes (époux et fils, NDLR) combattant en Ukraine».
Un avenir incertain
Trouver un logement reste néanmoins une gageure pour nombre de réfugiés ukrainiens. La barrière de la langue et la peur de l’inconnu dissuadent certains bailleurs, mais pas seulement. «Difficile d’obtenir un logement sans contrat de travail et juste avec seulement l’argent du CPAS», confie Alla, venue de Kiev avec son conjoint. En Belgique depuis juillet 2022, le couple a longtemps cherché avant de finalement trouver un appartement à Alost, en janvier dernier. Avant cela, ils ont séjourné dans trois centres d’accueil, appris le néerlandais, suivi une formation professionnelle et le parcours d’intégration en parallèle. Puis son mari a décroché un emploi et la situation s’est débloquée. «Des Ukrainiens nous sollicitent parfois pour appeler les propriétaires et les rassurer, leur parler de la garantie locative», indique Cécile Couvreur, responsable du CPAS de Braine-le-Château. Dès 2022, la commune a hébergé des réfugiés dans des familles d’accueil, puis mis à disposition deux logements modulaires. Douze ménages vivent actuellement au sein de la commune. «Il y a une part d’autonomie dans leur manière d’arriver et de gérer les choses», remarque Cécile Couvreur. «La plupart des Ukrainiens veulent s’investir, apprendre la langue pour se débrouiller, connaître les services existants, comprendre le système administratif belge, note Nicolas Verkens, responsable de projets au Centre d’action interculturelle, où les Ukrainiens peuvent suivre le parcours d’intégration sur une base volontaire. Probablement que la majorité de ce public a appris le français et en est à l’étape socio-professionnelle.»
Trouver un logement reste néanmoins une gageure pour nombre de réfugiés ukrainiens. La barrière de la langue et la peur de l’inconnu dissuadent certains bailleurs, mais pas seulement.
«Pour un primo-arrivant, le plus important est le logement, la langue, l’aide sociale et l’éducation. Puis, avec le travail, on devient indépendant et on s’intègre plus facilement», résume Michal, président du Ukrainian Voices Refugee Comittee(4). Il ajoute que «les problématiques rencontrées par les Ukrainiens sont propres à tous les réfugiés». Le régime de protection temporaire, activé pour la première fois par l’Union européenne, a néanmoins permis de «traiter l’urgence le mieux possible, de stabiliser la base, c’est-à-dire apporter une sécurité financière et juridique», pointe Cécile Couvreur. «Je ressens beaucoup de gratitude envers la Belgique et son accueil. Ici, on nous a permis de vivre, pas juste survivre», confie Alla, les mains jointes. Durant les interviews, les «merci» n’ont d’ailleurs cessé de pleuvoir.
Reste une question: qu’adviendra-t-il des ressortissants ukrainiens une fois que la protection temporaire, prolongée jusqu’au 4 mars 2027, prendra fin? «C’est la grosse inconnue, répond Adrien Alexis, de la cellule de coordination de l’accueil des réfugiés ukrainiens. Ils ne peuvent pas devenir des demandeurs d’asile classiques, car le système implose déjà. D’autres solutions doivent être trouvées.» Ce flou brouille les perspectives. «Certains ne savent pas quoi faire, notamment concernant la scolarisation des enfants», relève Maria Buzan. Si certains réfugiés attendent que la guerre en Ukraine se termine pour y retourner, d’autres envisagent de rester vivre en Belgique. «On voit que les questions changent, dévoile Helena Laureyns, juriste pour l’ONG Vluchtelingenwerk Vlaanderen. Ce n’est plus comment louer une maison, mais comment acheter, ce n’est plus comment entamer des études, mais comment les achever. Certains s’intéressent même au système de pension!»
(1) Ont droit à cette attestation «tout ressortissant ukrainien et les membres de la famille, ainsi que les apatrides et ressortissants des pays tiers ayant bénéficié d’une protection internationale ou nationale équivalente en Ukraine et dont la résidence se trouvait en Ukraine lorsque la guerre a éclaté», précise Adrien Alexis.
(2) «Protection temporaire», Direction générale, Office des étrangers, Statistiques mensuelles, juillet 2025 (Protection temporaire).
(3) Ces interviews ont été réalisées via une interprète (Maria Buzan au centre de Jodoigne).
(4) Cette organisation créée en 2022 suite à la guerre en Ukraine, regroupant 60 travailleurs et 300 bénévoles, accompagne et propose de nombreuses activités destinées à tous les réfugiés.