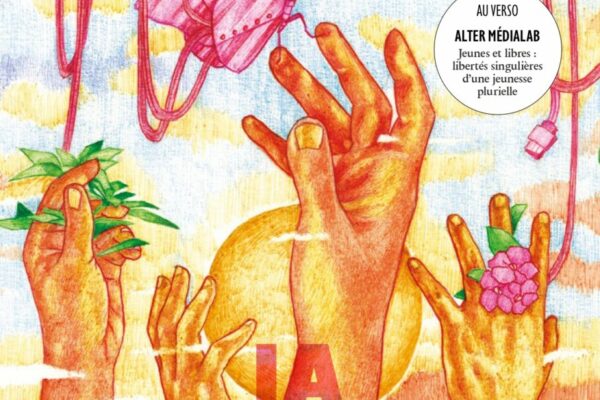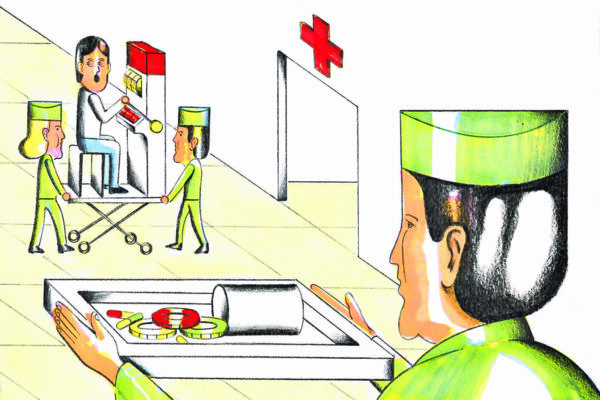Depuis trente ans, Martin Winckler de son vrai nom Marc Zaffran, médecin français et auteur, s’évertue à défendre les droits des patient.e.s. Aujourd’hui installé à Montréal où il donne cours d’ « humanités médicales », il publie « Les Brutes en blanc », un inventaire sévère des maltraitances quotidiennes exercées par les médecins en France. Selon lui, le temps est venu que les patient.e.s mènent leur révolution contre des médecins « élitistes » qui prennent des décisions à leur place.
Alter Échos : Vous écrivez sur la question de la maltraitance depuis longtemps. Ça remonte à vos études de médecine début des années septante ?
Martin Winckler : En 1976, j’étais en médecine depuis trois ans. Je suis allé aux Etats-Unis, dans le Minnesota. J’ai visité le père d’une amie du lycée opéré d’un cancer de l’estomac. Je me souviens du moment où j’arrive dans la chambre. Je m’attendais à le voir avec des tuyaux partout, et non, il était en train de lire le journal, assis sur son lit en peignoir. Je lui ai demandé s’il souffrait, il m’a répondu que non puisqu’il était sous morphine. En France, à cette époque, on ne donnait pas encore de morphine aux cancéreux et la presse médicale française n’en parlait pas. Ne pas soulager la douleur de quelqu’un, c’est déjà de la maltraitance. Elle comporte aussi les jugements, les remarques désagréables, le manque d’écoute et d’empathie, le fait de ne pas croire le patient. Depuis le début de mes études, j’ai toujours vu ça.
A.É.: « Soigner, ça n’est pas décider à la place du patient », écrivez-vous. Pourtant, selon vous, c’est le savoir du médecin qui passe avant les besoins du patient, la faute à la formation.
M.W.: La mentalité générale de la formation médicale est paternaliste et élitiste. On dit aux jeunes médecins qu’ils constituent une élite et qu’il a fallu qu’ils se battent pour en arriver là où ils en sont. Par conséquent, c’est normal selon eux d’être harcelés et mis sous pression pour être bons. Ils reproduisent ce schéma avec les patients : les médecins se disent que si les patients faisaient plus d’efforts ils seraient moins malades.
A.É.: Ce sont toujours les patients précaires qui en sont le plus victimes…
M.W.: Si vous êtes pauvre, si vous êtes une femme, gay, transgenre, si vous êtes gros, si vous êtes maigre, si vous ne voulez pas d’enfant, si vous ne parlez pas bien le français, si vous souffrez de problèmes de santé mentale, bref, si vous faites partie d’une catégorie considérée comme différente de la norme dominante, vous souffrez beaucoup de cette maltraitance. Plus les gens sont vulnérables, plus ils sont en mauvaise santé, plus ils ont des difficultés à accéder à des soins. Les médecins sont censés servir les gens vulnérables, les aider à ne plus l’être. Quand ils exercent du pouvoir, ils trahissent deux fois leur mission : d’une part, ils ne contribuent pas à sortir les gens de leur vulnérabilité, mais en plus, ils exacerbent cette vulnérabilité. Dans le centre de planification où je travaillais à l’époque, je voyais beaucoup de femmes roms, qui ne parlaient pas bien le français. Elles arrivaient chez nous désemparées après avoir essuyé plusieurs refus de gynécologues, ou rencontré des médecins qui se contentaient de leur prescrire la pilule sans discussion possible… Chez nous, on les écoutait, on prenait en compte leurs besoins et pas nos propres critères moraux. C’est ça, soigner.
Si vous êtes pauvre, si vous êtes une femme, gay, transgenre, si vous êtes gros, si vous êtes maigre, si vous ne voulez pas d’enfant, si vous ne parlez pas bien le français, si vous souffrez de problèmes de santé mentale, bref, si vous faites partie d’une catégorie considérée comme différente de la norme dominante, vous souffrez beaucoup de cette maltraitance.
A.É.: La maltraitance médicale s’exerce particulièrement à l’égard des femmes, lors des consultations gynécologiques notamment. Vous l’évoquez dans le Chœur des femmes (P.O.L, 2009). Ces dernières années, on observe que les femmes s’expriment par rapport à cette violence, avec par exemple le #hashtag Paye ton utérus.
M.W.: La maltraitance médicale à l’égard des femmes est l’un des indices premiers qui montre que la médecine est fondamentalement élitiste. Elle exerce préférentiellement son arbitraire sur les femmes car elles sont en position de vulnérabilité dans de nombreux domaines et tout au long de leur vie. Elles consultent plus, demandent plus. Les femmes servent d’intermédiaires pour tout le monde : pour les enfants, pour les hommes, pour les personnes âgées, pour d’autres femmes qui ne savent pas s’exprimer. Toute personne qui pose une question prend un risque. Le risque qu’on ne lui réponde pas, qu’on laisse entendre que sa question n’a pas de valeur, le risque qu’on la rabroue, qu’on l’ignore, qu’on ne lui réponde qu’ à moitié. Toute personne qui pose une question se met dans une position de vulnérabilité par rapport à une personne référente. Cette personne devrait se sentir l’obligation de répondre de manière loyale. Le problème, c’est que si vous répondez de manière loyale, vous abdiquez tout désir de pouvoir.
Soigner c’est mettre son savoir et son savoir-faire au service du patient en situation.
A.É.: Que manque-t-il à la formation ?
M.W.: La formation médicale française se focalise sur la maladie. On vous enseigne à reconnaître des maladies de manière très dogmatique et pas toujours adaptée au patient. Tout est centré actuellement autour des connaissances et techniques du médecin, alors que soigner c’est mettre son savoir et son savoir-faire au service du patient en situation. Evidemment, cela demande beaucoup plus d’humilité car cette posture engendre le risque pour les médecins de se trouver face à une situation qu’ils ne connaissent pas. Cela demande de l’écoute, de l’empathie, mais aussi de l’imagination, une grande capacité d’écoute de l’entourage et des autres professionnels, une flexibilité et une souplesse d’esprit. Tout cela n’est jamais enseigné ni donné en modèle dans la formation en médecine.
A.É.: Mais cette façon de soigner existe, dans les maisons médicales par exemple, menacées aujourd’hui par les coupes budgétaires (Lire l’interview de Christophe Cocu, secrétaire général de la Fédération des maisons médicales).
M.W.: Au Québec aussi, les centre de santé communautaire sont remis en cause. C’est une catastrophe. Malheureusement, la plupart des médecins ne protestent pas, preuve qu’ils sont du côté du pouvoir.
A.É.: Cela nous montre aussi que la maltraitance n’est donc pas seulement imputable aux individus. Vous évoquez peu la responsabilité politique, pourquoi ?
M.W.: Les institutions ont des obligations. Elles peuvent écraser les individus et les empêcher de travailler. Mais les individus ont des responsabilités aussi. Ce n’est pas parce qu’on exerce des pressions sur nous qu’on doit obéir aux ordres et qu’on est obligé de maltraiter les gens. Personnellement, j’ai toujours vu le métier de médecin comme un métier de privilèges : celle de prescrire par exemple. Bien sûr, la brutalité des institutions s’accroît par le manque de personnel, la rationalisation, mais il n’en reste pas moins que ceux qui dans l ‘institution ont le plus grand pouvoir – les médecins – devraient être du côté des vulnérables et pas de l’institution. Or, à partir du moment où un chef de service négocie avec le directeur de l’hôpital pour conserver ses privilèges, il fait le jeu de la direction de l’hôpital et pénalise le reste du personnel soignant paramédical, mate leur résistance.
A.É.: Vous pointez du doigt également la responsabilité des industries pharmaceutiques dans la formation et la pratique des médecins.
M.W.: La formation est extrêmement parasitée par le marché. Que veulent les entreprises pharmaceutiques ? Que les médecins donnent des médicaments, pas qu’ils soignent, car si on fait de la prévention, si on soigne, les patients consomment moins. L’industrie exerce des pressions extrêmement grandes sur la formation médicale, en leur faisant des cadeaux directs ou indirects, en leur permettant de publier dans des revues (financées à 80 % par les industries). Cette formation influencée par l’industrie ne peut donc être qu’une formation à la prescription. On peut prendre l’exemple de l’IVG. Peu de formation à l’IVG sont données dans les écoles de médecine (lire à ce sujet notre dossier L’IVG en danger, NDLR). C’est aussi lié à cette logique économique. A l’époque où j’en faisais, ça rapportait de l’argent à l’hôpital car les forfaits étaient supérieurs au coût réel. Il n’est donc pas intéressant pour les spécialistes de faire des IVG, car ça ne rapporte rien. Par conséquent, l’industrie et les syndicats des spécialistes ne poussent pas à la formation IVG des médecins généralistes afin que ce « marché des IVG » soit reporté sur le service privé et rapporte donc de l’argent à la médecine privée. A nouveau, les patientes en sont les victimes, et les femmes précaires en premier lieu. Car le médecin exerçant en privé peut décider de « choisir » les femmes qu’il accepte à la consultation. Résultat : les femmes moins solvables ont moins de chances de bénéficier de ce droit.
Il ne faut pas attendre des médecins qu’ils soient parfait, il faut revendiquer qu’ils vous respectent.
A.É.: Quelles bonnes pratiques défendez-vous pour que la « révolution » des patients dont vous rêvez s’accomplisse ?
M.W.: Il existe le programme des « patients partenaires » à Montréal. Des personnes souffrant de maladies chroniques participent à l’enseignement. A l’université de Sherbrook, il existe ce même programme de patientes partenaires volontaires en gynécologie. Des patientes volontaires viennent, après signature d’un contrat, en consultation. Elles expliquent aux étudiants en gynécologie ce qu’elles attendent, leurs priorités. C’est un état d’esprit différent : ça part de l’idée que c’est autour de la personne patiente et ses besoins, et non pas du médecin, que tout est organisé.
A.É.: Au sein des structures hospitalières, les patients ont des possibilités de s’exprimer et se défendre à travers les « droits du patients » (lire : Droits des patients, une conquête inachevée, Alter Echos, 30 septembre 2014). Ces dispositifs sont-ils efficaces ?
M.W.: Ça ne peut pas s’installer d’un seul coup. C’est une lutte de longue haleine malheureusement. Pour y arriver, l’information est essentielle. Quand vous êtes patient, vous êtes malade et acceptez implicitement une certaine dépendance. Plus vous l’acceptez, plus vous risquez que des gens qui ne sont pas loyaux vous maltraitent. Il ne faut pas attendre d’eux qu’ils soient parfait, il faut revendiquer qu’ils vous respectent. Si le patient est trop vulnérable, il faut qu’il se fasse aider. C’est pour cela qu’il faut défendre aussi la possibilité que l’un de vos proches ne puisse prendre une décision si vous n’en êtes pas ou plus capables. Chaque patient et chaque patiente qui a la force de dire au médecin « ne me parlez pas sur ce ton », « je vous pose des questions, vous avez, d’après la charte du patient l’obligation de me répondre », « je ne veux pas vous recevoir avec 15 étudiants dans ma chambre », chaque infirmière ou chaque proche qui se bat pour ça ou chaque étudiant en médecine qui respecte ces demandes, peut faire changer les choses. On ne peut pas attendre que l’institution hospitalière change pour que le patient aille mieux.
Martin Winckler, Les Brutes en blanc, pourquoi y-a-t-il dans de médecins maltraitants ?, Flammarion, 2016.
Le site de Martin Winckler : www.martinwinckler.com