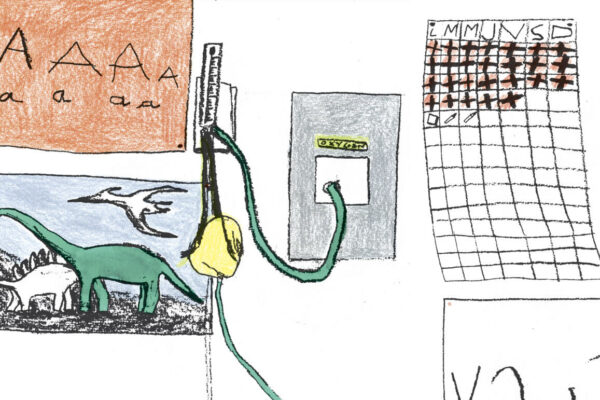Tout remonte au 30 janvier 2016. Francisco Gomez, Franco Deiana et Bernardo Del Angel entament leur journée de travail comme à leur habitude. Ils n’ont jamais bossé ailleurs que chez Truck Technic, entreprise qui répare et remet à neuf des pièces de camion abîmées ou usagées. Des pièces de freinage, des mâchoires de freins, des différentiels. «C’est en fait de l’économie circulaire, explique Francisco Gomez. On redonne vie à de vieilles pièces, on les répare, on les nettoie puis on les revend à différents clients.»
Francisco Gomez est alors délégué syndical FGTB au sein de l’entreprise. Une entreprise «sans conflit social majeur», dit-il. Toutefois, les salariés savent qu’une épée de Damoclès les menace en permanence. Ils se doutent qu’ils pourraient bien, un jour, perdre leur boulot. Une partie de l’activité de Truck Technic – le démontage des pièces – a déjà été délocalisée en République tchèque. «On savait que ça arriverait un jour, mais pas si tôt», explique Bernardo Del Angel.
Et puis c’est arrivé́. Le 30 juin 2016. La douche froide. Un grand ponte de l’entreprise américaine Meritor, qui possède Truck Technic depuis 2008, débarque à Milmort. Son ombre qui se déplace sans un regard pour quiconque, sur le parking de l’usine, est annonciatrice de mauvaises nouvelles.
Il vient tout droit de Zurich, là où se situe le siège européen de Meritor. «Dès que je l’ai vu arriver, pour moi c’était clair», se souvient Francisco Gomez. On leur annonce l’intention de délocaliser l’activité vers la République tchèque.
Chez les 67 salariés, le choc est immense. Tout l’équilibre de leur vie est menacé. «J’étais déçu, se remémore Franco Deiana, mais, surtout, j’étais en colère. Ils sont arrivés, sans prévenir, et au début ils ne parlaient pas de fermeture complète, ils disaient ‘c’est une possibilité’, mais leur décision était prise, c’était évident.»
L’abattement fait place à la colère. La communication de l’entreprise n’est pas claire. Certains travailleurs seraient sauvés de la tempête. Mais lesquels? Quelles seraient les conditions de cette série de licenciements économiques? Rien ne semble évident dans la stratégie de communication de Meritor. «Et puis on avait des commandes, le groupe était en bénéfice. Nous ne comprenions pas, mais il fallait vite se reprendre en main et obtenir des réponses à nos questions», explique l’ancien délégué syndical.
La fameuse procédure Renault est lancée. Elle impose aux entreprises qui licencient collectivement des salariés de transmettre des informations détaillées sur les raisons du plan social, sur le nombre de travailleurs concernés, sur la date de licenciement. «Nous voulions avoir le listing des travailleurs licenciés, les résultats de l’entreprise et demandions la date de fermeture», explique Billy Gomez.
Mais les réponses tardent. Les discussions avec l’entreprise se déplacent vite sur le terrain des conditions financières du licenciement. Francisco Gomez donne le détail des négociations: «Au départ, Meritor ne proposait que 15% en plus du préavis légal. Pour des gens qui n’avaient travaillé́ que quelques années, cela faisait à peine 500 euros, c’était inacceptable.» La délégation syndicale demande plus d’argent et exige que la reconversion des employés soit gérée par une cellule publique. Les points d’achoppement se multiplient. Les positions se crispent.
Une réunion entre syndicats et direction dégénère. «Ils refusaient de nous transmettre les listings des personnes concernées par le licenciement. «J’en avais plein le dos, je me suis emporté́, reconnaît Billy Gomez. J’ai dit qu’on allait parler à la Billy Gomez, avec des gifles. Puis j’ai reçu un courrier pour faute grave, et ensuite ils sont venus avec les gardes de sécurité dans l’usine. »
La tension est à son comble. Le 2 décembre 2016, les ouvriers de l’usine exigent des réponses… et de meilleures conditions de licenciement. Refus de la direction. «Nous avions proposé une somme, ils nous proposaient la moitié, nous dit Bernardo Del Angel, qui officiait lui aussi en tant que délégué syndical FGTB. Tout le monde était d’accord, il fallait mettre la direction dehors, lancer la grève et l’occupation totale.»
C’est alors le début d’un long siège de 58 jours. Un conflit difficile. Les ouvriers occupent l’usine jour et nuit. Ils se relaient, mettent en place des permanences. Mais la grève est aussi ponctuée de moments suspendus, comme entre parenthèses, presque joyeux. Le 24 décembre, par exemple, les ouvriers en grève fêtent Noël dans l’usine, avec leur famille. «C’était une belle fête pour nous, vu le contexte», nous confie Billy Gomez.
Et puis peu à, peu, les salariés de Truck Technic remportent la bataille médiatique. Les ouvriers liégeois victimes des choix économiques d’une grosse boîte américaine attirent l’attention. Les syndicalistes l’ont bien compris. Ils lancent des happenings dévastateurs pour l’image de l’entreprise made in USA. Un faux cimetière américain est érigé devant l’usine de Truck Technic. «Il y avait des croix blanches et sur chacune d’elles était écrit le nom d’un des travailleurs licenciés, nous narre Francisco Gomez. Pour eux, c’était un affront énorme.»
La bataille est âpre, mais les positions du groupe Meritor commencent à bouger. Finalement, le 19 janvier, la direction zurichoise organise une réunion pour négocier. C’est une victoire pour les salariés. Une victoire que savoure encore Francisco Gomez: «Nous demandions de toucher 100% en plus du préavis légal. Ils ont fini par proposer 75% pour ceux qui avaient de 0 à 10 ans d’ancienneté et 70% pour les autres. Ils ont même accepté de nous payer les jours de grève. Leur condition, c’était que le matériel soit en bon état, que rien n’ait été volé. Mais pour nous c’était primordial. Il fallait protéger l’outil.»
Fin de la partie. Meritor délocalise son activité vers la République tchèque. Les salariés de Truck Technic se retrouvent au chômage, avec un petit bas de laine acquis de haute lutte. C’est une cellule du Forem – donc un opérateur public – qui gérera la reconversion des salariés. Mais Billy Gomez et ses amis n’avaient pas dit leur dernier mot.








 Pour bien ficeler leur projet, les trois anciens salariés de Truck Technic vont rencontrer Propage-s, une agence-conseil en économie sociale (elle aussi directement créée par la FGTB en 2009). «Nous les avons accompagnés et coachés pour qu’ils deviennent autonomes, contextualise François Moens, coordinateur de Propage-s. C’était impressionnant, on avait face à nous deux ouvriers qui venaient d’être licenciés. Dès que nous leur posions une question, ils trouvaient dans leur entourage quelqu’un qui avait les informations.»
Pour bien ficeler leur projet, les trois anciens salariés de Truck Technic vont rencontrer Propage-s, une agence-conseil en économie sociale (elle aussi directement créée par la FGTB en 2009). «Nous les avons accompagnés et coachés pour qu’ils deviennent autonomes, contextualise François Moens, coordinateur de Propage-s. C’était impressionnant, on avait face à nous deux ouvriers qui venaient d’être licenciés. Dès que nous leur posions une question, ils trouvaient dans leur entourage quelqu’un qui avait les informations.»