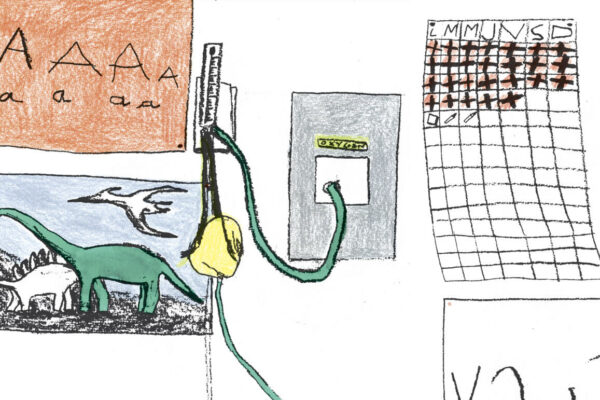Si l’impact sanitaire varie selon les communes, les conséquences économiques, elles, pourraient être encore plus inégalitaires. En effet, si l’économie dans son ensemble ralentit avec le Covid-19, certains secteurs s’effondrent totalement.
Selon la Banque nationale de Belgique, les pertes financières varient énormément selon les métiers. L’Horeca, la culture, ou encore les commerces non-alimentaires ont subi de plein fouet les mesures sanitaires et leurs conséquences économiques.
Les communes bruxelloises compilent des profils socio-professionnels très divers. Logiquement, les retombées économiques sont très inégalitaires et diffèrent selon les localités. Sans surprise, les secteurs d’activité les plus touchés sont majoritairement composés de travailleurs avec un niveau de qualification bas et se trouvent davantage dans les quartiers populaires.
Par exemple, à Saint-Josse-ten-Noode, commune avec le plus bas revenu par habitant de la Région bruxelloise, l’horeca représente 11,90% de l’activité économique, contre 4% dans les communes les plus riches telles qu’Auderghem, Uccle, Watermael-Boitsfort ou Woluwe-Saint-Pierre. Pour les communes du nord de la Région, la facture du Covid-19 est donc beaucoup plus salée.
Jan Willems, responsable de la cellule Covid au centre public d’aide sociale (CPAS) de Bruxelles, ajoute qu’en plus de constater une baisse d’activité dangereuse pour les secteurs majoritairement implantés dans les communes les plus défavorisées, de nouveaux profils de personnes crient au secours.
«Avec le Covid, on voit beaucoup de personnes différentes qui sont touchées. Désormais, des gens qui avaient des revenus irréguliers, des CDD, des étudiants jobistes se sont rajoutés à ceux qui avaient des revenus très faibles, notamment le revenu d’insertion sociale.»
Sans emploi à cause du coronavirus, Tatiana a opté pour la reconversion
La précarité des jeunes et des étudiants a crû ces derniers mois. Tatiana, 24 ans, est étudiante en art, barmaid et depuis peu, vendeuse en prêt à porter. Elle est l’illustration parfaite d’un marché du travail tari et d’une adaptation sous contrainte.
Avant le premier confinement, cela faisait quatre ans que Tatiana travaillait au Montmartre, un bar du cimetière d’Ixelles. Lorsqu’elle a appris que le virus se répandait progressivement en Belgique, elle a continué à travailler, avec le sourire et en relativisant: «Au départ, je n’avais pas peur d’aller bosser, même en pleine épidémie. Je ne m’inquiétais pas trop...» raconte l’étudiante. Puis, petit à petit, la peur et la crainte ont semé leurs graines. Tatiana l’avoue, au début, elle trouvait les médias «trop alarmistes». Mais après plusieurs semaines à travailler au bar, à écouter les «on dit que», à entendre les clients s’inquiéter et à collecter les témoignages, le stress s’est installé. L’annonce de la fermeture des bars et restaurants (donc du Montmartre) n’a pas été un choc pour la jeune femme. Elle confie que, pour elle, c’était l’occasion d’avoir du temps pour se reposer et pour profiter de ses proches. Pourtant, après presque un mois de confinement sans aucun revenu, elle a dû se résoudre à trouver un emploi. Il lui était impossible de récupérer ce manque à gagner, sans activité, sans entrée d’argent et sans chômage temporaire.
«Je ne voulais pas me retrouver sans revenu une seconde fois… Je n’aurais pas pu.»
C’est l’enseigne de prêt-à-porter & Other Stories qui l’a sauvée. «Tous les étudiants jobistes que je connais se sont retrouvés dans l’impasse, pour dire ça joliment. Je me suis dit qu’il fallait que je postule quelque part… Le Montmartre risquait de fermer à nouveau et je ne pouvais pas envisager de passer encore plusieurs mois sans salaire. C’est comme ça qu’en prévision, je me suis retrouvée à travailler pour une boutique de prêt à porter, dès la fin du premier confinement», raconte-t-elle. Avoir ce plan B en option était une façon pour elle de s’assurer un revenu en cas de seconde vague et de reconfinement. Un revenu dont elle ne peut se passer. Aujourd’hui, grâce à ce poste de vendeuse, elle reçoit chaque mois 75% de son salaire – même si la boutique a cessé ses activités.
Les mesures liées au coronavirus pèsent lourd sur le mental des employés de l’Horeca et des autres secteurs ébranlés par l’épidémie. Économiquement et socialement, le virus a détérioré le quotidien d’individus, pour certains déjà en difficulté, et dont les emplois ont été les premiers touchés. Sans persévérance et adaptation, Tatiana n’aurait ni salaire, ni emploi depuis mars dernier. Une belle ode à la positivité.