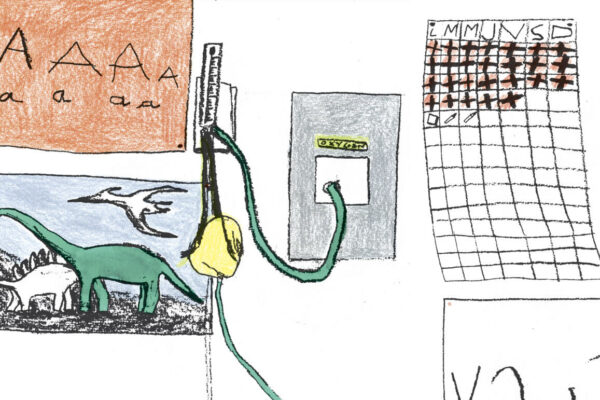Héberger des migrants en Wallonie demande une bonne organisation. Il faut des «drivers» (chauffeurs) qui amènent directement les «gars» (les migrants) chez les gens ou via une plateforme régionale qui sert de lieu de transit. De plus en plus souvent, les «gars» sont des «habitués» qui viennent, toujours le week-end ou pour plusieurs jours d’affilée, dans «leur» famille wallonne. Pas seulement parce que la Plateforme citoyenne n’organise plus que deux «dispatchings» par semaine. Des liens, forts parfois, se créent avec les hébergeurs, jusqu’au jour où ces invités du week-end auront réussi leur passage en Angleterre, quand leur rêve migratoire aura abouti. Ou qu’il se sera fracassé aux portes d’un centre fermé.
Ce jour-là, à la gare de Statte, nous arrivons en même temps que Bakri et Nasredim, deux jeunes Soudanais qui ont fait le trajet depuis Bruxelles avec Mathilde, étudiante en droit à l’ULB. Nous sommes vendredi midi, et le week-end chez Sylvie, la maman de Mathilde, et Véronique (sa tante) a commencé. Bakri et Nasredim connaissent les lieux. Ils vont directement à la salle de bain prendre une douche et parlent dans un mélange d’anglais et de français.
On sent une grande complicité entre Véronique et Sylvie. Elles se taquinent l’une l’autre, aiment rire de leurs «bévues» quand elles étaient hébergeuses débutantes. Les deux sœurs osent désormais faire venir leurs «habitués» en train. Au début, elles ont fait appel à la plateforme de Hannut (à 35 km de Couthuin) où des chauffeurs ramenaient «leurs gars» du parc Maximilien. «C’était compliqué, explique Mathilde, qui est aussi bénévole au parc Maximilien. Il fallait mettre en relation le chauffeur avec les ‘gars’ qui voulaient venir chez nous. Je leur donnais une photo et ils devaient les trouver dans le parc. La recherche de ‘driver’ et la coordination, ça me prenait parfois toute une après-midi.» Sylvie et Véronique hébergent depuis novembre 2017, trois en moyenne pour Sylvie, quatre ou cinq chez Véronique. Les deux femmes ont fait quelques fois le trajet jusqu’au parc. «Le soir, ça me prend 50 minutes, mais je ne respecte pas les limitations de vitesse», précise Sylvie. «En journée, cela fait minimum deux heures et demie aller-retour», enchaîne Véronique. À condition de ne plus se perdre dans la capitale, qu’il faut traverser pour rejoindre le parc quand on sort de l’E411. «Rouler à Huy ou rouler à Bruxelles, ce n’est vraiment pas la même chose.»
Héberger le week-end n’est pas qu’une question de facilité pour l’hébergeur. C’est aussi le souhait des migrants. «Quand nous faisions un dispatching continu, explique Mathilde, et que nous avions des propositions pour un hébergement d’une nuit à Gembloux ou ailleurs, les migrants refusaient, ils voulaient rester à Bruxelles. À Ottignies, à Gembloux, beaucoup d’hébergeurs travaillent à Bruxelles et pouvaient donc ramener les migrants le lendemain, mais avec la difficulté qu’ils arrivent tard le soir et doivent se lever tôt le matin.»
Héberger des migrants le week-end, cela permet de créer des liens. «C’est pour ça qu’on récupère les mêmes gars», dit Véronique. «En partant avec eux, le lundi matin pour rejoindre mon kot, j’ai l’impression de partir avec mes potes pour ma semaine d’unif avant de revenir, avec eux, à la maison le week-end», enchaîne Mathilde. «Rien à faire: on s’investit, reconnaît Sylvie. Avant, quand je les reconduisais le dimanche soir au parc Maximilien, je pleurais pendant tout le trajet. Non, jusqu’à Wavre, précise-t-elle en riant. On finit par se blinder. Je me suis souvent dit que s’il devait se passer quelque chose ici, en Belgique, j’aimerais aussi qu’une maman s’occupe de mes enfants.»
C’est Mathilde qui a initié sa famille à l’accueil. Tout a commencé avec le premier Noël, en 2015, avec des Syriens, au plus fort de la crise migratoire. «Depuis lors, nous n’avons plus passé un seul Noël seulement en famille.» Cela a fait l’objet d’un consensus familial? Sylvie fait la moue. La sœur de Mathilde ne s’est pas montrée fort enthousiaste et son mari encore moins. «Mon mari voit leur arrivée comme une restriction de son espace personnel. Et quand ils arrivent, il râle parce qu’ils empruntent ses pantoufles.» Véronique peut comprendre, jusqu’à un certain point. «Parfois, le vendredi, je voudrais pouvoir le passer à autre chose que faire des courses pour les héberger. Je voudrais parfois avoir un week-end cool. Je ne le prends pas parce que je suis de la race des ‘sauveurs’», dit-elle avec ironie. Véronique soulève aussi un autre problème, rarement évoqué chez les autres hébergeuses: la charge financière de l’accueil: «C’est lourd. Les billets de train, la bouffe, les cigarettes, j’en suis à 250 euros par semaine.» Une autre hébergeuse, Anne-Catherine, va aussi évoquer, pudiquement, cette question pour expliquer notamment la diminution de son activité d’hébergeuse: «Je me suis retrouvée avec des factures de régularisation d’eau et d’énergie colossales.»
Les mauvaises expériences? Elles ont existé au tout début, mais cela n’a pas découragé Sylvie et Véronique, qui préfèrent en rire aujourd’hui. Il y a eu ce jeune Soudanais, resté seul à la maison avec Mathilde et qui lui a demandé très explicitement une relation sexuelle, ou l’histoire d’Ali, le premier hébergé, qui ne parlait pas anglais et qu’il a fallu amener d’urgence à l’hôpital Saint-Pierre à Bruxelles le dimanche soir. «Il faut imaginer, moi et Mathilde, roulant dans une ville qu’on ne connaît pas, se perdant malgré le GPS et arrivant à l’hôpital au milieu d’une manifestation avec des combis de flics partout et le type qui nous faisait une crise en hurlant dans la voiture ‘Nord station! Nord station!’ C’était un vrai cauchemar, raconte Sylvie, qui pleure presque de rire en l’évoquant. C’était notre premier hébergement et nous n’avions pas la même expérience qu’aujourd’hui.»
Et demain? Continueront-elles à héberger pendant encore des mois, voire des années? «Il faut avoir des buts à moyen et à long terme, dit Sylvie, et dans l’hébergement, on n’en voit pas.» Mathilde pense que l’action de la plateforme est déjà en train de se modifier en passant de l’hébergement d’urgence à une prise en charge plus globale. «Les gens ne lâchent pas, mais vont faire autre chose, de l’accompagnement social, juridique notamment pour aider ceux qui veulent introduire une demande d’asile.»
«J’aimerais surtout pouvoir les accueillir sereinement, conclut Véronique. Au début, je dormais tout habillée en me disant: si les flics débarquent chez moi, je n’ai pas envie de me trouver en position de faiblesse en étant en pyjama!» Elle rit puis redevient sérieuse: «Si au moins on arrêtait de les pourchasser, je serais moins angoissée en les ramenant à la gare. Je voudrais avoir une relation plus normale avec eux. Si l’hébergement devait cesser parce que les autorités auraient pris le relais, je continuerais à m’en occuper. Je chercherais avec eux un logement, un boulot, comme on peut le faire pour ses propres enfants.»