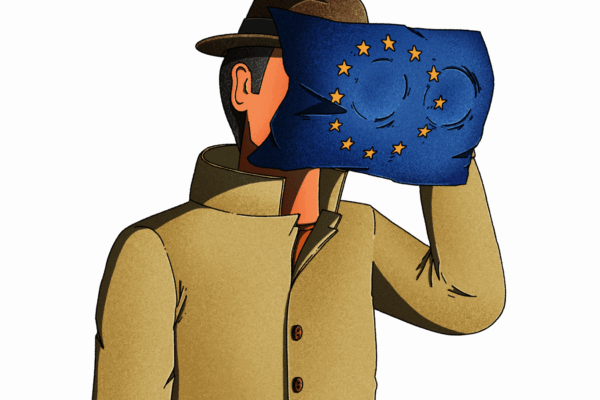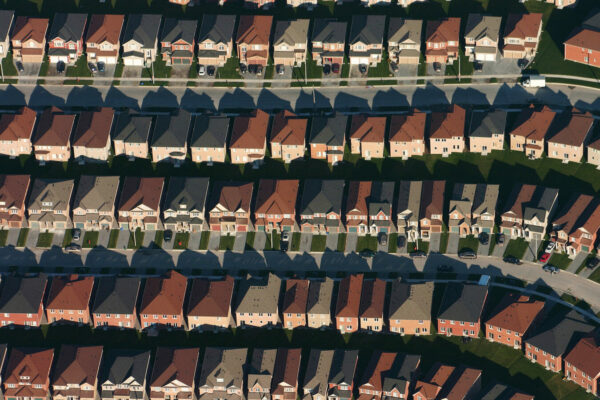Alors que le gouvernement De Wever (N-VA) a annoncé «la politique migratoire la plus stricte possible», que nos voisins français du Figaro Magazine titrent leur une d’un provocant «Voyage en Belgiquistan» et que des hooligans brugeois d’ultra-droite se sont livrés à un déferlement de violences racistes sur les habitants de Molenbeek ce dimanche 4 mai, reconnaître que la population issue de l’immigration vit sous pression est un euphémisme. Une population qui représente près d’un tiers du pays, et dont les indicateurs d’intégration sur le marché du travail sont dans le rouge. En effet, une étude d’Eurostat de 2018 montre un taux d’emploi chez les 20-64 ans de 53,9% pour les personnes issues de l’immigration, contre près de 75% pour les personnes natives (Belges d’origine).
Un accès à l’emploi cadenassé
Cette difficulté à entrer sur le marché de l’emploi est encore plus présente chez les femmes d’origine non européenne, dont le cas spécifique a longtemps été invisibilisé. Une étude de 2023, réalisée conjointement par la Fondation Roi Baudouin, l’ULB, la VUB et l’UMons, montre ainsi un taux d’emploi de 42% chez ces femmes, contre 64% chez les hommes d’origine non européenne, et 73% chez les femmes natives. Le taux d’inactivité est lui aussi exagéré chez ces femmes, avec près de 49% pour la première génération (personnes nées à l’étranger) et 40% pour la deuxième génération (personnes nées en Belgique avec au moins un parent d’origine étrangère). Pour les hommes issus de l’immigration, ce taux passe à 26%, et à 24% pour les femmes natives.
L’économiste Kevin Pineda-Hernández, l’un des auteurs de l’étude, souligne «des difficultés encore plus importantes chez les femmes issues des pays du Maghreb, du Proche ou Moyen-Orient et d’Afrique subsaharienne». Et les raisons de ces inégalités sont multiples, à commencer par le manque de réseau et la non-connaissance de la langue. Les populations de première génération sont par ailleurs moins diplômées, avec environ 31% de personnes disposant d’un faible niveau de diplômes, contre 11% chez les natifs.
Une étude de 2023, réalisée conjointement par la Fondation Roi Baudouin, l’ULB, la VUB et l’UMons, montre ainsi un taux d’emploi de 42 % chez ces femmes, contre 64 % chez les hommes d’origine non européenne, et 73 % chez les femmes natives.
Mais l’économiste observe surtout une «non-reconnaissance des diplômes des travailleurs issus d’écoles et universités étrangères, liée à des politiques très restrictives de la Fédération Wallonie-Bruxelles». De fait, le phénomène de sur-éducation est exacerbé chez les personnes issues de l’immigration, «qui ont une probabilité beaucoup plus élevée que les natifs de travailler dans des métiers pour lesquels ils sont surqualifiés», regrette Kévin Pineda-Hernández.
«On nous prend pour des personnes ignorantes»
C’est notamment le cas de Cécile Rugira, directrice du centre d’hébergement de l’asbl Solidarité Femmes à La Louvière. Arrivée en Belgique en 2000 suite au génocide du Rwanda de 1994, elle se heurte à des stéréotypes profondément ancrés et un système dévalorisant: «On m’a dirigée vers le repassage de vêtements et des cours de langue, alors que je parlais parfaitement le français et que j’étais diplômée en pharmacie.»
Si les statistiques montrent une évolution lente mais positive des indicateurs avec les années, Cécile Rugira estime que le fond du problème reste le même. Elle identifie plusieurs préjugés liés à l’héritage colonial et au regard posé sur les personnes issues de l’immigration, en particulier sur les femmes afro-descendantes. «D’abord, on nous prend pour des personnes ignorantes et incompétentes», préjugé renforcé avec la barrière de la langue. «Pourtant, on ne fait pas ce postulat d’ignorance pour une personne immigrée originaire des États-Unis, par exemple», relève Cécile Rugira. Ensuite, elle souligne les préjugés liés à l’hygiène, au non-respect de l’horaire et l’exotisme: «Quand on veut travailler, on nous prend pour des femmes vénales et des femmes faciles.»
Cécile Rugira observe ainsi l’obligation de «faire ses preuves, de redoubler d’efforts pour montrer que nous sommes comme les autres». De son côté, Véronique Géoris, anthropologue et directrice de l’asbl Le Grain, relève la charge supplémentaire causée par ces efforts: «Ces femmes se retrouvent contraintes de porter un ensemble de problématiques auxquelles l’environnement de travail n’est pas sensible, ce qui crée une forme d’auto-exploitation et un stress permanent.»
La ségrégation du marché du travail
Lorsque les femmes issues de l’immigration parviennent à trouver un emploi, celui-ci est souvent «confiné à des métiers faiblement rémunérateurs, peu gratifiants et exigeants physiquement», comme le pointe l’avis d’initiative «Les femmes d’origine étrangère sur le marché de l’emploi bruxellois», publié par Brupartners en avril 2025. Ainsi, les secteurs du care (soin de santé, aide aux personnes, garde d’enfants), du nettoyage et des titres-services sont surinvestis par les femmes d’origine non européenne. «Ces métiers sont souvent éloignés des qualifications et aspirations initiales, mais si elles veulent se faire une place dans la société, elles n’ont pas vraiment le choix», regrette Véronique Géoris.
Cécile Rugira identifie ici deux dynamiques. D’abord, le plancher collant, qui définit les mécanismes de maintien de ces femmes dans les métiers subalternes. Ensuite, l’ethno-stratification, soit «l’orientation quasi systématique des personnes d’une certaine origine ethnique vers certains métiers, indépendamment des diplômes ou des compétences».
Si les statistiques montrent une évolution lente mais positive des indicateurs avec les années, Cécile Rugira estime que le fond du problème reste le même. Elle identifie plusieurs préjugés liés à l’héritage colonial et au regard posé sur les personnes issues de l’immigration, en particulier sur les femmes afro-descendantes.
La question de la durabilité est aussi préoccupante. «Il y a de grandes difficultés pour entrer dans le monde du travail, mais du fait des stigmates, des discriminations et de la pénibilité, il est aussi très difficile de s’y maintenir», alerte Cécile Rugira. Les femmes issues de l’immigration en paient donc les conséquences physiques et psychologiques, aussi bien causées par la nature du travail que les relations avec les collègues ou l’employeur. Kévin Pineda-Hernández ajoute que ces métiers ne laissent souvent que peu de perspectives d’ascension professionnelle, «puisqu’ils ne proposent tout simplement pas de postes hautement qualifiés». Au plancher collant s’ajoute le plafond de verre.
Ainsi, «c’est une véritable ségrégation qui se crée sur le marché du travail: les personnes issues de l’immigration n’ont accès qu’à l’emploi dont les Belges d’origine ne veulent pas, puisqu’ils se concentrent sur les métiers hautement qualifiés», soulève Kévin Pineda-Hernández. Une ségrégation qui risque de se perpétuer sur les générations futures, le manque de moyens économiques impactant directement l’éducation et les études, ou en «transmettant aux jeunes le message que ce monde ne les accueillera tout simplement pas», conclut Cécile Rugira.
Vie professionnelle et vie familiale
En parallèle, les métiers occupés par les femmes d’origine non européenne sont plus souvent des contrats à temps partiel. Ceux-ci sont tantôt subis (l’étude de 2023 de la Fondation Roi Baudouin montre que les femmes d’origine non européenne sont plus nombreuses à travailler à temps partiel par obligation, et souhaitent un volume de travail supérieur), mais sont parfois nécessaires pour assurer la charge domestique et la garde d’enfants. Cette articulation entre travail et famille est aussi au cœur du non-accès à l’emploi: «Près d’une femme sur deux interrogée dans notre enquête déclare ne pas travailler pour s’occuper des tâches domestiques, contre une sur dix chez les femmes natives», soulève Kévin Pineda-Hernández.
Si Bernard Clerfayt (alors ministre de l’Emploi et de la Formation à Bruxelles) avait accusé en avril 2023 la complaisance du «modèle méditerranéen», ces chiffres peuvent s’expliquer par la pénurie de crèches (notamment dans les zones où la population immigrée est plus nombreuse), contraignant les femmes à assurer la garde des enfants. Véronique Géoris accuse par ailleurs les «dynamiques d’autocensure et d’autosabotage, conséquences de l’ensemble des difficultés à l’insertion, et qui éloignent aussi les femmes de l’emploi».
Enfin, Cécile Rugira insiste sur «l’injonction familiale à accepter tout travail, y compris les moins valorisants, puisqu’un seul bas salaire n’est pas suffisant pour faire vivre un foyer». Les situations de travail à temps partiel ou d’inactivité sont donc avant tout subies et causées par des facteurs structurels. De plus, «les ménages où seul un membre de la famille travaille sont plus souvent en situation de pauvreté, car les métiers où sont dirigés les hommes d’origine non européenne sont eux aussi précaires et peu rémunérateurs», pointe Kévin Pineda-Hernández.
Accompagner, valoriser, émanciper
Noura Amer est la coordinatrice de la Maison des femmes de Molenbeek, un service opérateur d’insertion socioprofessionnelle de l’asbl Move (Molenbeek Vivre Ensemble) localisé à deux pas du lieu des attaques de l’ultra-droite brugeoise. Ici, «on sent la montée du racisme depuis des années, et la peur grandissante chez les femmes que nous accompagnons».
Le mot d’ordre de la Maison des femmes réside dans l’approche intersectionnelle, «qui prend en compte l’addition des discriminations liées au genre, à l’origine et à la classe sociale, et leur action simultanée pour créer des formes uniques de discrimination». La structure accueille plus de 500 femmes, «majoritairement issues de l’immigration et faiblement instruites», mais aussi des personnes qui bénéficiaient déjà d’une indépendance économique et d’une activité professionnelle dans le pays d’origine, «qui se retrouvent ici pieds et poings liés».
Pour Noura Amer, la mise à l’emploi doit d’abord passer par un parcours visant l’insertion sous ses différents aspects. L’émancipation, la confiance en soi, la valorisation des compétences sont les clés de voûte de ce parcours, qui propose des classes de langue, des ateliers sportifs, des projets créatifs et artistiques. C’est notamment le cas de formations visant à permettre aux femmes de devenir guides touristiques alternatives, ou du projet de couture De fil en aiguille vers l’indépendance économique, soutenu par la Fondation Roi Baudouin. «Nous assistons à la naissance de véritables vocations, à la mise en lumière de femmes qui sont valorisées au regard de leurs compétences», s’enthousiasme Noura Amer. «Par cette fierté retrouvée et cet empouvoirement, on brise la solitude, on crée de la solidarité et on les amène vers l’autonomie.»